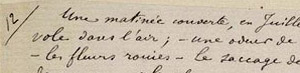|
La FAQ des
Illuminations
|
"Illuminations, recueil de poèmes en prose de Rimbaud"
(Petit Larousse illustré).
Il n'est pas un mot de cette définition, pourtant
élémentaire, qui ne soit objet de litige.
On se demande si le titre "Illuminations" doit être
précédé ou pas de l'article défini. On conteste
parfois aux Illuminations le statut de
"recueil" au sens d'un ensemble organisé.
L'encyclopédie en ligne
Wikipédia n'est pas du tout certaine que Les
Illuminations ne recueillent que des "poèmes en prose" :
"il n'est pas prouvé, y lit-on, qu'il faille écarter les poèmes
en vers du recueil des Illuminations". Enfin, un
livre récent affirme tout de go que les Illuminations ne
sont pas de Rimbaud. Bref, rien de ce que nous savons des
Illuminations n'est certain à cent pour cent. Quant au
texte proprement dit, il a été édité des plus diverses façons depuis sa première
impression par la revue La Vogue en 1886. |
|
Compte tenu de cette situation, on ne peut que
se réjouir du consensus croissant dont témoignent les récentes publications d'uvres complètes.
On observe en effet un louable
souci d'opérer sur les
questions en litige ce qu'André Guyaux, auteur de la dernière
Pléiade, appelle "le choix le plus sage" (p.944). Mais la
sagesse, contrairement au "bon sens" selon Descartes, n'étant pas
"la chose du monde la mieux partagée", on continue à lire
ou à entendre, ici
où là, de la part de ceux qui
s'autorisent à parler savamment des Illuminations,
d'étranges choses. Quelques-unes dues à la complexité réelle du
sujet, mais d'autres, malheureusement, dues à l'ignorance
ou inspirées par le démon de
l'innovation. Situation propre à générer chez le lecteur bien des
questions. C'est à ces questions que nous essayons de
répondre ici. |
|
On peut rejoindre les questions de
son choix en cliquant sur les puces numérotées. |
 |
Pourquoi les poèmes en vers ont-ils été retirés des Illuminations ? |
 |
Le titre est-il
Illuminations ou Les Illuminations ? |
 |
Pourquoi les Illuminations figurent-elles après Une saison en
enfer dans les éditions récentes de Rimbaud ? |
 |
Peut-on définir les Illuminations comme un "recueil"
au sens d'un ensemble structuré ? |
 |
La numérotation des 24 premières pages du manuscrit est-elle de la main de
Rimbaud ? |
 |
Les
Illuminations ont-elles
une "idée principale" ? |
 |
Les "filets de séparation" visibles sur le manuscrit sont-ils porteurs
de sens ? |
 |
Dans
quel ordre ranger les textes quand on édite les Illuminations
? |
|
Annexe - Une question annexe :
L'attribution des Illuminations à Germain Nouveau a-t-elle quelque fondement ? |
|
| |
|
|
|
Bibliographie |
|
Pour élaborer cette synthèse, nous avons utilisé, référence incontournable, la
plus récente édition Rimbaud dans la Pléiade :
-
Arthur Rimbaud, uvres complètes. Texte établi,
présenté et annoté par André Guyaux. Éditions Gallimard,
bibliothèque de la Pléiade, 2009, révisé 2015.
Nous avons lu (et relu), outre les textes cités de
Verlaine et de Rimbaud, les ouvrages fondamentaux suivants :
-
Henry de Bouillane de
Lacoste : Arthur
Rimbaud, Illuminations, Painted Plates, édition
critique, Mercure de
France, 1949, notamment l'introduction, p.7-60, et les
deux appendices, p.137-198 ("Lettres de Félix Fénéon" et
"Les éditions des Illuminations").
-
André Guyaux,
Illuminations, Poétique du fragment, et
Illuminations, texte établi et commenté par André Guyaux
(notamment l'introduction, p.7-16, et les appendices
"Description des manuscrits", p. 272-295, "Les éditions des
Illuminations", p.296-301), À la Baconnière,
1985.
-
Steve Murphy, "Les
Illuminations manuscrites. Pour dissiper quelques
malentendus concernant la chronologie et l'ordre du dernier
recueil de Rimbaud", Histoires littéraires n°1, 2000,
p.5-31.
-
Steve Murphy,
Arthur Rimbaud, uvres
complètes, tome IV, Fac-similés, Champion, 2002 : l'introduction, notamment les p.97-103, et la notice sur les
Illuminations, p.588-601.
-
Michel Murat : "Les Illuminations,
recueil de poèmes en prose", chap. I de la deuxième partie
de L'Art de
Rimbaud, Corti, 2013 [2002],
p.190-238.
Enfin, lorsque nous
évoquerons les enseignements du manuscrit, il sera bon d'avoir sous les yeux les
magnifiques fac-similés que nous offre la BNF :
-
cote BNF : NAF 14123 pour les pages numérotées de 1
à 24 (29 premières proses des Illuminations)
-
cote BNF : NAF 14124 pour Solde, Fairy,
Guerre et la première partie de Jeunesse (Jeunesse I.
Dimanche)
Rappelons, pour
compléter, qu'on trouve aussi en ligne :
Retour haut de page |
|
1) Pourquoi
les poèmes en vers ont-ils été retirés des Illuminations ?
|
|
|
|
Les
Illuminations paraissent une première fois en mai-juin 1886
dans la revue La Vogue, en feuilleton, et sont
rassemblées en plaquette en octobre 1886.
 |
 |
|
Le
périodique (n°7, 7-14 juin 1886) |
La
plaquette (octobre 1886) |
L'uvre de Rimbaud, telle que ses
premiers lecteurs la découvrent
dans le périodique hebdomadaire La Vogue,
contient aussi bien des poèmes en prose que des pièces de vers.
Ces dernières sont, dans l'ordre : Chanson
de la plus haute tour, Âge d'or,
"Nous sommes tes grands parents...", Éternité,
"Qu'est-ce pour nous mon cur..." (livraison du 7 juin 1886) ; Michel et Christine, Bruxelles,
Honte (13 juin 1886) ; "Loin des oiseaux...", "Ô saisons, ô
châteaux...", "La rivière de cassis roule ..."
(21 juin 1886). Ces onze
pièces sont issues de la production rimbaldienne de 1872, date
très antérieure à celle qu'il est convenu d'assigner aux manuscrits des poèmes en
prose. Elles n'ont été retirées des Illuminations qu'en
1945, lorsque
les éditeurs ont fini par se convaincre que leur présence au
sein du recueil n'était aucunement de l'intention de Rimbaud, qu'elles avaient été mêlées aux poèmes en prose
fortuitement pendant le processus de
transmission des
archives de Verlaine sous les auspices de Charles de Sivry.

La Vogue n°9. La fausse
nouvelle de la mort du poète ayant couru
dans Paris, les Illuminations sont attribuées à "Feu Arthur
Rimbaud".
|
|
[1] Arthur Rimbaud, uvres,
texte revu et corrigé par H. de Bouillane de Lacoste,
Hazan, 1945.
[2] Arthur Rimbaud,
Correspondance, éd. Jean-Jacques Lefrère, Fayard, 2007,
p.196-197. Plusieurs corrections ont été apportées à nos
citations sur la base d'observations
justifiées faites par David Ducoffre. Merci à lui.
[3]
Lettres à Sivry du 16? août,
27 oct. et 3 nov. 1878, 28 janv. et 3 fév. 1881, et à d'Orfer du 2 sept. 1884,
Correspondance générale de Verlaine, éd. Pakenham,
p.617-618, 633, 636, 689, 691 et 873. On remarquera dans la
lettre de janvier 1881 comme dans la seconde édition des
Poètes maudits, le souci de différencier les
Illuminations avec les "vers" et les "poèmes".
[4]
Steve Murphy, "Les
Illuminations manuscrites. Pour dissiper quelques
malentendus concernant la chronologie et l'ordre du dernier
recueil de Rimbaud", Histoires littéraires n°1, 2000,
p.6.
[5] Henry de
Bouillane de Lacoste, Illuminations. Painted plates. Édition
critique, Mercure de France, 1949, p.50-51.
|
|
On le voit, la prise de conscience ne s'est pas faite en un
jour. La présence conjointe de proses et de vers dans cette
édition originale de 1886 avait pourtant de quoi surprendre,
Verlaine ayant dit à plusieurs reprises que les
Illuminations étaient des proses. C'est pourquoi, au début
du XXe siècle, dès les
premières publications d'uvres (plus ou moins)
complètes, on commence à remettre en cause les
différents
agencements proposés par La Vogue (périodique et plaquette). Timidement, dans
un premier temps. En 1912, dans sa fameuse édition au Mercure de France (préface Claudel),
Paterne Berrichon, tout en continuant à coiffer l'ensemble du titre Les
Illuminations, sépare clairement les
poèmes en prose de
ce qu'il appelle les "Vers nouveaux et Chansons". Dans
l'édition de poche du même Mercure de France (1914), la section "Vers nouveaux et
Chansons" devient tout simplement : "Vers".
Enfin, en 1945, Henry de Bouillane de Lacoste décide de présenter
Les Illuminations, exclusivement, comme un recueil de
poésie non versifiée (dont les deux poèmes en vers libres
Mouvement et Marine ont été également écartés) [1]. Il sera bientôt suivi par
Jules Mouquet et André Rolland de Renéville, les
auteurs de la première Pléiade (1946). Dans notre exemplaire de cette
édition (issu du troisième tirage de 1963) la présentation des
Illuminations indique : "Nous
publions les poésies de 1872 sous le titre Derniers vers
sans incorporer ces dernières aux poèmes en prose que nous
donnons à la suite sous le titre les Illuminations [...] par
souci de clarté." (p.784). Ce principe éditorial
s'est, dès lors, définitivement imposé.
Sur quelles considérations cette remise en cause de
la publication originale était-elle fondée ? Verlaine lui-même ne
l'avait-il pas couverte de son autorité, dans sa
notice de 1886, en écrivant que le recueil
présenté "se
compose de courtes pièces, prose exquise ou vers délicieusement
faux exprès" ?
Ce passage servira d'argument à quelques spécialistes
récalcitrants, hostiles à cette révision
éditoriale. Cependant, à cette exception près, Verlaine a constamment affirmé que les
Illuminations étaient des proses. Ainsi, dans sa
lettre à Ernest Delahaye du 1er mai 1875, on peut
lire :
"Si je
tiens à avoir détails sur Nouveau, voilà pourquoi :
Rimbaud m'ayant prié d'envoyer pour être
imprimés des « poèmes en prose » siens, que j'avais ; à ce même
Nouveau, alors à Bruxelles (je parle d'il y a deux mois), j'ai envoyé (2 fr.75 de port!!!) illico [...]"
[2]
L'histoire a retenu que l'auteur de ces
lignes, peu
de temps après sa sortie de prison le 16 janvier 1875, se rendit
auprès de Rimbaud qui vivait à ce moment-là en Allemagne.
Lorsque Verlaine, donc, le 1er
mai 1875, précise : "je parle d'il y a deux mois", il indique à
son correspondant (parfaitement informé de la vie de ses amis poètes) que cette demande lui a été faite lors de
l'entrevue de trois jours ayant réuni Verlaine et
Rimbaud à Stuttgart, à la fin de février 1875.
On sait par ailleurs que Nouveau,
en 1874, à Londres, a collaboré à la mise au net des
Illuminations. C'est probablement pour cette raison que
Rimbaud pense pouvoir s'adresser à lui pour les faire imprimer
(à Bruxelles où il se trouve, une impression coûte moins cher,
c'est là que Rimbaud lui-même a trouvé éditeur pour sa Saison
en enfer quelques mois plus tôt), et ce par l'intermédiaire
de Verlaine pour un faisceau de raisons qu'on ignore mais qu'on
peut peut-être deviner (si on aime à romancer). Le mot "Illuminations" n'est
certes pas prononcé, la lettre ne dit pas explicitement qu'il
s'agisse d'elles, mais on voit mal ce que ces "poèmes
en prose" pourraient être d'autre. Au demeurant, toute
sorte de doute se dissipe lorsqu'on croise l'information fournie
par ce document de 1875 avec celle apportée par Verlaine en 1888
dans sa notice sur Rimbaud de la série
Les Hommes d'aujourd'hui :
"On
le voit
en
février 1875,
très
correct, fureteur
de
bibliothèques, en
pleine
fièvre « philomathique »,
comme
il disait
à
Stuttgart, où
le
manuscrit des
Illuminations
fut
remis à
quelquun
qui en
eut
soin."
C'est donc bien des Illuminations qu'il est question dans
la lettre du 1er mai 1875, des Illuminations
comme ensemble de poèmes en prose. Ni l'expéditeur, Verlaine, ni
le destinataire, Delahaye, dans leurs différents témoignages sur
Rimbaud, n'en ont jamais douté (dans
Rimbaud, l'artiste et l'être moral, p.59, ce dernier
reprend à son compte le témoignage de Verlaine).
Une dizaine d'années plus tard, dans Les Poètes
maudits (1883), l'allusion aux Illuminations
comme à un recueil de poèmes en prose est, en tout cas, tout
à fait explicite :
"Il courut tous les Continents, tous
les Océans, pauvrement, fièrement (riche dailleurs,
sil leût voulu, de famille et de position), après avoir
écrit, en prose encore, une série de superbes fragments,
les Illuminations,
à tout jamais perdus, nous le craignons bien."
En réalité ces "superbes fragments"
n'étaient pas perdus mais on devine pourquoi l'auteur des
Poètes maudits s'exprime ainsi lorsqu'on lit sa
correspondance de l'époque. Verlaine, qui a remis les
Illuminations à son beau-frère, le compositeur de
musique Charles de Sivry
(cf. sa lettre à ce dernier du 16? août 1878), lui demande à
plusieurs reprises de les lui restituer (le 27
octobre, le 3 novembre de cette même année). En vain,
puisqu'on peut lire encore dans une lettre au même du 28 janvier 1881 :
"J'attends toujours ces Vers et ces Illuminations"
et, dans la lettre du 3 février suivant (sur un ton d'ironie) : "Quant aux
Illuminations tu trouveras à force de chercher
évidemment". Sivry avait donc égaré ou prétendait avoir
égaré le fameux dossier, ce qui conduit Verlaine, dans une
lettre du 2 septembre 1884, à demander à Léo d'Orfer de
tenter la récupération de la chose : "À propos, si vous
voyez Sivry, mon beau-frère, demandez-lui pour le
Permesse,
le manuscrit des Illuminations de Rimbaud qu'il a à
moi, pour sûr" [3].
Le Permesse était le titre d'une revue que d'Orfer
s'apprêtait à lancer. Comme on le comprend dans ces dernières
lettres,
Verlaine n'a jamais cru que les Illuminations
fussent "perdues". On pense généralement que Mathilde, sachant
que son ex-mari projetait de publier des textes rimbaldiens qui
pouvaient être compromettants, avait donné consigne à Sivry (son
demi-frère) d'empêcher ou de retarder autant que possible la
réalisation de ce projet. D'où la petite phrase des Poètes maudits
(qui constituait, de la part de Verlaine, une menace voilée de rendre bientôt
publique la "perte" du manuscrit par Charles de Sivry) et
la suggestion faite à Léo d'Orfer de faire un peu pression
sur le même Sivry. Est-ce le fait de ces manuvres tactiques ? Toujours est-il
que les Illuminations firent leur réapparition en
1886, bonne nouvelle célébrée par Verlaine dans la seconde
édition des Maudits : "Les Illuminations
ont été retrouvées ainsi que quelques poèmes."
C'est donc par l'intermédiaire de Verlaine
via Charles de Sivry (et
quelques autres : Louis
Le
Cardonnel et Louis Fière) que les
textes des Illuminations sont parvenus
à la revue La Vogue. Et c'est probablement chez Sivry qu'ils
se sont mélangés avec des pièces de vers qui étaient elles
aussi en sa bonne garde. Il n'y a rien d'étonnant à ce que
des poèmes de Rimbaud, autres que les Illuminations,
aient pu se trouver aussi dans les mains de ce personnage
auquel Verlaine, on le voit dans la correspondance, ne cesse
d'adresser ses propres uvres afin qu'il les mette en
musique ou qu'il les fasse imprimer.
Toujours soucieux d'assurer la conservation des manuscrits
de Rimbaud, Verlaine était probablement en possession
de ces poèmes de 1872 (ou début 1873) au moment de la
crise de Bruxelles et de son incarcération, en juillet 1873. Moment où, peut-être, sa mère les
récupéra en même temps que ses objets personnels. Et c'est
par leur intermédiaire qu'ils pourraient être parvenus
jusqu'à Sivry. Plusieurs d'entre eux sont des versions
nouvelles de poèmes datés du printemps 1872. Les moins
anciens datent
au plus tard des premiers mois de 1873.
En suivant comme nous venons de le faire l'itinéraire
compliqué de cet ensemble de vers et proses arrivé entre les
mains de Léo d'Orfer et Gustave Kahn, éditeurs de La Vogue,
en 1886, on comprend sans peine que Les Illuminations
furent dans l'esprit de Rimbaud, comme le dit Verlaine,
"des poëmes en
prose", et que ces proses se trouvèrent mélangées à des pièces de vers à la
suite du "télescopage accidentel de deux dossiers distincts"
[4].
Ceux qui doutent de cette conclusion, nous l'avons
signalé ci-dessus, tirent souvent
argument des formules effectivement contradictoires
utilisées par Verlaine dans sa préface de la
plaquette des Illuminations (publiée quelques mois après la
parution en revue) :
"Le livre que nous offrons au public fut écrit de 1873 à
1875, parmi des voyages tant en Belgique qu'en
Angleterre et dans toute l'Allemagne.
Le mot Illuminations est anglais et veut dire gravures
coloriées, coloured plates : c'est même le sous-titre
que M. Rimbaud avait donné à son manuscrit.
Comme on va voir, celui-ci se compose de courtes pièces, prose
exquise ou vers délicieusement faux exprès."
Mais, comme l'a expliqué
Bouillane de Lacoste [5], Verlaine a passé en partie
l'année 1886 alité dans divers hôpitaux, il n'a
aucunement été associé à la préparation de l'édition de
La Vogue dont les animateurs se sont contentés de lui
demander une courte préface, il n'a probablement même pas eu
à connaître des manuscrits collectés, on lui aura rapporté
qu'on allait publier des proses et des vers : il savait de
quoi il retournait mais il s'est contenté de prendre acte,
bénissant par là une opération certes confusionniste mais
qui avait au moins le mérite à ses yeux de ressusciter un
pan entier de l'uvre de Rimbaud.
Encore une fois, rien de ce que nous savons des
Illuminations n'est certain à cent pour cent. Mais pour
ce qui est de leur définition comme un recueil de poèmes en
prose, le doute n'est pas raisonnablement
permis et c'est pourquoi, depuis plus de soixante-dix ans,
aucune édition de Rimbaud ne les présente autrement.
Retour haut de page
|
2) Le titre est-il
Illuminations ou Les Illuminations ?
|
|
[6] Lettre à Sivry du
16? août 1878.
[7]
Paul Verlaine, "Arthur Rimbaud", Les Hommes d'aujourd'hui,
1888.
[8]
Steve Murphy, "Illuminations ou Les
Illuminations ?", Parade sauvage n°20, 2004,
p.167-182.
|
|
Nous
ne possédons aucun document de la main de Rimbaud indiquant le
titre de son recueil. C'est Verlaine qui nous l'a transmis
(cf. ci-dessus, la citation des Poètes maudits qui le
donne à connaître pour la première fois). Lors de sa première
publication, en 1886, le recueil était intitulé Les
Illuminations. Cette formulation s'est maintenue jusqu'en
1945, date à partir de laquelle presque toutes les éditions ont
adopté le titre : Illuminations. Seule exception notable
: la première pléiade de Mouquet et Rolland de Renéville (1946,
rééd. 1954-1963).
 |
 |
|
Édition de Berrichon,
Mercure de France, format poche, 1914.
Titre avec article. Source :
Collection André Breton |
Édition de Bouillane de Lacoste,
Mercure de France, 1949.
Titre sans article.
Le
recueil est sous-titré Painted Plates
conformément aux indications de Verlaine (lettre à
Sivry du 27 octobre 1878 et
notice de 1886). |
C'est Henry Bouillane de Lacoste qui initia ce virage éditorial. Du fait que le mot "illuminations", au
dire de Verlaine, était un mot anglais devant être compris dans
le sens de "painted plates", "coloured plates" ("gravures
coloriées"), Bouillane de Lacoste avait déduit que le titre
devait être présenté sans article. Verlaine, d'ailleurs, ne
l'employait-il pas de cette manière dans une lettre : "Avoir
relu « Illuminations » (painted plates) du Sieur que tu
sais » [6] ?
D'une part l'argument de l'origine anglaise n'est guère
recevable car il est évident que Rimbaud, même s'il a donné le
sous-titre "painted plates" à son recueil, joue aussi sur
le sens français du mot "illumination". D'autre part, l'occurence
citée, unique, n'est pas concluante : la suppression de l'article
peut s'expliquer par le style télégraphique adopté par Verlaine
dans ce passage de sa lettre.
Il est vrai que, partout ailleurs, dans sa correspondance
comme dans ses articles imprimés, lorsque le mot "Illuminations"
est précédé de l'article "les", celui-ci est écrit sans
majuscule. Mais cela n'est pas concluant non plus, on écrit aussi bien "j'ai
relu
les Méditations poétiques de Lamartine" (titre sans
article) que "l'auteur étudie l'humour dans les Provinciales
de Pascal" ou "le paysage dans les Chants de Maldoror" (titres avec article).
Au reste, Verlaine écrit
parfois
"les" en italique :
"ce
pur chef-d'uvre, flamme et cristal,
fleuves et fleurs et grandes voix de bronze d'or : les
Illuminations"
[7]
Ces
trois facteurs, l'emploi verlainien de l'article en lettres
minuscules, la faiblesse de
l'argument présenté par Bouillane de Lacoste et la
la légitimité que donne au titre avec article le fait d'être
malgré tout le
titre d'origine, cautionné peut-être par Verlaine, font pencher Steve Murphy en faveur de la restitution de l'article
[8].
André Guyaux, lui, opte pour continuer la tradition de Bouillane : dans sa récente "pléiade", il titre : Illuminations.
Retour haut de page
|
|
3) Pourquoi
les Illuminations figurent-elles après Une saison en
enfer dans les éditions récentes de Rimbaud ?
|
|
[9] Henry de Bouillane
de Lacoste, Rimbaud et le problème des Illuminations,
Mercure de France, 1949.
[10]
Arthur Rimbaud, uvres complètes, tome IV,
Fac-similés, éd. Steve Murphy, Champion, 2002, p.589.
[11]
Arthur Rimbaud,
uvres complètes. Texte établi, présenté et annoté par André
Guyaux. Éditions Gallimard, bibliothèque de la Pléiade, 2009,
p.940. |
|
Jusqu'à la fin des
années 1950, toutes les éditions des uvres complètes de
Rimbaud ont placé Les Illuminations avant Une saison
en enfer. C'est encore Bouillane de Lacoste qui a bousculé
sur ce point l'ancien consensus rimbaldien en publiant, en 1949
sa thèse : Rimbaud et le problème des Illuminations [9]. Son propos visait à démontrer que Verlaine avait dit la
vérité quand il écrivait, dans sa préface
de la plaquette de 1886 :
"Le livre que nous offrons au public
fut écrit de 1873 à 1875,
parmi des voyages tant
en Belgique qu'en
Angleterre et dans toute
l'Allemagne."
Ce
témoignage n'avait jamais été pris au sérieux. Il était par trop
contradictoire avec la fausse évidence selon laquelle
Une saison en enfer, datée "avril-août 1873", constituait une sorte
d'adieu à la littérature, la palinodie du
Rimbaud mauvais ange, lecture
à tendance moralisatrice fortement encouragée par le clan
familial.
On ignore tout sur la
gestation des Illuminations. Mais on sait qu'une partie
des manuscrits a été mise au net en mars-avril 1874 à Londres.
En effet, on y a reconnu l'écriture de Germain Nouveau qui
cohabitait avec Rimbaud dans ces mois-là (cf. par exemple, la
page 24 du dossier de 1886 des Illuminations).
D'autres éventualités, moins vraisemblables, seraient la fin de 1873, date à laquelle Rimbaud fait la connaissance de Nouveau à Paris
(cf. la biographie de R. par J.-J. Lefrère p. 657-658),
ou le début de 1875, date à laquelle Nouveau fait un voyage dans
les Ardennes, y côtoyant peut-être quelque temps Rimbaud, avant
de gagner Bruxelles (ibid. p. 717-718 et 742 note 3).
On sait qu'en avril 74, à Londres, non seulement Rimbaud continue
de travailler à ses Illuminations en compagnie de Nouveau mais il songe à se
lancer dans une entreprise poétique nouvelle, ambitieuse et de
longue haleine. On
a récemment découvert une
lettre du 16 avril 1874 envoyée par Rimbaud à
Jules Andrieu dans laquelle il
expose le projet d'une série de "poèmes en prose" à sujet
historique destinés à paraître en feuilleton (dans la presse
anglaise d'abord). Titre prévu : L'Histoire splendide.
On sait par la lettre
de Verlaine à Ernest Delahaye du 1er mai 1875 citée
plus haut que Rimbaud a remis les manuscrits des
Illuminations à Verlaine fin
février 1875 à Stuttgart, en le priant de les transmettre à
Germain Nouveau qui se trouvait à ce moment-là à Bruxelles,
"pour être imprimés". On peut donc affirmer tout au
moins que Les
Illuminations sont la dernière de ses uvres que Rimbaud ait
songé à faire éditer.
On sait, enfin, depuis l'analyse graphologique réalisée
par Bouillane de Lacoste (ultérieurement complétée et confirmée
par celles de Guyaux et Murphy), que "tous les manuscrits connus du
recueil sont postérieurs à tous les manuscrits que l'on peut
dater avec certitude de 1873" [10].
L'argument le plus décisif de cette expertise porte sur la forme
des "f" minuscules, qui sont tous bouclés par le bas dans les
450 occurrences de cette lettre au sein des Illuminations
et des textes ultérieurs, alors qu'ils ne le sont quasiment
jamais dans les textes de 1870-1873. Notamment dans les quelques
échantillons de l'écriture de Rimbaud que nous possédons pour
l'année 1873 : les autographes du "dossier de Bruxelles" ou les
transcriptions calligraphiées des poèmes de Verlaine Crimen
amoris, L'Impénitence finale, Don Juan pipé.
Pour toutes ces raisons, les Illuminations sont
aujourd'hui placées après Une saison en enfer dans toutes les
éditions récentes d'uvres complètes.
C'est seulement en
1957 que le débat
engagé par Bouillane de Lacoste sur la chronologie relative des
dernières uvres de Rimbaud paraît tranché lorsque deux éditions
(celles du Cercle du livre précieux et du Club
français du livre) placent pour la première fois le recueil
de poèmes en prose après Une saison en enfer. Mais il
restait et il resterait longtemps des réfractaires. À commencer
par les auteurs de la première pléiade, Mouquet et Rolland de
Renéville qui, même dans leur troisième édition de 1963,
continuent à placer la Saison à la suite des
Illuminations.
La question de savoir quand Rimbaud a écrit ces
textes n'en est pas pour autant tranchée. Car les manuscrits
que nous possédons ne sont que des mises au net de textes rédigés à une date antérieure, que nous ignorons. Cette
situation laisse naturellement la place aux conjectures les plus
diverses concernant la période de gestation de cette
uvre majeure. Bouillane de Lacoste pense que Rimbaud a rédigé
ses poèmes en prose dans les mois immédiatement
antérieurs à leur mise au net, au printemps 1874.
Mais l'opinion la plus couramment répandue, sans doute, est
celle qu'exprime André Guyaux dans son édition de la Pléiade :
"Il est tentant,
aujourd'hui,
d'équilibrer les
hypothèses et de
distribuer la genèse des Illuminations dans un temps
discontinu, interrompu par Une saison en enfer et les
événements de juillet et d'août 1873 ;
et de penser que Rimbaud
reprend à Londres, au printemps de 1874, un projet
antérieur et des textes laissés en souffrance" [11]
Les
arguments en faveur de cette conjecture nuancée sont les plus
divers. Le sentiment, d'abord, qu'on n'élabore pas une
uvre aussi novatrice, aussi géniale, en seulement quelques mois
(de septembre 1873 à mai 1874 au plus tard). L'étonnement,
ensuite, devant l'apparente panne de créativité du poète dans la
deuxième moitié de l'année 1872 : Rimbaud semble n'avoir rien
écrit entre juin 1872 (Âge d'or) et Une saison en
enfer (daté avril-août 1873). Sauf à imaginer que ces mois
ont été occupés par les premiers travaux des Illuminations ! À ces
spéculations fragiles, Guyaux a tenté d'ajouter des preuves plus
scientifiques. En premier lieu, une
lettre de mai 1873 où Rimbaud demande à Delahaye, qui doit
rencontrer Verlaine, de lui servir d'intermédiaire : "il te
chargera probablement de quelques fraguemants en prose de moi et
de lui, à me retourner". Mais rien ne prouve que ces proses
soient déjà des Illuminations. Ensuite, un argument
d'ordre graphologique : certaines écritures des Illuminations
seraient très proches de celles des poèmes de Verlaine recopiés
par Rimbaud en 1873. Mais Steve
Murphy, qui penche pour la thèse de Bouillane de Lacoste, lui
rétorque qu'aucun de ces poèmes ne
présente les fameux "f" bouclés caractérisant l'écriture de
Rimbaud dans les proses des Illuminations.
Comme on le
voit, sur ce sujet non plus, le consensus n'est pas complet,
mais personne ne croit plus aujourd'hui que Rimbaud ait mis un
point final à son aventure littéraire en septembre 1873, que l'Adieu
de la Saison recueille sa décision irrévocable d'arrêter
d'écrire. Et personne ne défend plus vraiment qu' Une saison en enfer
soit l'uvre terminale de Rimbaud.
Retour haut de page |
4)
Peut-on définir les Illuminations comme un "recueil"
au sens d'un ensemble structuré ?
|
|
[12]
La parution en feuilleton
des Illuminations dans La Vogue a été le théâtre
dun curieux incident. Ayant décidé de quitter la revue (dont il
assuma la direction jusqu'au n°5), Léo dOrfer
emporta un lot de textes encore à publier (cinq proses des
Illuminations et quatre pièces de vers de 1872). De sorte
que Gustave Kahn, le nouveau rédacteur en chef de la revue (dont
il était jusque là le secrétaire de rédaction) dut annuler les dernières publications annoncées.
Les poèmes concernés seront ultérieurement prêtés par d'Orfer à
son ami Grolleau (autre directeur de revue) puis vendus par ce
dernier à léditeur Vanier qui les incorporera, en 1895, à son
édition des Poésies complètes. Pour une information plus précise, voir nos
tableaux sur les
modalités de transmission de l'uvre de Rimbaud et l'historique
de l'édition rimbaldienne.
|
|
L'ordre des poèmes au sein des Illuminations fait
actuellement l'objet d'un consensus entre les principaux
éditeurs. On distingue à la base de ce recueil deux groupes de
manuscrits. Le plus important d'entre eux, en nombre de poèmes
représentés, consiste en une succession numérotée de
vingt-quatre pages (23 feuillets dont un utilisé recto-verso, le
feuillet correspondant aux pages 21-22),
possiblement numérotées par l'auteur lui-même. Ce sont les
poèmes de ces feuillets que les éditeurs placent en tête du
recueil. Toutes les éditions respectent le même agencement d'Après
le Déluge à Barbare. Mais les manuscrits des
Illuminations n'appartiennent pas tous à cette série
numérotée. Les treize poèmes restants "figurent sur des
feuillets de format divers et offrant des graphies plus variées
[que celles des feuillets numérotés]" (André Guyaux, Pléiade
2009, p.941). C'est pour ces textes, généralement placés en fin
de recueil mais dans un ordre de succession changeant, que les
normes éditoriales ont été les plus floues au cours de l'histoire.
Mais les éditions savantes les plus récentes convergent pour
placer d'abord les textes publiés dans la revue La Vogue,
dans l'ordre de La Vogue (soit : Promontoire,
Scènes, Soir historique, Mouvement, Bottom,
H, Dévotion, Démocratie), puis les cinq
textes publiés dans l'édition Vanier de 1895, dans l'ordre de
cette édition (soit : Fairy, Guerre, Génie,
Jeunesse, Solde) [12]. C'était d'ailleurs le principe
suivi par la première Pléiade Rimbaud, d'André Rolland de
Renéville et Jules Mouquet. On a plus de chance ainsi, dit
Murphy, de retrouver un ordre ayant quelque chose à voir avec
les intentions de Rimbaud (cf. SM, Champion, tome IV, p.
618-620). André Guyaux, dans sa Pléiade de 2009, s'est
rangé à ce point de vue.
Les Illuminations présentent donc au
lecteur d'aujourd'hui toute l'apparence d'un recueil à la
structure fixe. Mais a-t-il véritablement été conçu par Rimbaud
comme un ensemble structuré ? On aborde souvent cette question
par le difficile problème de la numérotation des vingt-trois
premiers feuillets. Par qui ces
premiers feuillets ont-ils été numérotés ? Par Rimbaud ? Par ses premiers éditeurs ? Nous nous réserverons de revenir
sur ce thème
plus loin, dans une partie spécifique de cette FAQ (voir
Question 5). Nous
préférons relever, pour commencer, les nombreux indices d'une
intention organisatrice dont l'initiative incombe sans conteste à
Rimbaud lui-même. Dans son livre Poétique du
Fragment, fondé sur une analyse à la loupe du manuscrit des
Illuminations, André Guyaux relève nombre de ces indices
dans la démarche suivie par Rimbaud au cours du processus de
transcription des textes.
Le premier et le plus aisé à repérer, c'est la
constitution de séries numérotées en chiffres romains : les cinq
poèmes d'Enfance, les trois de Vies, les quatre de
Jeunesse, les trois de Veillées, les Villes
I et II (même si leur ordre a été inversé au cours de la
transcription). Autre indice : un petit nombre de
textes seulement se présentent isolés sur un unique feuillet (Parade,
Après le Déluge, Promontoire, Scènes, Soir historique,
Mouvement, Génie, Solde), tous les autres ont été recopiés
sans solution de continuité : ils sont plusieurs à se suivre sur
un même feuillet, chevauchant quand c'est nécessaire d'un
feuillet sur l'autre (vingt et une des vingt-quatre pages
numérotées présentent une forme ou une autre d'enchaînement). Or, ce procédé suppose des choix qui peuvent ne
pas être sans rapport avec le sujet et le sens des textes : des
poèmes successifs présentent de fait, parfois, une convergence
thématique évidente qui explique pourquoi Rimbaud les a
enchaînés.
Nous en reparlerons plus loin.
André Guyaux montre aussi que l'écriture de
Rimbaud a évolué significativement pendant la
transcription de ses proses : il est passé d'une écriture "sinistrogyre"
à une écriture "dextrogyre" (en réalité, la sinistrogyre ne
penche pas vers la gauche comme son nom paraît l'indiquer, mais
elle est moins penchée et moins penchée à droite que la
dextrogyre).
Exemple d'écriture sinistrogyre : 1er § raturé d'Enfance
(verso du f°24) :

Exemple d'écriture dextrogyre (petite) : Phrases (haut du
f°12) :

Dans
l'écriture dextrogyre, on peut distinguer trois tailles
différentes : petite, moyenne et grande (nous utilisons Guyaux p.68
et ajoutons Génie, Scènes et Mouvement) :
| Grande
dextrogyre |
Enfance
(f°2-5)
Vies (f°8-9)
Départ (f°9) |
| Moyenne
dextrogyre |
Parade
(f°6)
Antique
(f°7)
Being Beauteous
(f°7)
À une raison
(f°10)
Matinée d'ivresse
(f°10-11)
Phrases (f°11)
Ouvriers (f°13)
Les Ponts (f°13-14)
Ville (f°14)
Ornières (f°14)
Villes (Ce sont des villes...) (f°15-16)
Vagabonds (f°16)
Veillées III (f°19)
Mystique (f°19)
Aube
(f°19-20)
Fleurs
(f°19)
Nocturne vulgaire
(f°21)
Angoisse
(f°23)
Métropolitain (le début)
(f°23)
Barbare
(f°24) |
| Petite
dextrogyre |
Conte
(f°5)
Royauté
(f°9)
Phrases (f°12)
Jeunesse III (Vanier
1895)
Jeunesse IV
(Vanier 1895)
Veillées I (f°18)
Guerre (Vanier 1895)
H (f° non numéroté)
Génie (f° non numéroté) |
Dextrogyre
mais plus difficiles à classer |
Solde
(Vanier 1895)
Veillées II (f°18)
Nocturne vulgaire (f°21) |
|
Sinistrogyre |
Après le Déluge
(f°1)
Marine (f°22)
Fête d'hiver (f°22)
Fairy (Vanier 1895)
Jeunesse I (Vanier 1895)
Jeunesse II (Vanier 1895)
Promontoire (f° non numéroté)
Bottom (f° non numéroté)
Scènes (f° non numéroté)
Mouvement (f° non numéroté)
+ paragraphe raturé d'Enfance (verso
f°24) |
|
|
[13] André Guyaux,
Poétique du fragment, À la Baconnière,
1985, p.189.
[14] Michel Murat,
L'Art de Rimbaud, Corti, 2002, p.465.
Dominique
Combe : Poésies. Une saison en enfer. Illuminations,
Foliothèque, 2004, p.117.
|
|
L'écriture sinistrogyre
est chronologiquement antérieure à la forme dextrogyre, nous dit
Guyaux. Il suffit pour s'en rendre compte d'observer un feuillet
comme celui qui contient Bottom et H (voir le
fac-similé
ci-dessous, question 7). L'écriture sinistrogyre de
Bottom est très proche des copies rimbaldiennes de poèmes de
Verlaine de 1873. L'écriture de H, par contre, est
dextrogyre. Le poème a été ajouté à Bottom
ultérieurement, à un moment où la calligraphie rimbaldienne
avait déjà évolué.
Une dernière observation utile est celle des types de
papier utilisés. La grande majorité des poèmes sont copiés sur
des feuilles de papier de qualité et de format identiques.
Ainsi, parmi les vingt-trois feuillets paginés, les folios 2 à 17,
19, 20 et 23 à 24 correspondent à ce type majoritaire.
Si, maintenant, on confronte les divers indices, on se
rend compte que :
-
les textes des feuillets numérotés sont transcrits en règle
générale dans une écriture dextrogyre, sur des papiers de
forme normalisée. L'écriture dextrogyre de petite taille
correspond souvent à des textes recopiés en bas de page,
peut-être ajoutés dans des espaces vides pour rentabiliser
le papier, mais pas forcément sans rapport thématique avec
le texte précédent (cf. Conte, au bas d'Enfance
V et Royauté, en dessous de Départ).
C'est aussi parmi ces feuillets en écriture dextrogyre,
notamment en début de numérotation, qu'on trouve le plus
grand nombre de séries fortement structurées.
-
L'écriture sinistrogyre, c'est-à-dire celle des textes les
plus anciennement calligraphiés, correspond plutôt, en règle
générale, aux textes non numérotés et/ou copiés sur des
feuilles souvent plus petites, de formats, de qualités ou de
couleurs disparates.
Sur la base de ces observations, nous aurions tendance
à imaginer le scénario suivant : au printemps 1874,
Rimbaud entame (avec l'aide de Nouveau) une campagne accélérée
de mise au propre de ses Illuminations. En même temps, il
tente de donner un certain ordre au recueil, de construire des
séries, d'établir des liens de contiguïté (nous en verrons
quelques exemples dans le cadre de la question
6). Mais il semble
avoir été amené (lui ou son premier éditeur, si l'on suppose que
l'ordre correspondant à la numérotation des folios 1 à 24 n'est pas de
sa main) à bouleverser quelque peu le premier agencement
envisagé. "Quelqu'un", disons, et probablement Rimbaud lui-même, a décidé après coup de commencer
le recueil avec Après
le Déluge,
plaçant ainsi un feuillet de taille réduite, en écriture sinistrogyre, devant les feuilles impeccablement calligraphiées
d'Enfance, et suivantes. De même, ce "quelqu'un" décide après coup
d'insérer au beau milieu des premières pages dextrogyres les
feuillets (ou folios) 12 et 18, de manière à constituer les séries de
Phrases et de Veillées.
En tout état de cause, toute une partie des textes
semble être restée dans un état antérieur à celui que
caractérisent la graphie dextrogyre et les effets d'enchaînement
du printemps 1874. Rimbaud n'est pas allé jusqu'au bout de la
retranscription entreprise. Ici, trois hypothèses alternatives :
ou bien il a estimé que les anciennes
copies sinistrogyres feraient l'affaire et il a jugé inutile de
se donner le mal de les recopier, mais, dans ce cas, il aurait
pu quand même les numéroter ; ou bien il a éprouvé des
difficultés dans le classement de certains de ses textes et a
remis à plus tard l'achèvement de son travail de
retranscription ; ou bien, quelque chose s'est produit qui l'a
contraint, ou tout au moins incité, à interrompre le travail commencé.
De cet inachèvement, André Guyaux a tenté de donner une
interprétation positive. Selon lui, les efforts de Rimbaud
pour construire un recueil contredisaient ce qui était la pente
naturelle de son génie, la fragmentation et la dispersion. Et
c'est pour cette raison qu'il a échoué. La contrepartie positive de cet
échec serait l'invention d'une forme limite du poème en prose,
le fragment : "Rimbaud a exploité le caractère fragmenté du
poème en prose et l'a conduit vers le fragment pur" [13].
Mais cette théorie du "fragment" n'est pas ce qui définit le
mieux le projet poétique représenté par Les Illuminations. Comme l'ont relevé nombre de contradicteurs,
elle tend à sous-estimer l'unité de l'uvre (sa
profonde cohérence thématique, soulignée par les velléités de
construction, la confection de séries et d'enchaînements) et,
plus dommageable encore, à méconnaître l'unité des structures poétiques mises au
point par Rimbaud, ce qui fait de chacune d'entre elles non
un fragment soustrait à on ne sait quelle totalité, rescapé
d'on ne sait quelle dispersion, mais un tout, achevé et
doté d'un sens cohérent.
Contrairement
au Baudelaire
des
Petits poèmes en prose,
explique Michel Murat, Rimbaud
cherche à maintenir dans ses Illuminations
ce qui caractérise
la langue des vers, cest-à-dire la construction de
« régularités », en expérimentant des formes poétiques nouvelles
(la disposition en brefs alinéas, ou en vers libres).
Les effets
d'ouverture et de clausule, de refrain et de bouclage du texte,
si fréquents dans Les Illuminations, sont aussi des
procédés formels hérités de la poésie versifiée.
Le travail poétique,
écrit Murat, « se fait directement dans la langue, sans
la médiation du vers et de la mémoire dont il est dépositaire », en
sappuyant sur les formes de la langue, mises en évidence par
toute une série de procédés (répétitions avec variations,
développements par membres parallèles...).
Il s'efforce, ajoute
Dominique Combe, par une
"formidable concentration du matériel verbal",
de
"poétiser
la prose en aérant, en allégeant sa matière [...]. Comme les
parenthèses et les points de suspension, comme l'asyndète et la
parataxe, les [tirets, véritables] signes rythmiques de
ponctuation ont pour principal effet d'empêcher le déroulement
et l'expansion de la phrase en période, qui apparenterait le
poème en prose à la prose poétique" [14].
Ainsi, à l'inverse de cette idée de désagrégation ou
d'indétermination formelle qui semble devoir accompagner la
notion de "fragment", ce qui constitue l'essentiel du projet
rimbaldien dans Les Illuminations, et qui définit son
unité, c'est
la recherche de formes nouvelles, très structurées, très
ciselées, du poème en prose.
Retour haut de page |
5) La numérotation des
vingt-quatre premières pages du manuscrit est-elle de la main
de Rimbaud ?
|
|
[15]
Les
citations ci-dessus viennent
toutes des lettres de Fénéon publiées par Bouillane de Lacoste,
p.138 et sqq. de son édition critique des
Illuminations au Mercure de France (1949). Sur cette importante question
d'archéologie rimbaldienne, voir dans ce site la page intitulée
:
Félix Fénéon, premier éditeur des Illuminations ?
[16] L'édition Vanier
de 1892 et la première édition Berrichon de 1898 reproduisent
exactement La Vogue. En
1912, s'étant rendu compte de l'incongruité, Berrichon fait des
Ponts une prose à part, sans pouvoir lui restituer son
titre, car il n'a jamais vu le manuscrit. Dans la table des
matières, le poème apparaît désigné par son incipit : "Des ciels
gris de cristal...". Claudel, dans une
lettre du 18 novembre 1912, lui reproche cette initiative (Arthur
Rimbaud, Correspondance
posthume, 1912-1920, p.310). Dans
ses éditions suivantes (1914 et 1922), Berrichon place à nouveau
le texte
des Ponts à la suite d'Ouvriers, en le séparant
malgré tout par trois astérisques. Le poème n'est plus mentionné
dans la table des matières. Quant à Fête d'hiver,
à partir de 1912, Berrichon le déplace carrément et en fait le
dernier alinéa de Phrases.
À la fin des années 1930,
les principaux éditeurs Bouillane de Lacoste (1939-41-45-49),
Jules Mouquet et André Rolland de Renéville (1946, réédité 54
et 63 ), Paul Hartmann (1956-57) étant parvenus à se faire
montrer les manuscrits depuis longtemps inaccessibles des
Illuminations (collections Berès et Lucien-Graux),
Ouvriers et Fête d'hiver sont enfin imprimés sous
leur titre.
|
|
Félix Fénéon passe
pour avoir été le premier éditeur des Illuminations. Parlant, en 1939,
du manuscrit de cette uvre, il affirme que
Gustave Kahn lui aurait "confié le soin de le préparer pour
l'impression et d'en revoir les épreuves". Et, ce, "non seulement
pour la publication dans le périodique, mais pour leur
réimpression en plaquette" (rappelons que Les
Illuminations paraissent une première fois en mai-juin 1886
dans la revue La Vogue, en feuilleton, et sont
rassemblées en plaquette en octobre 1886). Ainsi missionné,
Fénéon se serait appliqué à "classer dans une espèce d'ordre" les "feuilles
volantes et sans pagination" placées entre ses mains. Telle
est du moins l'imparfaite vérité qui ressort des lettres adressées
par Fénéon à Bouillane de Lacoste le 19 et le 30 avril 1939, version qui a reçu l'aval d'une partie
de la critique rimbaldienne. Mais la vérité vraie est que Fénéon n'a revendiqué une telle paternité qu'en 1939.
Quand, dans le compte rendu
qu'il rédige en 1886 pour la
revue Le Symboliste, il évoque ses
efforts pour distribuer dans un ordre logique les poèmes de
Rimbaud, c'est seulement à la réimpression
en plaquette qu'il fait référence. Ni Fénéon ni personne ne
s'est jamais prévalu, à cette date, d'avoir "arrangé selon [s]on
goût" les Illuminations, en vue de leur publication dans
le périodique La Vogue [15].
Pour ce qui est de la révision des épreuves, si Fénéon
a véritablement travaillé aux numéros 5 et 6 de La Vogue
comme la vulgate le rapporte, on ne le félicite pas. Car il ne s'est tout
simplement pas rendu compte que manquaient dans ces épreuves
deux titres de poèmes, Les Ponts et Fêtes d'hiver.
Comment Fénéon a-t-il pu faire de telles erreurs, et cela à deux reprises car la plaquette ne
corrige nullement sur ce point la présentation du périodique ?
Comment Fénéon a-t-il pu commettre de telles fautes
d'inattention
s'il est vrai qu'il a révisé les épreuves, ayant à sa
disposition les feuillets
manuscrits de Rimbaud ? Du fait de cette
négligence, les deux pièces se sont trouvées agglutinées à
celles qui les précédaient, Ouvriers et
Marine (ou, pour le moins, ont été dépossédées de leurs
titres) dans toutes les éditions successives, pendant un
demi-siècle [16].
Voir ci-dessous l'exemple du poème Les Ponts, tel qu'on
peut l'observer, soudé à Ouvriers, dans la préoriginale de La
Vogue :
Pour ce qui est, par contre, du "classement",
chapeau ! Du moins en ce qui concerne les deux premières
livraisons (celles qui correspondent aux pages numérotées 1 à 24
du manuscrit). Car, comme nous tenterons de le montrer plus loin (question
6) l'ordre des proses, tel qu'on put les lire dans la "préoriginale" n'était pas dépourvu d'une certaine logique,
propre à faciliter la compréhension de l'uvre.
Mais, par
malheur, dans la plaquette, l'organisation n'est plus du
tout la même. Voir les explications qu'offre
Fénéon lui-même, dans le compte rendu des Illuminations
qu'il rédige pour la
revue Le Symboliste du 7 oct. 1886, sur "l'espèce
d'ordre" donné par lui au recueil :
"Les feuillets, les
chiffons volants de M. Rimbaud, on a tenté de les distribuer
dans un ordre logique. Dabord des révolutions cosmiques, et
sébat sa joie exultante et bondissante, aux tumultes, aux
feux. Puis des villes monstrueuses : une humanité hagarde y
développe une féerie de crime et de démence. De ces décors,
de ces foules, sisole un individu : exultations
passionnelles tôt acescentes et acres, et déviées en
érotismes suraigus. Une lipothymie le prostre. Il appète une
vie végétative : quelques silhouettes dêtres humbles
errent, des jardinets de banlieue bruxelloise fleurissent,
pâlement nuancés, dans une tristesse dolente. À la primitive
prose souple, musclée et coloriée se sont substituées de
labiles chansons murmurées, mourant en un vague de sommeil
commençant, balbutiant en un bénin gâtisme, ou qui piaulent.
Brusque, un réveil haineux, des sursauts, un appel à quelque
bouleversement social glapi dune voix dalcoolique, une
insulte à cette Démocratie militaire et utilitaire, un
ironique et final : en avant, route !"
|
|
[17] Les éditeurs du
XXe siècle (mis à part André Guyaux en 1985) sont
généralement revenus, pour le début de l'uvre, à l'ordre du périodique (l'ordre
que sanctionne la
numérotation de 1 à 24 figurant sur le manuscrit). Ils n'ont pas suivi la méthode utilisée par
Fénéon dans la plaquette. Mais ils ne semblent pas en avoir
été choqués outre mesure. Exemple, Bouillane de Lacoste qui, tout à
fait convaincu de la paternité de Fénéon dans les deux
agencements successifs de 1886, écrit : "Il est clair que
toutes ces proses étant sans lien entre elles, leur ordre
importe peu, et qu'un classement en vaut un autre" (op.cit.
p.162).
|
|
L'ordre suivi par Fénéon dans ce
résumé correspond grosso modo à la plaquette d'octobre 1886.
Fénéon y a en effet situé, en début de recueil, tout de suite
après Après le Déluge (folio 1 du manuscrit), Barbare (f°24),
Mystique (f°19) et quelques autres, puis les poèmes du cycle
urbain, puis des "exultations passionnelles" et "érotiques"
avec, par exemple, la séquence suivante : À une raison
(f°10), H (f° non numéroté), Angoisse (f°23),
Bottom (f° non numéroté), Veillées (f°18-19),
Nocturne vulgaire (f°21), Matinée d'ivresse
(f°10-11), enfin les "chansons" de 1872 et,
pour terminer, "appel à quelque bouleversement social glapi
dune voix dalcoolique", Soir historique et
Démocratie. Comme on le voit, l'ordre de la revue a été
bouleversé de fond en comble.
Il est tout de même étrange qu'un éditeur remette aussi
complètement en cause l'agencement qu'il est censé avoir
lui-même mis au point, à peine six mois auparavant. D'autant que, non
seulement l'ordre donné aux poèmes dans le périodique a été
abandonné, mais la méthode éditoriale respectueuse du manuscrit
ayant présidé à la confection de cette préoriginale a été, elle aussi, malheureusement abandonnée :
dans le périodique, l'ordre suivi conserve systématiquement les
enchaînements du manuscrit lorsque des poèmes
sont plusieurs à se
suivre sur un même feuillet ; dans la plaquette, par contre,
Fénéon ne montre aucun égard pour l'ordre dans lequel Rimbaud a
recopié ses textes quand cet ordre est impliqué par le
manuscrit. C'est comme s'il ne le connaissait pas ou avait
décidé de n'en tenir aucun compte. Des exemples ? Le poème Conte, que Rimbaud a copié
immédiatement à la suite d'Enfance, se retrouve
dans la plaquette à la suite de Phrases. Départ
et Royauté, qui figurent l'un à la suite de l'autre sur le
même feuillet que Vies III, se retrouvent respectivement
après Ville et Antique. Matinée d'ivresse,
copié à la suite de À une raison,
se retrouve après Nocturne vulgaire. Etc., etc. [17]
Cet ensemble de faits suscite un sérieux
doute sur la part réelle prise par Félix Fénéon à la première
mise en forme des Illuminations. Il en est de même en ce
qui concerne la pagination des vingt-trois premiers feuillets.
On lui attribue généralement la paternité de cette opération
bien qu'il ne l'ait pas formellement revendiquée. En effet, dans
sa lettre du 19 avril 1939 à Bouillane de Lacoste, Fénéon
écrit :
"Le ms. mavait été remis sous les
espèces dune liasse de feuilles de papier tout rayé quon
voit aux cahiers décole. Feuilles volantes et sans
pagination, un jeu de cartes [...]"
Bouillane de Lacoste lui
apprend alors qu'il a sous les yeux un manuscrit paginé de 1 à
24
(celui qui
est aujourd'hui archivé par la BNF sous la côte
NAF14123, alors propriété du docteur Lucien Graux, et qu'on
a bien voulu, en 1939, pour la première fois depuis des
décennies, prêter à un chercheur rimbaldien).
Nous n'avons malheureusement pas les lettres de Bouillane de
Lacoste, mais l'on devine aux réponses de Fénéon ce qu'ont du
être les questions de l'universitaire. Fénéon ayant déclaré
n'avoir reçu de Kahn que des "feuilles volantes et sans
pagination", Bouillane de Lacoste a dû lui demander s'il avait
lui-même numéroté les feuillets car, dans le cas contraire, il
faudrait supposer que cette pagination pourrait émaner de
Rimbaud lui-même. Ce à quoi Fénéon, étonné, répond de la manière
la plus floue dans sa lettre suivante (datée du 30 avril 1939) :
"Votre ms. est-il paginé (et d'une
pagination qui soit antérieure à 1886, époque où il se peut
fort bien que je l'aie paginé pour l'impression) ?"
Il y a là, avouons-le, de
quoi alimenter notre scepticisme. |
|
[18]
Arthur Rimbaud,
Paul Verlaine. Un concert d'enfers. Vies et Poésies, édition
établie et présentée par Solenn Dupas, Yann Frémy et Henri Scepi,
Quarto Gallimard, 2017, p.1014.
[19] Voir notamment son article "Les Illuminations
manuscrites", Histoires littéraires n°1, 2000,
p.5-31.
[20] André Guyaux,
Arthur Rimbaud,
Illuminations, À la Baconnière,
1985, p.8.
[21]
Guyaux, ibid. p.9
|
|
Ce scepticisme, cependant, n'effleure pas certains éditeurs
de l'uvre, même parmi les plus récents, qui restent convaincus
de la paternité de Fénéon. Le dernier en date, Henri Scepi, écrit par exemple :
"[...] prêté notamment à
Charles de Sivry, il [le manuscrit] s'égare avant de
parvenir à Gustave Kahn, rédacteur en chef de la revue La
Vogue en 1886. Félix Fénéon se charge d'ordonner le
manuscrit en veillant à bien associer les versos avec les
rectos qui lui paraissent suivre immédiatement."
[18]
Le lecteur méritait d'en
apprendre un peu plus sur cette affaire que cette
mystérieuse association des "versos" (!). On aurait
dû, pour le moins, l'informer des travaux où Steve Murphy
conteste, sur la base d'une étude de la foliotation partielle
des manuscrits, la responsabilité de Fénéon dans l'agencement
proposé par La Vogue (revue) pour les deux premiers tiers du texte des
Illuminations [19]. André Guyaux lui-même, dans sa thèse de 1985,
bien que fortement enclin à cautionner le témoignage de Fénéon, émettait quelque doute.
Dans l'introduction
de son édition 1985 des Illuminations [20], André
Guyaux écrivait :
"Même si Félix Fénéon, le premier éditeur des
Illuminations, en 1886, a expliqué en 1939 à Bouillane de
Lacoste qu'il avait arrêté lui-même l'ordre des textes et
numéroté les feuillets, il reste un doute sur l'attribution de
ce classement et l'éditeur moderne n'est guère enclin à renoncer
à l'ordre désormais inscrit sur les manuscrits consultables
aujourd'hui à la Bibliothèque Nationale. C'est pourtant à cet
ordre que je renonce ici."
Comme Steve Murphy
eut beau jeu de le lui
faire remarquer, s'il subsistait à ses yeux une possibilité, même minime, que
la numérotation des 23 premiers feuillets des llluminations
pût être attribuée à Rimbaud et non à Fénéon, la prudence philologique aurait exigé de la
respecter. Mais Guyaux souhaitait démontrer (voir :
Question 4,
ci-dessus) que Les Illuminations manquent d'un plan
d'ensemble, que "deux forces, l'une liante, l'autre déliante"
[21], se sont combattues chez l'auteur, la première
l'incitant à rechercher des enchaînements, la seconde à recopier
ses poèmes dans un ordre aléatoire sur ses "feuillets volants"
(selon le mot de Fénéon). Aussi plaçait-il en tête de son
édition ce que Rimbaud a manifestement classé (1°/ les
« poèmes
groupés », les suites numérotées, 2°/ les « poèmes consécutifs
sur plusieurs feuillets », 3°/ les « poèmes consécutifs sur un
seul feuillet ») et il reléguait en fin de recueil les « poèmes
isolés sur un seul feuillet ». Ce qui bouleversait
complètement l'ordre des Illuminations pratiqué jusque
là.
Steve Murphy a longuement guerroyé contre cette façon
de faire.
Non sans
succès, semble-t-il, car, comme nous l'avons déjà indiqué (question 4),
André Guyaux est revenu
dans sa récente édition des uvres complètes à l'agencement de
Mouquet et Rolland de Renéville. Murphy pense que la numérotation
des 23 premiers feuillets des Illuminations ne peut
émaner que de Rimbaud. Il appuie notamment sa démonstration sur
les particularités des folios 12 et 18. D'abord, ils
sont d'une taille réduite par rapport aux autres pages
numérotées (à la suite d'opérations de découpage décrites avec
précision par Guyaux lui-même). Autre particularité commune, les
nombres 12 et 18 sont inscrits sur leurs feuillets respectifs d'une
façon qui contraste avec le style graphique uniformément utilisé
pour numéroter tous les autres. Enfin, il est aisé de comprendre que
tous deux ont été insérés après coup afin de constituer des séries (Phrases
pour le f° 12 et Veillées pour le f° 18). Exemple
ci-dessous pour le f° 18 (mais on verra mieux ça en se
reportant au fac-similé
NAF 14123 de la BNF) :
|
|
Feuillet 18 |
Feuillet 19 |
 |
 |
|
Le feuillet 18 présente des
dimensions réduites (± 10 x 15 cm)
qui correspondent à une feuille de 20 x15 coupée en deux
(papier non vergé). Il s'emboîte exactement avec le
feuillet non numéroté contenant Fairy (cf. Guyaux, Poétique du fragment, p.94).
Le nombre "18" est
inscrit à l'encre et souligné d'un trait oblique. |
Le feuillet 19 (± 20
x 13 cm) présente les mêmes dimensions que la
plupart des autres feuillets numérotés (papier vergé).
Toutes les pages sauf la 12 et la 18 sont numérotées sur
le modèle du "19" qu'on aperçoit ci-dessus,
inscrit au crayon et isolé par un
trait arrondi dans l'angle supérieur
droit du feuillet.
|
|
|
|
|
Quelqu'un a visiblement ôté les deux feuillets
précédemment numérotés 12 et 18, dans le style original, pour y
substituer ces nouveaux feuillets d'allure atypique. Ce quelqu'un
aurait pu être Fénéon, mais Murphy juge cette éventualité très peu
vraisemblable.
Le raisonnement de Murphy est assez convaincant. La
logique en est simple :
1) Il existe une pagination au crayon de 1 à 24 des 2/3 des poèmes,
ceux qui ont été publiés dans les n°5-6 de La Vogue.
2) Cette pagination au crayon souffre deux exceptions : les f°12 et
18, dont les numéros ont été portés directement à l'encre, dans un
style graphique nettement différent de celui des autres feuillets.
Les chiffres au crayon 1-9 ont été repassés à l'encre, probablement
par les préparateurs de La Vogue pour valider une
liste de titres à insérer dans le n°5 (voir ci-après), mais le débat
sur ce point de détail ne devrait pas interférer, selon nous, avec
le débat général sur le caractère auctorial ou pas de la pagination
des feuillets.
3) La cause des exceptions constituées par les f° 12 et 18 est claire : on a voulu construire
des séries (Phrases, Veillées) qui n'avaient pas
été prévues dans un premier temps. Cette opération s'est donc à
l'évidence déroulée après la pagination au crayon. Il y a
eu forcément auparavant un autre f°12 et un autre
f°18 paginés au crayon qui se sont vus substituer les f°12 et 18 que nous connaissons.
4) La différence constatée dans le graphisme vient de ce que la
personne qui a effectué l'opération, qu'elle soit la même ou une
autre que celle qui a effectué la pagination au crayon, ne s'est
pas souciée d'imiter le style de numérotation précédemment
utilisé pour le reste des feuillets.
5) L'opération substitution a pu être entreprise soit par Rimbaud,
soit par La Vogue. Si elle a été faite par Rimbaud, la
pagination au crayon étant, comme on l'a vu, forcément
antérieure à ce geste, cette pagination est de Rimbaud. La
question est résolue et on n'en parle plus. Si elle a été faite
par La Vogue, le doute reste entier.
6) Toute la question revient donc à savoir s'il est possible que la
décision de constituer une série comme Veillées I-II-III
ait été prise par Fénéon ou par l'équipe de La Vogue.
Murphy tente par conséquent d'imaginer, pour mieux pouvoir le
réfuter, un
scénario justifiant la thèse contraire à la sienne, c'est-à-dire la
possible attribution de la pagination aux gens de La Vogue. Une hypothèse envisageable serait que Fénéon, ou tout autre
membre de l'équipe de La Vogue, après avoir paginé les vingt-trois feuillets destinés aux numéros 5 et 6 de
la revue, se soit avisé que la pièce portant l'inscription "Veillée III"
exigeait devant elle le feuillet intitulé "Veillées"
contenant deux pièces numérotées "I" et "II", puis ait corrigé son
erreur. Mais un tel scénario paraît à Murphy fortement
invraisemblable. Si l'on peut à la rigueur imaginer, dit-il, qu'un
éditeur (Fénéon, Kahn, d'Orfer
ou autres) ait glissé tardivement, une fois sa numérotation
effectuée, l'actuel feuillet 12 à la suite du feuillet 11 portant le
titre Phrases, en raison de la ressemblance structurelle entre les textes brefs
contenus des deux feuillets, il est impossible que ce même éditeur,
par distraction, n'ait pas vu dès le
départ
que les trois "Veillées" constituaient une série et
qu'il ait été
contraint à remplacer après coup son ancien feuillet 18 par le
manuscrit des Veillées I et II. Il est donc plus que probable
que c'est Rimbaud lui-même qui a opéré la
solution de continuité que nous observons dans la numérotation
uniforme du manuscrit, qui a inscrit les nombres 12 et 18 tels que
nous les voyons, à l'encre pour bien manifester sa décision
définitive de les placer là, ce qui tend à démontrer que cette
numérotation uniforme, par définition antérieure à l'opération
substitution, est due aussi à Rimbaud.
|
|
[22] Pour connaître les
principaux arguments opposés à Steve Murphty se reporter notamment
aux contributions de Jacques
Bienvenu : pages du
12 février 2012, du
6 mars 2012, du
18 décembre 2019 du blog Rimbaud ivre, et de David Ducoffre : pages du
7 décembre 2019 et du
21 décembre 2019 du blog Enluminures (painted
plates). |
|
Le feuillet 18
occupe une place stratégique dans le plaidoyer en faveur d'une
pagination auctoriale, il est la pièce centrale d'un scénario de
genèse de la série Veillées qui, si on y adhère, conduit
fatalement à cette conclusion. L'ayant bien compris, et probablement convaincu que le contre-scénario de la distraction, réfuté
d'avance par Murphy, ne fonctionne pas, Jacques Bienvenu s'est
employé à en imaginer
un autre :
"Pour
ma part, je pense que le regroupement des deux Veillées
de la page 18 avec Veillée de la page 19 a été fait
par Fénéon qui a pu rajouter à lencre le chiffre romain III
(voir notre illustration qui montre que deux autres III
écrits par Rimbaud sur dautres feuillets sont plus espacés)
et qui a pu barrer à lencre le mot Veillée. Fénéon
navait-il pas dit quil avait tenté de donner un ordre
logique aux feuillets ? Rimbaud dailleurs na pas cru bon
de regrouper les deux poèmes Villes du même nom avec
celui de Ville au singulier" (blog
Rimbaud ivre, page du
6 mars 2012) [22].
En
somme, comme il l'a fait avec ses poèmes intitulés Ville
et Villes, Rimbaud aurait pu laisser
coexister parmi ses manuscrits parvenus à La Vogue au
printemps 1886 deux feuillets portant respectivement les titres
Veillée et Veillées. Devant quoi Fénéon (ou les
autres
préparateurs de L.V.) auraient décidé de
regrouper les poèmes,
barrant eux-mêmes le titre singulier et inscrivant le III en chiffres
romains.
Ce nouveau scénario alternatif, à mon humble avis, n'est pas plus
vraisemblable que le précédent.
Un première remarque : le dénommé "feuillet 18" n'est
pas, en réalité, un feuillet comme les autres. Si le scénario
suggéré par Bienvenu était exact, la série Veillées I-II
se serait probablement présentée sur une feuille de 20x13 sur
papier vergé (comme la plupart des vingt-trois premiers
feuillets des Illuminations) ou de 20x15 sur papier
non-vergé (comme la plupart des feuillets non numérotés des
Illuminations). Mais tel n'est pas le cas. André Guyaux a montré que ce
bout de papier (comme il vaudrait mieux l'appeler) a été obtenu par sectionnement
d'un feuillet préexistant, qui porte le poème Fairy (cf.
l'illustration ci-après).
|
| |
15 cm
|
|
| 10,7 cm |
 |
10,1 cm |
| 9,3 cm |
 |
9,9 cm |
| |
Feuille de papier non vergé "blanc-beige" de 15x20 cm.
Mesures données dans
Illuminations. Texte établi et commenté
par André Guyaux,
À la Baconnière, 1985, p.281 et 287. |
|
|
|
|
|
Calligraphié dans une
écriture ronde de type sinistrogyre, Fairy relève d'un type d'écriture antérieur à
l'écriture de type dextrogyre (c'est-à-dire fortement penchée vers
la droite) que l'on observe dans Veillées I-II. Rimbaud a donc
sectionné ce feuillet normal préexistant et copié les deux premiers poèmes
de Veillées en basculant la demi-feuille obtenue. Cela semble
prouver que Rimbaud a conçu dès le départ cette copie non comme un
feuillet à l'égal des autres mais comme un encart, une "paperolle"
à la Proust comme il y en a quelques autres parmi les derniers
feuillets (Guerre, Jeunesse I), à situer à un endroit
précis de son manuscrit. Il me paraît donc invraisemblable
que Fénéon ou autres gens de La Vogue aient pu rencontrer un
feuillet 19 comportant un Veillée non barré. Rimbaud a
certainement tracé lui-même le III en chiffres romains et barré le
titre au singulier devenu caduc dès lors qu'il avait prévu de le
faire précéder de l'encart préparé dans ce but, portant un début de
série intitulé Veillées I-II.
Deuxième remarque. Il est vrai que Rimbaud a laissé subsister dans
son manuscrit un poème intitulé
Ville et deux autres intitulés Villes. Mais d'une part,
Ville désigne une ville réelle et bien identifiée. C'est
Londres. Tandis que les Villes sont toutes deux à leur
manière des fictions de villes, des villes d'utopie et de contre-utopie respectivement. La séparation entre Ville d'un
côté, et les deux Villes de l'autre est donc thématiquement
justifiée. D'autre part, on sait que Rimbaud voulait présenter les
deux Villes comme une série numérotée I-II, sous un titre unique, et
que seule une
erreur intervenue pendant le processus de transcription l'en a
empêché, sauf à devoir recopier des pages entières. Il n'y a eu dans
cette circonstance de sa part ni propos délibéré, ni aucune sorte d'oubli
ou de négligence, comme ce serait
le cas s'il avait laissé disjoints dans son manuscrit,
volontairement ou par distraction, un Veillée
au singulier et un Veillées au pluriel.
Troisième remarque.
Le ou les concepteurs de la publication des Illuminations
dans le périodique La Vogue ont systématiquement suivi
l'ordre impliqué par les enchaînements et chevauchements de textes
pratiqués par Rimbaud. On peut dire qu'ils se sont montrés,
de façon générale, assez respectueux du manuscrit de
Rimbaud. Capables certes, par négligence, d'oublier deux titres de
poèmes. Mais de là à biffer de leur propre initiative un titre
inscrit de sa belle plume par l'auteur ! Est-il
vraisemblable que cette équipe de La Vogue se soit engagée dans la confection d'une série
numérotée (comme ce Veillées I-II-III) qui n'aurait pas été
explicitement indiquée par le manuscrit ?
La genèse de Veillées I-II-III
imaginée par Bienvenu ne peut certes pas être catégoriquement
rejetée. Elle est du domaine du possible. Mais elle est fortement
invraisemblable. Encore moins probantes sont, selon mon opinion, les
objections de caractère graphologique opposées par le même critique
à la thèse murphienne sur le feuillet 18 : "L'analyse
graphologique, écrit Bienvenu le 6 mars 2012, montre que les numéros
paginés à lencre, notamment le 12 et le 18, nont aucun caractère
rimbaldien." Raison pour laquelle ce ne peut être Rimbaud, mais
Fénéon ou quelque autre membre de La Vogue, qui ont constitué
les séries Phrases et Veillées et tracé les numéros des
feuillets concernés.
Ce seraient donc le "2" de "12" et le "8" de "18" qui poseraient
problème. Petite démonstration illustrée du contraire. D'abord pour le "2" . À
gauche, le feuillet 12 des Illuminations. À droite, quelques
autres "2" rimbaldiens :
Commentaire : la graphie des
chiffres, pour un individu donné, est généralement variable.
Parmi les quatre exemples reproduits à droite ci-dessus, le
premier, tiré d'une lettre à Izambard de 1870, très
appliquée, contient un "2" qui, d'après mes observations
(superficielles, je l'avoue), est rare chez Rimbaud : un "2"
à la graphie ferme, calligraphiée. Les "2" rimbaldiens sont
majoritairement d'un tracé mou, peu articulé, comme on voit
dans les trois autres exemples et ... sur le feuillet 12 des
Illuminations. CQFD.
Passons au "8" du feuillet "18". Bienvenu écrit le 6
mars 2012 : "il
sagit dune forme classique de 8 exécutée par des
personnes qui commencent la boucle du haut dans le sens
contraire des aiguilles dune montre et qui viennent
terminer le 8 par un trait au lieu de fermer la boucle. Il
faut dire que les 8 se comptent par dizaines sur les lettres
de Rimbaud quand on songe aux lettres des années
1871-1872-1873 etc. Il ny a pas dexemple chez Rimbaud dun
tel 8."
Nouvelle démonstration illustrée. À gauche, le
feuillet 18 des Illuminations. À droite, quelques
autres "8" rimbaldiens :
Commentaire. Je me répète : la graphie des chiffres, pour un
individu donné, est généralement variable. Les "8" de Rimbaud
n'échappent pas à la règle. Un exemple caractéristique : le
premier de ceux reproduits ci-dessus, tiré d'une lettre de
Rimbaud à sa famille, envoyée de Chypre en 1880, montre côte à
côte un "8" que nous appellerons "à boucle supérieure ouverte",
type du feuillet 18 des Illuminations, et un "8" "à
boucle supérieure fermée". D'après mes observations
(superficielles, je l'avoue à nouveau), les deux types sont
représentés à parité dans les nombreuses dates apposées par
Rimbaud en tête de ses lettres et au bas de ses poèmes. Donc,
contrairement à l'affirmation imprudente de Bienvenu, les "8"
semblables à celui du feuillet 18 sont innombrables. On en voit
quelques-uns, bien caractéristiques, ci-dessus.
Sur un point cependant, les objections de Bienvenu et
de Ducoffre à la thèse de Murphy me paraissent fondées : leur
attribution à La Vogue et non à Rimbaud des chiffres repassés
à l'encre des feuillets 1 à 9. Le 7 à hampe barrée tracé à l'encre du feuillet 7
est en effet, comme l'a dit Bienvenu, assez peu rimbaldien (j'en ai
repéré seulement quelques-uns dans la correspondance africaine de
Rimbaud). C'est un indice convaincant de ce que ce 7 à
l'encre surchargeant le 7 précédemment inscrit sur le
manuscrit, émane de La Vogue. Je fais cependant remarquer que
ce premier "7" tracé au crayon était "non-barré", comme
d'ailleurs le "7" du feuillet 17. La présence de ces "7"
typiquement rimbaldiens ne suffit certes pas à prouver que la
numérotation au crayon soit de Rimbaud, mais elle devrait
indiquer à Bienvenu, qui accorde tant d'importance à la forme
des chiffres, que Fénéon s'il est l'auteur du 7 à hampe barrée
ne saurait être tenu simultanément pour l'auteur de la
pagination au crayon. Ceci étant, l'hypothèse
exposée par David Ducoffre, selon laquelle ces chiffres à l'encre
auraient été apposés par léquipe de La Vogue pour valider la
liste des titres destinés à être publiés dans dans le n°5 de la
revue, est convaincante : la mention allographe "Arthur Rimbaud"
en bas du feuillet 9 (Vies III - Départ -Royauté) est un indice
convergent à prendre en considération,
de même que les traces de salissure au dos du feuillet 9 semblant
indiquer que ce feuillet a servi de couverture à une série de
feuillets comme l'avait déjà indiqué André Guyaux. Ducoffre a sûrement raison de supposer qu'il y a eu de la part de
La Vogue un premier choix de 9 publications suivi dun
changement d'option les ayant amenés à publier 14 textes dès la
première série de leur feuilleton Rimbaud de mai-juin 1886
(cf. la même page du
blog Rimbaud ivre,
6 mars 2012).

Dont acte.
Mais il n'y a rien là qui remette en cause ni
l'argument clé de Murphy concernant les feuillets 18 et 12, ni la
possibilité que la pagination à l'encre des feuillets 18 et 12
soient de la main de Rimbaud, ni la possibilité que la pagination au crayon
des feuillets 1-11, 13-17, 19-24
soit elle aussi de la main de Rimbaud.
Retour haut de page |
6) Les
Illuminations ont-elles
une "idée principale" ?
|
|
[23] Arthur Rimbaud, Les
Illuminations, préface de Paul Verlaine, La Vogue, 1886.
[24] Lettre à Charles de Sivry du 16? août 1878, déjà citée, cf. note 6.
Verlaine ne referme pas la parenthèse dans : (ainsi que sa
« Saison en enfer »[)]. Nous corrigeons, entre crochets. Ce
détail a son importance parce qu'il a fait croire que Verlaine
confondait Vagabonds, pièce des Illuminations,
où il est effectivement qualifié de "satanique docteur", avec le
chapitre Vierge folle. L'époux infernal d'Une saison
en enfer. Il n'en est rien.
[25] Michel Murat,
L'Art de Rimbaud, Corti, 2013, p.213-238.
[26] "Remarques sur
l'obscurité" in Rimbaud, le poème en prose et la traduction
poétique, éd. Serge Sacchi, Gunter Nar Verlag -Tübingen,
1988, p.11-17. |
|
Verlaine,
dans sa préface aux Illuminations [23], déclare qu'il ne
voit pas d'idée principale dans le recueil :
"Didée principale il ny
en a ou du moins nous ny en trouvons pas. De la joie
évidente dêtre un grand poète, tels paysages féeriques,
dadorables vagues amours esquissées et la plus haute
ambition (arrivée) de style :
tel est le résumé que
nous croyons pouvoir oser donner de louvrage ci-après. Au
lecteur dadmirer en détail."
On remarquera
cependant qu'après avoir nié la
présence d'une idée directrice, Verlaine
lui-même identifie deux thèmes (les "paysages féériques",
l'"amour"). Dans une lettre à Sivry, il parle
aussi de "zolismes d'avant la
lettre" :
"Avoir relu « Illuminations »
(painted plates) du Sieur que tu sais (ainsi que sa « Saison
en enfer »[)], où je figure en qualité de Docteur Satanique.
(Ça c'est pas vrai !). Te le reporterai vers 8bre.
Dangereux par les postes. Choses charmantes dedans
d'ailleurs, au milieu d'un tas de zolismes d'avant la
lettre, par conséquent inavouables."
[24]
C'est
sans doute à des textes évoquant
la sexualité que pense
Verlaine (Antique, Being Beauteous, "O la
face cendrée...", Bottom, H, Dévotion et quelques
autres), certains (comme Ouvriers et Vagabonds) y
ajoutant une touche misérabiliste qui peut passer en effet
pour du naturalisme avant la lettre. Ces remarques de Verlaine
sont volontairement rapides et
vagues, mais elles indiquent une voie d'exploration possible
de l'uvre,
de nature à en dégager par un autre biais la cohérence, celle de la
"lecture transversale". La critique, notamment Michel Murat dans
son Art de Rimbaud, a mis en évidence dans le recueil
la présence de réseaux, voire de séquences thématiques. Démonstration tout à fait convaincante.
Autant dire qu'à condition
de ne pas s'attendre à une "architecture", d'accepter
une structuration un peu lâche au sein de laquelle certains
textes s'insèrent moins bien que d'autres, on peut repérer dans
Les Illuminations, telles qu'elles nous sont parvenues,
non seulement une "idée principale" mais aussi un
principe de composition
fondé sur cette idée, dont la
perception plus ou moins facile, parfois subliminale, fournit des cadres de lecture
pertinents.
Dans ce qui suit, j'emprunte beaucoup au
livre cité de Michel Murat [25], mais il ne s'agit
pas d'un "résumé", je propose une segmentation
différente. Je suis moins sensible que lui à ce qu'il
appelle les "liens de voisinage" (ibid. p.223), c'est-à-dire les
reprises de mots suggérant au lecteur une forme de concaténation
entre textes voisins. Je recherche davantage les vastes
regroupements thématiques. Bien sûr, il y a quelque chose de très conjectural
et artificiel dans cette méthode. Je suis très conscient de
pratiquer là un exercice de funambulisme interprétatif sans
valeur scientifique. Mais la démarche est attrayante et, pour le
reste, le
lecteur jugera.
L'identification de séquences thématiques dépend
étroitement du sens que l'on se croit en capacité
de donner à chacune des proses des Illuminations. Aussi eût-il été souhaitable,
dans les lignes qui suivent, de pouvoir préciser comment je
comprend les pièces mentionnées. Il n'en était naturellement
pas question. Mais, un grand nombre de poèmes
étant analysés dans mon
anthologie
commentée, le lecteur aura tout loisir de s'y reporter pour
vérifier la cohérence des regroupements effectués
ici avec les interprétations que je propose par ailleurs.
Pour quelques poèmes importants absents de cette anthologie,
je développe mes explications un peu plus longuement que
je ne le fais pour la majorité des textes.
Une dernière remarque parmi ces préliminaires. On s'étonne peut-être que, dans ce panorama des questions
habituellement posées au sujet des Illuminations, je ne
fasse aucune place au débat récurrent et envahissant sur leur
obscurité. On
sait que quelques auteurs prétendent les Illuminations
"illisibles". Le problème, disent-ils, face au texte
de Rimbaud, n'est pas qu'on manque de solutions interprétatives,
à condition d'en passer par une lecture symbolique, mais au
contraire d'en rencontrer tant de possibles qu'elles en
deviennent suspectes. Le lecteur serait ainsi mis dans la
situation sans issue de devoir les accepter toutes ou bien
aucune. Tout n'est pas faux dans ce constat, mais cela ne doit
pas nous empêcher d'essayer de comprendre. Je ne partage
pas là-dessus le défaitisme de Tzvetan Todorov lançant à ses
"collègues" rimbaldiens :
"Laissons tranquilles le pavillon en viande saignante, les
feux à la pluie du vent de diamants et le 'mais plus
alors' ; renonçons à l'acharnement herméneutique (comparable
à l'acharnement thérapeutique mais à effet inverse) qui nous
mène à réduire ces phrases à des banalités ; il n'y a là
aucun obscurantisme. Les énergies ainsi libérées pourront
trouver, j'en suis certain meilleur usage." [26]
Nous
sommes quelques uns à refuser d'obtempérer à cette suggestion sarcastique. Les textes des
Illuminations sont souvent obscurs, c'est vrai, leur interprétation
divise fréquemment les meilleurs exégètes mais, sur ce plan
aussi, la recherche a permis d'obtenir certains progrès dans la
compréhension des textes, de
réduire les zones d'illisibilité, d'élargir les consensus. Et,
pour le reste, nous prenons le risque d'avancer nos propres
hypothèses de sens, si subjectives et fragiles soient-elles.
Car, enfin, quand nous parcourons les Illuminations, nous
avons le plus souvent l'impression de comprendre quelque chose
de ce que Rimbaud y a voulu dire et c'est cette expérience de lecture que nous invitons
nos lecteurs à partager.
|
|
[27] cf. ibid.
p.218-222
[28] Dans son traité de 1808,
Théorie des quatre mouvements et des destinées générales
(p.157-158 dans la version numérisée indiquée).
La thèse est reprise dans
Le Nouveau Monde amoureux. Voir aussi le
résumé humoristique de l'utopie fouriériste dans
Bouvard et Pécuchet.
|
|
 f° 1-5
- Enfance. Mise en place d'un encadrement autobiographique
enfance / jeunesse
("autofictionnel" ou "automythographique" seraient sans doute
des mots plus justes) : f° 1-5
- Enfance. Mise en place d'un encadrement autobiographique
enfance / jeunesse
("autofictionnel" ou "automythographique" seraient sans doute
des mots plus justes) :
Le début du recueil est un retour sur l'enfance. D'une
part, avec les cinq
poèmes en série d'Enfance. D'autre part, avec Après le
Déluge, que "quelqu'un" Rimbaud selon les uns, Fénéon
selon les autres a tenu à placer en tête des Illuminations.
"Une porte claqua [...]" raconte le texte.
Et "l'enfant" qui, "dans la grande maison de vitres encore
ruisselante", ne connaissait du monde que "les merveilleuses
images" voit s'ouvrir devant lui "l'univers sans images" (Jeunesse
II, Sonnet). On comprend que ce personnage, répondant
allégorique du poète, ayant claqué derrière lui la porte de
l'école ou de la maison familiale, s'élance, enfin libre, "sous
l'éclatante giboulée". On trouve une autre évocation, rédigée en
termes voisins, de ce moment mythique du "départ dans
l'affection et le bruit neufs" au début de Génie :
"Il
est l'affection et le présent puisqu'il a fait la maison ouverte
à l'hiver écumeux et à la rumeur de l'été"
C'est le moment d'une nouvelle naissance à l'échelle
individuelle, que le poème inscrit dans l'évocation du Déluge,
récit emblématique d'un autre recommencement, collectif
celui-là, celui de
l'humanité, et, probablement aussi, de
façon cryptée, celui de la société française après l'écrasement
de la Commune (la "semaine sanglante").
Le sujet lyrique qu'on entend dans les Illuminations est
un de ces "poètes troyens" dont parle le palestinien
Mahmoud Darwich (et, après lui, le chilien
Roberto
Bolaño, alias Arturo Belano), ceux dont le chant s'origine
dans le souvenir de la catastrophe.
Après le
Déluge recueille le souvenir d'un
"printemps" : "Puis, dans la futaie violette, bourgeonnante, Eucharis me dit que c'était le printemps". Pour
Rimbaud, il s'agit sans doute d'évoquer, sur
un plan symbolique, ce qu'on appelle traditionnellement le
printemps de la vie, l'entrée dans l'adolescence. On pense
irrésistiblement à la lettre à Théodore de Banville du 24 mai
1870 :
"Cher Maître,
Nous sommes aux mois d'amour ; j'ai presque dix-sept
ans. L'âge des espérances et des chimères, comme on dit,
et voici que je me suis mis, enfant touché par le
doigt de la Muse, pardon si c'est banal, à dire mes
bonnes croyances, mes espérances, mes sensations, toutes
ces choses des poètes moi j'appelle cela du printemps
[...]."
Ce début aura son répondant à la fin du recueil tel
qu'il nous a été transmis : les pièces finales des Illuminations évoquent la
"jeunesse". Le mot "jeunesse" apparaît déjà dans Angoisse,
poème qui
n'est pas très éloigné des trois titres conclusifs
Génie-Jeunesse-Solde : "Jeunesse de cet être-ci ; moi !".
Mais le thème est surtout développé dans les quatre poèmes
coiffés par le titre Jeunesse : Dimanche, Sonnet,
Vingt ans, "Tu en es encore à la tentation d'Antoine...".
Par sa signification générale (englobant enfance, adolescence,
accession au statut de "jeune femme" ou de "jeune homme"), le
mot "jeunesse" annonce l'idée d'un bilan d'ensemble.
Il suggère le regard rétrospectif posé sur tout un passé, des "journées
enfantes" (Jeunesse II) jusqu'à l'âge de "Vingt ans"
(titre de la troisième section de Jeunesse). Un regard
posé par l'auteur sur toute une période de sa
vie à partir du moment présent, point de bascule vers la vie
adulte (Rimbaud a eu vingt ans le 20
octobre 1874). C'est
le moment, pour le sujet, de dépasser la crise d'adolescence :
"L'ébat du zèle écourté, les tics d'orgueil puéril,
l'affaissement et l'effroi" (Jeunesse IV). "Ah! l'égoïsme
infini de l'adolescence" (Jeunesse III, "Vingt
ans"). On se rappelle aussi la formule par laquelle Dévotion
donne congé à l'adolescence ("À l'adolescent que je fus").
Et, bien sûr, entre ce début de recueil et cette fin,
on trouve une quantité de poèmes d'allure autobiographique comme la série des Vies, le cycle
des Villes, etc. On y reviendra.
La prégnance du principe autobiographique dans la
lecture des Illuminations a été depuis longtemps établie
par André Guyaux : "Les feuillets 2, 3, 4 et 5 (Enfance)
et les feuillets 8, 9 (Vies-Départ)
sont la base du recueil". De la part du théoricien de la poétique du
fragment, la formule fait mouche. Car enfin, si le "recueil" a une "base",
c'est tout de même que cette somme de "fragments" que sont les
Illuminations possède une unité. "Entre
Enfance et
Vies, lit-on quelques lignes plus loin (p.79 de Poétique
du fragment) la
continuité thématique est envisageable, mais plus apparente dans les
titres qu'à la lecture des textes.
Départ prolonge alors la ligne conduisant d'Enfance
à
Vies. Trois étapes d'une chronologie autobiographique."
Michel Murat, complémentairement, fait remarquer que parmi les premiers
poèmes des
Illuminations, plusieurs ont pour fonction la mise en place d'un "cadre
générique".
Rimbaud accumule au début du recueil des textes assimilables
aux genres de l'énigme ("j'ai seul la clé de cette parade
sauvage") et de l'apologue (le conte merveilleux à contenu
philosophique, la fable aussi, mais "dissociée de sa visée
axiologique et de son rôle social"). Ces pièces préparent le
lecteur à recevoir l'uvre comme "une école de lecture" [27].
Il cite notamment Parade et Conte. Mais on peut en dire tout
autant d'Après le Déluge. Ce poème liminaire, en même temps qu'il introduit au thème de l'enfance, présente
l'intérêt d'offrir à la perspicacité du lecteur un triple niveau de signification :
celui de la fable de portée générale (réécriture d'un mythe
fondateur, pastiche des genres du conte et du récit biblique), celui de
l'allégorie politique liée à l'actualité (évocation cryptée des
lendemains de la Commune), celui enfin du mythe personnel (motif de
"l'enfant" que l'on retrouve explicitement aussi bien
dans Après le Déluge que dans Enfance IV). Il convenait que le lecteur soit initié d'emblée
au protocole de lecture complexe qu'impose le type d'objet littéraire
représenté par les Illuminations. En effet, la
construction du mythe personnel à travers la parodie des genres littéraires les
plus divers est un procédé constant du recueil : Ouvriers
est à la fois un pastiche de roman naturaliste et une évocation
cryptée de la vie commune avec Verlaine ; Villes
("L'Acropole ...") tient du récit d'anticipation et du carnet
d'impressions londoniennes ;
Conte,
Royauté, Aube empruntent au genre du conte (oriental ou
merveilleux) et renvoient en même temps au mythe personnel ;
Vies mêle l'allusion autobiographique à la caricature des
auteurs de Mémoires dont il raille les outrances
égotistes ; Dévotion cache sous l'apparence d'une litanie d'ex-voto
une sorte de bilan affectif ; H, en style de devinette,
célèbre plus particulièrement l'une des "dévotions" évoquées
dans le poème précédent ; Barbare, parodie du genre
apocalyptique, s'achève sur une transe plus orgastique que
mystique (s'agit-il du "rut de la planète" célébré
par Fourier [28] ou d'une évocation d'ordre plus intime,
ou des deux ?) ; Génie et Solde, enfin, développent des
thèmes rimbaldiens typiques dans la forme rhétorique de l'hymne
sacré et de la harangue de camelot, respectivement. Comme
on peut maintenant le comprendre, le poème initial Après le
Déluge, qui présente par excellence cette même
caractéristique d'un double ou triple niveau de signification,
procède mieux que tout autre
à ce que Michel Murat appelle un "réglage de la lecture".
|
|
[29] Au delà même de cette partie des f°5 à 12, c'est dans l'oscillation
entre le congé donné au passé et une incurable nostalgie que
réside le ton spécifique des Illuminations. Cf. la
clausule de Villes, "Ce sont des villes..." :
"Quels bons bras, quelle belle heure me rendront cette région
d'où viennent mes sommeils et mes moindres mouvements ?". Le sujet lyrique a beau se
vouloir "loin des anciens assassins", il a beau se croire "remis des vieilles
fanfares d'héroïsme", il est bien obligé de s'avouer qu'elles
lui "attaquent encore le cur et la
tête" (Barbare), il se décrit
sujet à "la visite des souvenirs" (Jeunesse I) et à
l'apparition fantomatique du "pavillon en viande saignante sur
la soie des mers et des fleurs arctiques" (qui "n'existent
pas"). |
|
 f°5
(Conte) - f°12 - Le temps des assassins (retour sur
l'entreprise du voyant). f°5
(Conte) - f°12 - Le temps des assassins (retour sur
l'entreprise du voyant).
Passé le temps de l'enfance, s'est ouvert pour Rimbaud le
"temps des assassins". J'entends par là, dans la perspective qui
est celle de Matinée d'ivresse, le temps de l'aventure
poétique, celui de l'entreprise du voyant. Pour être centrée sur
la question métaphysique, la pensée de Rimbaud autour des années
1873-1875, telle qu'on peut la dégager d'Une saison en enfer ou des Illuminations, n'en est pas moins d'une grande
simplicité. La conscience contemporaine, dont l'artiste, le
poète, sont l'expression la plus intense et la plus
malheureuse, reste orpheline de l'espérance d'éternité. Le
sujet "moderne", libéré de la superstition, reste "esclave de son baptême". Comme le Prince de Conte,
il veut, il espère encore "voir la
vérité, l'heure du désir et de la satisfaction essentiels".
Mais, n'attendant plus rien de la Promesse chrétienne,
"cette promesse surhumaine faite à notre corps et à notre
âme créés" (Matinée d'ivresse), il en poursuit la
chimère à travers les substituts les plus divers :
-
les paradis
artificiels des Haschichins (Matinée d'ivresse),
"méthode" assimilée à l'absorption d'un "poison" et
célébrée en une formule ("Nous avons foi au poison")
dont l'allure violemment paradoxale semble avouer
l'absurdité. Quant à l'ivresse, c'est une "fanfare
atroce où je ne trébuche point !". Mais "atroce" quand
même ... et "cela finit, ne pouvant nous saisir
sur-le-champ de cette éternité, cela finit par une
débandade de parfums".
-
la "cruauté", la "destruction" (Conte),
(= la révolte ?), mais "Peut-on s'extasier dans la destruction, se
rajeunir [= retrouver l'enfance] par la cruauté" ?
-
"une" nouvelle "raison",
invoquée en substitution de l'ancienne, à qui "les
enfants" du poème À une raison adressent la même
prière de toujours, celle d'être délivrés de l'humaine
condition : "Change nos lots, crible les
fléaux, à commencer par le temps".
-
l'art des "maîtres
jongleurs" la "comédie magnétique", les "tragédies de
malandrins et de demi-dieux spirituels", "le plus
violent Paradis de la grimace enragée" (Parade)
= c'est le portrait traditionnel de l'artiste en
saltimbanque tragique ou en triste pitre (le
Gwynplaine
de Hugo, le Fancioulle de Baudelaire, etc. ),
-
le "nouvel amour" (Antique,
Being Beauteous, "Ô la face cendrée...", Royauté, À une
raison, Phrases), découverte du "nouvel amour"
qu'une section de Vies identifie
significativement à l'invention d'une musique (la
"musique" étant sans doute comprise comme un équivalent
superlatif de la poésie) : "Je suis un inventeur bien autrement méritant que tous
ceux qui m'ont précédé ; un musicien même, qui ai trouvé
quelque chose comme la clef de l'amour" (Vies).
Mais, malheureusement, "La musique savante manque à
notre désir" (Conte).
C'est dans Une saison en enfer
qu'on trouve sans doute la formulation la plus claire de la
morale à tirer de tout cela : "À quoi bon un monde moderne
si de tels poisons s'inventent".
La situation po/éthique de Rimbaud dans les Illuminations est-elle la
même que celle dont Une saison en enfer porte
témoignage ?
Essentiellement, oui, sans aucun doute. Il est certain que
l'auteur des Illuminations n'a plus la "foi au poison"
que déclarent ingénument les locuteurs de Matinée d'ivresse
et qu'il proclamait lui-même jadis dans sa "lettre du voyant" :
"Toutes les
formes d'amour, de souffrance, de folie ; [...] il épuise en
lui tous les poisons, pour n'en garder que les
quintessences. Ineffable torture où il a besoin de toute la
foi, de toute la force surhumaine, où il devient entre tous
le grand malade, le grand criminel, le grand maudit, et le
suprême Savant ! " (lettre à Paul Demeny du 15 mai
1871).
La différence
entre l'image que Rimbaud offre de lui-même dans la Saison
et dans les Illuminations tient davantage à une question
de posture énonciative qu'à une évolution idéologique d'une
uvre à l'autre ou à une différence de fond. Dans les
Illuminations, il opte pour une modalité d'énonciation plus ambiguë
que celle ouvertement autocritique du locuteur de la Saison.
Une attitude plus ambivalente, parfois même indécidable. On
oscille entre des textes à tonalité plutôt satirique comme
Parade et d'autres où domine la tonalité lyrique et qui
penchent vers la célébration (cf.
la célébration du "nouvel amour" dans les textes du f°7, par
exemple). Entre ces deux extrêmes, nombreux sont les poèmes (Matinée
d'ivresse, Royauté, Conte, Vies) où seule la perception plus
ou moins franche d'un ton parodique ou ironique permet de supposer
une attitude réprobatrice de la part de l'auteur. Une saison
en enfer est un réquisitoire contre les errements d'une
trajectoire personnelle tandis que les Illuminations
apparaissent davantage comme une façon de revisiter, dans la
distance, certes, mais aussi, souvent, dans la nostalgie, cette
même trajectoire [29]. Mais, dans le noyau central
de cette section qu'est la série intitulée "Vies", la
défaite du poète gagné par un "atroce scepticisme" (Vies
II) et la volonté de rompre avec le passé sont
affirmés sans ambiguïté : "Il ne faut même plus songer à cela. Je
suis réellement d'outre-tombe, et pas de commissions" (Vies
III).
Les f° 5-12 des Illuminations constituent donc un retour
réflexif, et lyrique à la fois, de Rimbaud sur le moment où il
s'est "reconnu poète" (lettre à Izambard du 13 mai 1871) et ce
qui s'en est suivi : l'entreprise du voyant. Comme il le fait
avec un verset de son poème Dévotion, Rimbaud aurait fort
bien pu dédier cette partie de son recueil "À l'adolescent que
je fus" :
-
Conte
(f°5) fait irrésistiblement penser à la maxime "Je est un
autre". C'est le thème du double. C'est la rencontre du "Prince" avec un Génie merveilleux qui
lui inspire
un amour passionné et mortel et qui n'est autre finalement que
"le Prince" lui-même.
-
Parade (f°6) semble un portrait de
groupe d'une certaine bohème artiste, au sein de laquelle
patrouillent "quelques jeunes [...] pourvus de voix effrayantes
et de quelques ressources dangereuses [qu'on] envoie prendre du
dos en ville, affublés d'un luxe dégoûtant".
-
Les trois
poèmes du f°7 (Antique, Being Beauteous, "O la
face cendrée...") sont voués à la célébration d'une
"forme d'amour" à la mode "antique". Ce f°7 est
thématiquement si homogène qu'André Guyaux, jadis si soucieux de
séparer O la face cendrée... de Being Beauteous, suggère, à la page 954 de la nouvelle
Pléiade, de considérer ce fragment comme "un appendice aux deux
poèmes précédents ou un poème autonome évoquant lui aussi un
corps convoité et appelé".
On trouve ensuite une série de
pièces :
-
évoquant le "départ dans l'affection et le bruit neufs" (Départ),
-
célébrant,
à la manière d'un conte de fées, le souvenir d'un amour et
d'un succès aussi foudroyants qu'éphémères, non sans
résonances autobiographiques (Royauté),
-
faisant dévotion "À une Raison", raison
poétique et politique, naturellement, soit ce que l'ordre
établi appelle plus volontiers déraison (et le
narrateur d'Une saison en enfer : "folie qu'on
enferme") ; cette "Raison" est représentée ici sous
la forme d'une allégorie rythmant de son
pas et au son du tambour "la levée des hommes
nouveaux et leur en marche", annonçant "la nouvelle harmonie"
et
"le nouvel amour" ; on
pense à
la doctrine fouriériste préconisant la libération des
passions et la transformation de la nature du travail comme
chemin vers l'harmonie universelle (dans Villes, le
poète se souvient "d'un boulevard de Bagdad où des
compagnies ont chanté la joie du travail nouveau") ; on
pense aussi à cette Grèce antique, synonyme, selon la lettre
du voyant, de "Vie harmonieuse", l'ancienne harmonie
en quelque sorte, patrie d'élection du poète
"voleur de feu" et "multiplicateur de progrès", où
"vers et lyres rhythment l'Action" et où les Ménades
conduisent leur danse en battant elles aussi du tambour lors des célébrations du
culte bachique,
-
chantant les "poisons" et la "méthode" (le "long,
immense et raisonné dérèglement de tous les sens"), et annonçant le "temps des
Assassins", qui sont aussi, comme chacun sait, les
Haschischins (Matinée d'ivresse),
-
invoquant enfin, dans
Phrases,
une "camarade, mendiante, enfant monstre" à laquelle
le poète adresse cette prière :
"Ma camarade, mendiante, enfant monstre [...]
Attache-toi à nous avec ta voix impossible, ta voix, unique
flatteur de ce vil désespoir." etc.
Mettons la chose
au masculin et on obtient une possible allusion à certains
"vagabonds" que nous retrouverons plus loin.
 f° 13-17 - Le
temps des Villes et du "roman de vivre à deux hommes" (Verlaine,
Laeti et Errabundi). Le
"cycle urbain" des Illuminations : f° 13-17 - Le
temps des Villes et du "roman de vivre à deux hommes" (Verlaine,
Laeti et Errabundi). Le
"cycle urbain" des Illuminations :
Inutile d'argumenter longuement, c'est la séquence dont la logique est la plus lisible :
Ouvriers, Les Ponts, Ville, Ornières, Villes II, Vagabonds,
Villes I. Trois poèmes titrés Ville(s), Les
Ponts (le paysage urbain), Ouvriers et Vagabonds qui évoquent la pauvreté générée par la
société moderne et, surtout, les pérégrinations du couple des
Laeti et errabundi, comme dit Murat (p.229). Verlaine lui-même n'est pas sans s'être reconnu dans
le "Docteur Satanique" de Vagabonds (lettre à Charles de Sivry du 16? août 1878, déjà citée, cf. note 6).
Nombreux sont les commentateurs qui ont repéré la logique
interne de cette séquence et l'ont analysée comme telle. La plupart de ces poèmes sont
étudiés dans mon
anthologie
commentée. Seule la présence d'Ornières est un peu
étrange. Encore faut-il remarquer qu'il y est question d'une
"pastorale suburbaine" : les "ornières" sont les traces que
laisse imprimées sur les routes la circulation
incessante des hommes, depuis leur
premier âge ("véhicules [...] pleins d'enfants attifés
pour une pastorale suburbaine") jusqu'à leur heure dernière
("cercueils sous leur dais de nuit dressant les panaches
d'ébène, filant au trot des grandes juments bleues et noires").
Une circulation qui n'est jamais aussi intense que dans la proximité
des villes.
|
|
[30] Jean-Pierre Richard,
Poésie et Profondeur, éd. du Seuil, 1955, p.236-237.
[31] Cf. toute l'uvre critique de Brunel, de
"La
poétique du récit mythique dans les Illuminations",
Versants, revue suisse des littératures romanes, 1983
à, par exemple, la notice sur les Illuminations de
l'édition des uvres complètes à La Pochothèque, 1999, p.445-450.
[32] Pierre Brunel,
« Guerre et le cycle de la force dans les
Illuminations », Berenice, n. 2, marzo 1981, p. 28-43.
Repris et fortement remanié dans Éclats
de la violence, Corti, 2004, p.536-549.
[33] "Le créateur littéraire et la fantaisie", in
L'inquiétante étrangeté et autres essais, Gallimard, 1985,
p.38. C'est Paul Audi qui fait ce rapprochement Rimbaud-Freud
dans Au sortir de l'enfance, Verdier, 2017, p.34. |
|
 f° 18-22 -
"tels paysages
féeriques" : f° 18-22 -
"tels paysages
féeriques" :
"Tels paysages
féeriques", écrivait Verlaine. Les poèmes qui se succèdent dans cette partie du recueil
explorent le domaine du rêve et du merveilleux : l'aube d'Aube
est une déesse, la mer de Fleurs est "un dieu aux
énormes yeux bleus et aux formes de neige", les trois
Veillées, Mystique, Nocturne vulgaire, chacun à sa
manière, développent un thème onirique, Marine
confectionne un tableau fantastique en superposant les images de
la terre et de l'eau, de la campagne et de la mer,
Fête d'hiver est une féerie. Le critique Jean-Pierre
Richard a discerné dans plusieurs de ces pièces un "déchaînement
onirique du paysage" obéissant à "la logique aberrante d'un
dynamisme de la courbure" et aboutissant au "triomphe d'un monde
courbe" [30]. C'est surtout dans cette partie du recueil
que l'on peut observer le Rimbaud architecte d'un monde
imaginaire, celui que Pierre Brunel appelle le
"poète-démiurge des Illuminations", attaché à créer "toutes les fêtes", à "inventer de
nouvelles fleurs, de nouvelles chairs, de nouvelles langues"
selon le programme énoncé dans l'Adieu
d'Une saison en enfer [31]. Mais nombre de
commentateurs, à la suite de Brunel, ont un peu trop tendance
à présenter ce "projet ambitieux d'une Genèse magnifique" comme
l'idée principale et la clé d'interprétation des
Illuminations. Bien plus qu'un monde imaginaire, c'est notre monde que nous
reconnaissons le plus souvent dans les Illuminations, le
monde réel (évoqué, pour sûr, dans un idiolecte qui n'est
pas la langue de "l'universel reportage"), le
monde réel avec les réflexions qu'il inspire au poète, ses
expériences vécues, ses souvenirs, les
émerveillements et les
colères, les espoirs et les
angoisses qui sont ou ont été les siens.
 Le
"cycle de la force" (tous les autres textes
sauf Génie, Jeunesse et Solde que nous réservons
pour en faire notre conclusion) : Le
"cycle de la force" (tous les autres textes
sauf Génie, Jeunesse et Solde que nous réservons
pour en faire notre conclusion) :
Pierre
Brunel a parlé à juste titre d'un "cycle de la force" dans Les
Illuminations [32]. Il désigne par là un groupe de
textes beaucoup plus étroit et, surtout, beaucoup mieux défini
que celui que j'englobe sous ce nom dans les lignes qui
suivent. Mais cette formule me semble assez bien convenir pour
résumer, dans son ensemble, toute la dernière partie du
recueil.
Rappelons les titres : - Angoisse, Métropolitain, Barbare
(folios 23-24),
- Promontoire, Scènes, Soir historique (La Vogue n° 8),
- Mouvement, Bottom, H,
Dévotion, Démocratie (La Vogue n° 9),
- Fairy, Guerre (Vanier 1895).
On ignore pourquoi la numérotation s'arrête à la
page 24.
Peut-être tout simplement parce que Rimbaud avait à
s'occuper ailleurs pour gagner sa vie et n'a pas eu le temps de
réaliser une copie parfaitement soignée de caractère
prétypographique de cette partie de son manuscrit, peut-être
aussi parce qu'il n'avait pas encore décidé de l'ordre dans
lequel il convenait de classer ces derniers textes quand les
circonstances (le départ de Nouveau ? la visite de Verlaine à
Stuttgart ?) l'ont incité à se défaire du manuscrit. Apparemment, ces derniers poèmes des Illuminations
forment une liste bigarrée. Deux pôles sémantiques au moins
semblent coexister, s'entremêler de façon un peu désordonnée :
un pôle politique, un pôle sexuel. Mais les deux dimensions ne
sont-elles pas incluses dans ce que Rimbaud, à plusieurs
reprises dans Une Saison en enfer et dans Les
Illuminations, désigne sous le nom de "force".
C'est dans cette fin de recueil que nous trouvons le plus de textes "politiques".
Rimbaud y développe sa critique de la modernité industrielle et
bourgeoise, sa "querelle" contre ce que le narrateur d'Une saison en enfer
(dans son vocabulaire hérité de la "sale éducation d'enfance") appelle "les apparences du monde" (L'Éclair).
Plusieurs de ces pièces évoquent de façon sarcastique ou
franchement réprobatrice les entreprises conquérantes de la
bourgeoisie à l'assaut de la planète entière : les mirages modernistes de la première mondialisation
capitaliste : "nos horreurs économiques" (Soir historique),
le tourisme de luxe (Promontoire), le colonialisme (Mouvement et
Démocratie). Dans Angoisse, le sujet se demande avec inquiétude ce qu'il
peut encore attendre des "accidents de féerie scientifique" et
des "mouvements de fraternité sociale". Dans Métropolitain,
il exprime la frustration du pauvre face aux richesses de la
ville (au nombre desquelles "les atroces fleurs qu'on
appellerait curs et surs [...], possessions de féeriques
aristocraties [...]"). Dans Barbare, alors qu'il se croyait "loin des
anciens assassins", il s'avoue toujours hanté par les
"vieilles fanfares d'héroïsme [révolutionnaire ?] qui nous attaquent encore le
cur et la tête".
À ce groupe assez cohérent, se mêlent des pièces
davantage axées sur la sexualité : Dévotion, Fairy,
Bottom, H. Mais la thématique sexuelle n'était pas
absente de Barbare et de Métropolitain :
ces poèmes contigus développent la même allégorie de la
mêlée amoureuse sauvage sur fond de paysage polaire, motif que
l'on retrouve dans la figure de "Circeto des hautes glaces", à
la fin de Dévotion. Frustration sociale et frustration libidinale
vont souvent de
pair dans le texte de Rimbaud (voir, comme exemple emblématique, la
section 5
de Mauvais sang). Dans
plusieurs textes, le motif sexuel prend la forme de
scènes imaginaires d'auto-affirmation virile ("bravoures plus
violentes que ce chaos polaire", dit le poète dans Dévotion),
scènes à travers
lesquelles l'auteur éprouve sa "force" (Métropolitain) ou se portraiture en "âne, claironnant et
brandissant [son] grief" (Bottom). Le mot "grief" étant
pris
au double sens de reproche (sujet de plainte, motif de querelle) et de phallus.
De façon générale, on remarquera que nombre d'Illuminations
s'achèvent sur une forme de querelle opposant le sujet masculin
à une
instance féminine magnifiée ("la Sorcière" d'Après le Déluge,
"la déesse" d'Aube, "la Vampire" d'Angoisse, "Circeto
des hautes glaces"
de Dévotion, "Elle" tout court dans Métropolitain),
une lutte entre Je et Elle dans laquelle il s'agit pour l'un
d'arracher à l'autre son secret (Après le Déluge), de lui demander raison pour "les
ambitions continuellement écrasées" (Angoisse), de
lever ses voiles (Aube), de la forcer (Métropolitain, Dévotion),
de guetter l'"arrivée" de sa "voix" "au fond des volcans et
des grottes arctiques" (Barbare).
Laissons pour une autre fois la tache d'approfondir,
si c'est possible,
le sens de ce féminin fantasmatique, omniprésent et multiforme, que l'auteur a voulu
conserver si mystérieux.
"Chez le jeune homme, écrit Freud, outre les désirs
érotiques, les désirs égoïstes et ambitieux sont nettement
prioritaires. Cependant, nous ne voulons pas accentuer
l'opposition entre les deux directions, mais bien plutôt leur
conjonction fréquente"
[33]. Il est curieux d'observer que Rimbaud emploie le
même mot que Freud quand il évoque "l'égoïsme infini de
l'adolescence" ("Vingt ans", Jeunesse III). Mais on
remarquera
surtout que les deux "directions" du désir accouplées
par Freud dans ce passage ("désirs érotiques / désirs
ambitieux") sont exactement celles que le poète interroge
conjointement dans "Sonnet"
(Jeunesse II), et par rapport auxquelles l'"Homme
de constitution ordinaire"
mesure,
selon lui, sa "fortune" et sa "force" [c'est
Rimbaud qui souligne Homme mais c'est nous qui
reconfigurons la mise en page du poème dans la citation
ci-dessous] :
| |
Homme de constitution ordinaire, |
| [désirs
érotiques] |
la chair n'était-elle pas un fruit pendu dans le verger ; ô
journées enfantes ! le corps un trésor à prodiguer ;
ô
aimer, le péril ou la force de Psyché ? |
| [désirs
ambitieux] |
La terre avait des versants fertiles en princes et en artistes et la descendance et la race vous poussaient aux crimes et aux deuils : le monde votre fortune et votre
péril. |
Le poème Guerre, enfin,
ne serait-ce que par son titre, peut passer pour la synthèse
finale de ce cycle de la force mais,
en même temps, il annonce la série intitulée Jeunesse.
Il présente déjà la structure temporelle ternaire (bilan du
passé, moment présent, perspectives d'avenir) qui sera celle
des diverses composantes de cette série. Après avoir
évoqué son enfance, le poète se décrit, dans le moment présent,
exclu de "tous les succès civils" (chassé,
dit-il, "par ce monde où je subis tous les succès civils")
et conclut, en une belle phrase musicale (qui commence par
un rythme 6/6 et se termine par un rythme 4/4) :
"Je songe à une Guerre, de droit ou de force, de
logique bien imprévue."
Cette brève pièce expose de façon
symbolique et très abstraite ce qui sépare l'enfance de ce
qui vient après. À ces deux étapes de la vie correspondent,
selon Rimbaud, deux expériences distinctes de l'infini.
L'enfance, ce sont les "ciels" (l'horizon, l'infini de
l'espace), spectacle aux riches nuances, l'une et peut-être
la plus essentielle de ces "merveilleuses images" que les
enfants contemplent dans la "grande maison aux vitres
ruisselantes" d'Après le Déluge ("painted plates" ?).
Un infini, certes, mais qui s'offre au regard du sujet et
sur lequel celui-ci apprend à régler ses désirs autant que
sa vue (cf. le double sens du mot "optique" dans la première
phrase du poème). Ce qui vient après, par contre, c'est
l'expérience du temps ("l'inflexion éternelle des moments"),
initiée lorsque "les phénomènes s'émurent" et que se
succédèrent les péripéties de la vie en société ("les succès
civils"). C'est "l'infini des mathématiques",
c'est-à-dire sans doute l'idée d'une logique implacable,
extérieure à soi, et qui voudrait réguler notre destin à notre
corps défendant : une image de la fatalité. C'est contre cet
ordre des choses dans la société qu'il s'agit de défendre sa liberté, contre
cette logique du monde qu'une guerre devra être conduite. L'infini du temps, c'est
aussi, pour l'homme,
l'expérience d'une complexité fuyante et d'une totalité hors
d'atteinte qui le "chassent par ce monde" : l'expérience de
l'insatisfaction. Conjurer le "fléau" du Temps (cf. À une
raison), soumettre à ses desseins propres l'"infini des
mathématiques" comme le musicien et le poète quand ils en
assujettissent l'usage à la composition d'"une phrase
musicale", forme "simple" et harmonieuse, totale et achevée,
tel sera l'enjeu de cette "Guerre".
|
[34] Jean-Luc Steinmetz,
"Rimbaud et le roman",
La poésie et ses raisons, José Corti, 1990.
[35] Yann Frémy, « Te voilà, cest la force ». Essai
sur Une saison en enfer de Rimbaud, Classiques
Garnier, Études rimbaldiennes, 2009, p.468. |
|
 Jeunesse.
Vingt ans, le moment des bilans. Jeunesse.
Vingt ans, le moment des bilans.
Génie, Jeunesse et Solde. Il n'est pas étonnant que tant
d'éditeurs aient placé Génie
et Solde, à tour de rôle, en position conclusive,
dans le recueil. Chacun de ces textes, à sa manière, peut passer
pour un mémoire récapitulatif des thèmes et des idées
esthétiques de Rimbaud (voir les dossiers consacrés à ces deux
textes majeurs dans mon
anthologie
commentée). Mais c'est le cycle Jeunesse qui est au centre de
cette ultime séquence. J'ai expliqué ci-dessus comment le
mot "jeunesse" peut être compris, pourquoi
il suggère un regard rétrospectif posé sur toute une
histoire à partir de son dénouement. Un dénouement dont
Rimbaud nous donne même la date : celle de ses "vingt ans"
(titre de la troisième partie de la série).
Les quatre textes de Jeunesse sont disparates et
l'observation des manuscrits suggère que leur regroupement sous un même titre a été
tardif. Ce qui les rapproche, c'est leur référence
commune au moment présent comme à une pause ("adagio",
Jeunesse III), pause réflexive, méditation sur l'expérience vécue,
travail de "mémoire" (Jeunesse IV) ou abandon
rêveur à "la visite des souvenirs" (Jeunesse I).
Chacun des poèmes fait contraster un temps passé (voir
l'abondance des verbes à l'imparfait) et un présent ou un futur
immédiat désignant le moment de l'écriture. Chacun des textes,
en effet, fait allusion à "l'uvre" (Jeunesse I), au
"labeur" (Jeunesse II), au "travail" littéraire (Jeunesse
IV), en appelle à
l'"impulsion créatrice" et à "toutes les possibilités
harmoniques et architecturales" qu'elle est susceptible de
mobiliser (Jeunesse IV), convoque "un chur, pour calmer
l'impuissance et l'absence !" (Jeunesse III). C'est du projet poétique en cours de réalisation, des Illuminations elles-mêmes,
probablement, qu'il s'agit.
Mais, ce moment des Illuminations, dans la jeune
vie de Rimbaud, c'est surtout le moment des choix décisifs.
Choix que Génie
et Solde semblent orienter dans des sens opposés. La place de Jeunesse (le texte), coincé
(par hasard ?) entre ces deux poèmes, est homologue à la situation du poète
lui-même, en devoir de choisir entre
deux options d'allures contraires (à moins qu'elles ne
soient finalement complémentaires) :
- celle qui ressort de Génie : la relance à l'infini
d'une forme profane de quête messianique, ne fondant ses
espérances que sur la "fécondité de l'esprit" et l'"immensité de
l'univers".
- celle qu'illustre la saynète
allégorique de Solde :
le renoncement à cette chimère sans avenir qu'est le commerce de
l'Idéal dans une société prosaïque et hostile (encore que le
poème se termine sur l'idée que "les vendeurs", c'est-à-dire les
poètes, "ne sont pas à bout de solde", que "Les voyageurs n'ont
pas à rendre leur commission de si tôt" et la chose, en ce qui
concerne la trajectoire personnelle de Rimbaud, ne trouve-t-elle
pas dans une certaine mesure confirmation dans ce tardif retour
de flamme poétique que manifeste la
lettre à Jules Andrieu datée du 16 avril 1874 ?).
Jean-Luc Steinmetz a signalé, chez Rimbaud, une tentation du
roman [34]. La sorte de fil directeur
que nous avons suivi pour parcourir les Illuminations
correspond en effet à une structure implicitement narrative : une
évocation rétrospective par l'auteur, très transposée, de sa
brève trajectoire. Cette interrogation du passé
confère à certaines Illuminations l'allure de méditations
réflexives, de "poèmes de
bilan". Dans d'autres, on a plutôt l'impression d'une remontée
instinctive du
souvenir à la surface de la conscience, expérience quasi onirique s'entourant d'une
atmosphère de nostalgie ...
"Quels bons bras, quelle belle heure me rendront cette
région d'où viennent mes sommeils et mes moindres mouvements
?" (Villes, "Ce sont des villes ...")
...
ou, au contraire,
une atmosphère de hantise :
"Remis des vieilles fanfares d'héroïsme
qui nous attaquent encore le
cur et la tête loin des anciens assassins
[...]
(Loin des vieilles retraites et des vieilles flammes, qu'on
entend, qu'on sent, [...])" (Barbare).
Mais ce que le poète appelle
joliment "la visite des souvenirs" (Jeunesse I,
Dimanche) fournit
incontestablement, dans tous ces cas, "la nourriture à [s]on
impulsion créatrice" (Jeunesse IV).
Il ne m'échappe pas que la structure des Illuminations que
j'ai prétendu dégager ci-dessus est un pur décalque de la
biographie de Rimbaud, telle que la vulgate la raconte :
-
f° 1-5
- Enfance. Jusqu'aux premiers émois de l'adolescence
biographiquement consignés dans la lettre à Banville du 24
mai 1870. Les poèmes recopiés à Douai. L'année 1870.
-
f°
5-12 - L'entreprise du voyant. Les thèmes poétiques et
politiques biographiquement consignés dans la lettre à
Demeny du 15 mai 1871. Les poèmes de l'année 1871 (début de
1872).
-
f° 13-17 - Le
"cycle urbain". Double mouvement d'attraction et
de détestation politique, d'utopie et de contre-utopie, dont
le correspondant vécu est la fascination du poète dûment
consignée par les biographes pour les "villes énormes", qui
l'attire successivement à Paris et à Londres où il séjourne
en compagnie de Verlaine.
-
f° 18-22 -
"tels paysages
féeriques" (Verlaine). C'est l'apogée du jeune
homme en tant qu'artiste : le poète-démiurge, le
poète-"mage" dont Une saison en enfer fait le deuil.
En particulier Alchimie du verbe dans son allure
d'anthologie critique des poèmes de l'année 1872, marqués
par le compagnonnage amoureux et l'osmose littéraire avec
Verlaine.
On remarquera d'ailleurs que lorsqu'il entend défendre
Rimbaud contre ceux qui ont voulu le "travestir en
loup-garou", en 1888, dans Les Hommes d'aujourd'hui (en mode image sur Gallica, p.360 et sqq), ce sont Veillées I et Aube
que Verlaine cite intégralement côte à côte comme symboles d'une
existence vécue « toute en avant dans la lumière et dans la force,
belle de logique, et d'unité comme son uvre, et semble tenir entre
ces deux divins poèmes en prose détachés de ce pur chef-d'uvre,
flamme et cristal, fleuves et fleurs et grands voix de bronze et
d'or : les Illuminations ».
-
Le "cycle de la force" (tous les autres textes
sauf Génie, Jeunesse et Solde que nous réservons
pour en faire notre conclusion). C'est le moment présent.
Celui des Illuminations. Celui du basculement de
l'adolescence à l'âge adulte. C'est la réflexion
stratégique sur les moyens à mettre en uvre pour triompher
d'"Elle" (la société, la ville, la misère, la
mère, l'autre féminin en général, la "réalité rugueuse"), sur la "guerre" qui s'annonce dans l'avenir, moment
de déprime et de lutte pour la vie, consigné sur un plan biographique dans le Journal tenu à
Londres par Vitalie, au printemps 1874 : la galère pour
trouver un emploi. Une "galère" qui va durer en fait jusqu'à
la fin de 1880, moment où il décroche enfin un emploi stable
au sein de la maison Mazeran, Viannay,
Bardey et Cie (commerce des peaux et du café), à
Aden.
-
Jeunesse (Vingt ans) -
Génie, Jeunesse et
Solde. Bilan.
Le poète lui-même établit la correspondance étroite entre la
vie et l'uvre, au moment de conclure son recueil, en
mentionnant l'âge de vingt ans qu'il atteint le 20 octobre
1874. Solde, la dernière des cinq proses
publiées en 1895 aux éd. Vanier, et celle qui termine le
recueil dans nos éditions actuelles, n'a-t-elle pas son
parfait répondant biographique dans la lettre à Jules
Andrieu du 16 avril 1874 (comme expliqué
ici) ?
En lisant ainsi les Illuminations comme une sorte
de "roman de l'artiste", on découvre, et c'est logique,
qu'elles ne sont pas si éloignées qu'on pourrait le croire de la
structure de la Saison en enfer. C'est d'ailleurs à cette
même conclusion qu'en vient Yann Frémy au terme de son étude de
la Saison [35]. Il écrit :
"Le parcours des Illuminations ressemble [...] à
celui d'Une saison en enfer, comme si chaque poème en
prose pris séparément évoquait, perpétuait un problème
soulevé par le 'carnet de damné' et le traitait selon une
perspective différente et en une forme entièrement nouvelle.
Après le Déluge occupe la place de la prose
liminaire, l'adresse à la Sorcière remplaçant celle à Satan,
avant que ne débute l'autobiographie poétique avec
Enfance, Conte, Parade, Vies,
Départ, qui correspondent (peu ou prou) à Mauvais
sang, Matinée d'ivresse inversant Nuit de
l'enfer, la série Ouvriers - Les Ponts - Ville -
Ornières - Villes - Vagabonds - Villes, pour sa part,
renvoyant à Délires I, Fleurs n'étant pas sans
évoquer Délires II. Et que dire de Génie, qui
est lui aussi un Adieu ?"
Rimbaud avait-il en tête un tel projet para-romanesque quand il
a composé ses poèmes en prose ? Je n'en jurerais pas. Par
contre, il paraît certain qu'au moment de rassembler en recueil
ses Illuminations, Rimbaud s'est mis en quête d'un
principe de classement susceptible de les englober dans une
cohérence a posteriori. C'est alors, sans doute, qu'il a perçu
cette possible idée directrice "autofictionnelle" ou "automythographique"
et cherché à en renforcer la visibilité par sa façon d'enchaîner
les textes sur le manuscrit, par la confection de séries et le
jeu de titres à connotations biographiques comme "Enfance",
"Jeunesse", dont André Guyaux a montré qu'ils ont été parfois
inscrits tardivement, alors que les textes correspondants
étaient déjà mis au net. |
| |
|
Le danger, ici, je le sens bien, c'est que ce soit le
commentateur qui fasse du roman, plutôt que l'auteur :
l'explication par l'expérience vécue, des textes d'abord, de
leur agencement ensuite, est tellement commode, tellement
"tentante". Mais cet expédient fonctionnerait-il aussi bien s'il
ne trouvait sa justification dans l'uvre elle-même ? De la
lettre à Banville à Roman et de Ma Bohême à
Une saison en enfer, Rimbaud a-t-il jamais cessé de romancer
sa propre vie, de bâtir son uvre comme un "roman du poète" ? Les
Illuminations n'y font pas exception, même si les
pilotis biographiques ne sont là que pour supporter un archétypal
Künstlerroman,
voire un récit exemplaire du passage de l'enfance à l'âge
adulte.
Ce qu'on peut reprocher aussi à une telle lecture,
c'est d'être tributaire d'un agencement du recueil ne reposant
sur aucune donnée historique réellement démontrée, pouvant
paraître même à certains comme totalement aléatoire, et dû à
Fénéon plutôt qu'à l'auteur des poèmes. Eh bien, soit : vous
venez donc de lire une exégèse de la lecture fénéonnienne des Illuminations. La première, car le
même
Fénéon en a procuré une toute autre, non moins cohérente, dans
sa plaquette d'octobre 1886, quelques mois seulement après la
première publication en revue de mai-juin 1886.
Mais je plaisante, naturellement, car je ne crois
nullement que l'ordre dans lequel nous lisons traditionnellement
les Illuminations, en tout cas la partie correspondant
aux vingt-trois feuillets numérotés (celle
qui qui a été publiée dans les n°5 et 6 de La Vogue et
qui est archivée à la BNF sous la cote
NAF14123)
puisse être attribué à quiconque d'autre qu'à Rimbaud. Non en
raison de la pagination de ces manuscrits car, en l'état de nos
connaissances, la paternité rimbaldienne de cette pagination ne
peut pas être positivement et absolument affirmée. Mais
il existe dans Les Illuminations,
au moins dans ces deux premiers
tiers du recueil,
d'autres indices patents d'un ordre prémédité que la
numérotation des feuillets : ceux qui découlent du mode de
transcription adopté par l'auteur. Comme on sait, Rimbaud y a
multiplié les enchaînements de plusieurs textes sur un même
feuillet et les chevauchements d'un feuillet sur l'autre. Cela
signifie que, même mélangés comme un "jeu de cartes", selon
l'expression méprisante de Fénéon, par les lecteurs les ayant
compulsés entre leur remise à Verlaine en février 1875 et leur
arrivée à La Vogue en avril 1886, ces vingt-trois
premiers feuillets des Illuminations limitent considérablement les
possibilités dun ordre de lecture aléatoire. Du moins pour qui veut
bien respecter les effets denchaînement impliqués par le mode de
transcription choisi par lauteur. Il n'est que de voir comment les
groupes de poèmes soudés par ce mode de transcription se
distribuent au sein du schéma de lecture défini ci-dessus pour
mesurer à quel point la responsabilité de Rimbaud dans cette
lecture domine les éventuelles interactions des éditeurs de
La Vogue.
Dans le tableau ci-dessous, où je suis rigoureusement l'ordre du
périodique La Vogue, je présente réunis par un tiret les
poèmes qu'un respect des effets de contiguïtés voulus par
Rimbaud empêchent de séparer :
|
f° 1-5
- Enfance. |
Après le Déluge
Enfance Conte |
| f°
6-12 - L'entreprise du voyant. |
Parade
Antique Being Beauteous « O la
face cendrée
»
Vies Départ Royauté
À une raison Matinée divresse
Phrases |
| f° 13-17 - Le
cycle urbain. |
Ouvriers Les Ponts Ville
Ornières
Villes (Ce sont
) Vagabonds Villes
(LAcropole
) |
|
f° 18-22 - Paysages féeriques |
Veillées Mystique Aube
Fleurs
Nocturne vulgaire Marine -
Fête d'hiver |
|
f° 23-24 - Le cycle de la force (début) |
Angoisse Métropolitain Barbare. |
On constate d'abord que les
29 poèmes représentés ne constituent finalement que 11 groupes
de poèmes, onze "cartes" à distribuer selon le choix de
l'éditeur. Mais on voit aussi, si l'on s'appuie sur l'exemple le
plus favorable à ma thèse, celui du "cycle urbain" que les deux
seuls groupes qui le constituent rendent presque obligatoire
leur rapprochement du fait de la présence, dans l'un, des titres
"Villes", dans l'autre, du titre "Ville". Conclusion : dans ce
cas, aucune possibilité de classement aléatoire des textes, mise
à part la permutation entre les deux groupes. La
démonstration est moins aisée dans les autres segments de la
structure, mais de Parade à Antique et d'Antique
à Royauté, par exemple, on n'est pas sans apercevoir un
fil conducteur possible qui incite au rapprochement (le thème
du "nouvel amour"). De même entre Veillées et Nocturne
Vulgaire (l'inspiration onirique). Conclusion : avec un peu
de perspicacité herméneutique, les divers groupes soudés par
contiguïté graphique s'entre-soudent par continuité thématique.
La contrainte pesant sur l'éditeur de cette façon est évidemment
loin d'être comparable à celle qu'exerce une pagination ou un
agencement clairement défini par l'auteur quand ils existent,
mais j'espère avoir prouvé que les métaphores fénéoniennes des
"chiffons volants" et du "jeu de cartes" sont malgré tout très
excessives.
Retour haut de page
|
7) Les "filets de séparation" visibles sur le manuscrit (et
dans l'édition de la Pléiade d'André Guyaux) sont-ils porteurs
de sens ?
|
| |
|
Si on en juge par sa récente
édition dans la Pléiade, le point de vue d'André Guyaux sur la structure interne
des Illuminations a singulièrement évolué depuis sa thèse
et son édition critique de 1985.
Percevant dans le manuscrit des
Illuminations un conflit entre "deux forces, l'une liante, l'autre déliante",
il jugeait alors la seconde plus déterminante que la première.
Aujourd'hui, il semble avoir inversé son approche, au point de
reproduire un certain nombre de traits vaguement discernables
sur les manuscrits qu'il
considère comme de possibles "filets de séparation".
Rimbaud les aurait destinés à
segmenter le recueil en blocs de textes distincts. Il vaut la
peine de citer ici, dans sa presque totalité, le passage de sa
"Note sur le texte" où Guyaux expose sa nouvelle
vision du problème :
"Même si leur numérotation
[...] ne peut être attribuée avec certitude à Rimbaud, la
série de poèmes d'Après le Déluge à Barbare [...] apparaît
comme un recueil constitué en tant que tel : les
regroupements de textes numérotés en chiffres romains et
placés sous un seul titre (Enfance, Vies, Veillées), les
suites de poèmes apparaissant dans un ordre déterminé par
leur présence sur le même feuillet ou par leur chevauchement
d'un feuillet sur l'autre, les filets de séparation
déterminant peut-être des séquences internes, tout témoigne
d'une volonté d'organisation."
Nous proposons
ci-dessous une sorte de tableau permettant d'embrasser d'un seul
coup d'il l'emplacement de ces "filets de séparation", tel
qu'on peut l'observer aussi bien dans le volume de la Pléiade
que sur les divers fac-similés consultables, en ligne chez Gallica notamment.
L'ordre adopté est celui de l'édition de la Pléiade (textes des
feuillets 1 à 24, suivis des textes issus de feuillets non
numérotés publiés dans la revue La Vogue n°8 et 9, dans
l'ordre de La Vogue, puis des cinq textes publiés dans
l'édition Vanier de 1895, dans l'ordre de cette édition) :
Après le Déluge
________________________
Enfance
________________________
Conte
Parade
Antique
Being Beauteous
"Ô la face cendrée..."
________________________
Vies
________________________
Départ
Royauté
________________________
À une raison
Matinée d'ivresse
Phrases
Ouvriers
Les Ponts
Ville
Ornières |
Feuillets numérotés 1
à 14
La Vogue n°5 |
|
|
|
Villes (Ce sont des villes...)
Vagabonds
Villes (L'acropole officielle...)
Veillées
_______________________
Mystique
Aube
Fleurs
Nocturne vulgaire
________________________
Marine
Fête d'hiver
________________________
Angoisse
________________________
Métropolitain
Barbare |
Feuillets numérotés 15 à 24
La Vogue n°6 |
| |
|
Promontoire
Scènes
Soir historique |
Feuillets non
numérotés
La Vogue n°8 |
| |
|
Mouvement
Bottom
H
Dévotion
Démocratie |
Feuillets non
numérotés
La Vogue n°9 |
| |
|
Fairy
________________________
Guerre
________________________
Génie
________________________
Jeunesse
________________________
Solde |
Feuillets non
numérotés
Vanier
1895 |
La répartition de ces traits de séparation paraît en effet
significative. L'organisation interne qu'ils suggèrent
recoupe d'ailleurs en partie les regroupements thématiques
proposés ci-dessus (question 6).
La séquence allant de Conte à Being Beauteous, par
exemple, même si elle n'est pas identique à celle que nous
imaginions, est tout à fait compatible avec notre
propre tentative de segmentation. De même, celle qui va de
Mystique à Nocturne vulgaire, sauf que nous y
ajoutions, en amont, Veillées, et, en aval, Marine
et Fête d'hiver. La longue séquence englobant les
différente Ville (s) n'est pas non plus très différente
de celle que nous envisagions. Nous constatons enfin qu'un seul
trait de séparation, en toute fin de séquence, interrompt
l'ensemble allant de Métropolitain à Guerre que
nous avons intitulé : "le cycle de la force".
La prise en compte de ces "filets de séparation" est
d'autant plus tentante que nombre de ces traits ont aussi été
barrés, comme on le voit ci-dessous dans le manuscrit contenant
Bottom et H :

Comme
Steve Murphy le remarque de son côté, dans son article d'Histoires
littéraires n°1 ("Les Illuminations manuscrites"), "ces traits
séparateurs barrés se trouvent pour la plupart dans les derniers
manuscrits accessibles [...], sept des huit derniers feuillets
contiennent des traits barrés ; une seule des vingt-quatre pages
numérotées en comporte." Or, nous avons vu ci-dessus (question 4) que les manuscrits de
cette dernière partie du recueil révèlent souvent une forme
d'écriture plus ancienne que celle qui domine dans le début
numéroté. Ce sont des textes, semble-t-il, que Rimbaud n'a pas
eu le temps ou n'a pas jugé utile de recopier, au printemps 1874.
Mais il n'est pas impossible qu'en barrant plusieurs traits séparateurs
qui s'y trouvaient, de la
même façon qu'il les avait sans doute supprimés, aux endroits
idoines, en établissant sa copie pré-typographique des premiers poèmes du recueil,
il ait souhaité relier thématiquement certains textes.
La problématique est nouvelle et suscite des
conjectures fragiles, mais André Guyaux a fort bien
fait d'y confronter son lecteur en reproduisant pour la première
fois dans une édition des uvres complètes de Rimbaud ces
marques mystérieuses de son manuscrit.
Retour haut de page |
8) Dans
quel ordre ranger les textes quand on édite les Illuminations
?
|
|
|
|
Le
manuscrit des Illuminations, dans les conditions historiques
qui ont présidé à sa transmission d'abord, à son édition ensuite, a
été malmené de toutes les façons. Dès octobre 1886, Fénéon se permet
d'éditer le recueil en plaquette en ne respectant rien
de l'agencement du manuscrit. Il l'avait pourtant
scrupuleusement suivi dans le périodique, quelques mois plus tôt,
pour ce qui est de la partie "enchaînée" et paginée de la transcription (car
c'est lui-même, selon ses dires, qui a supervisé la pré-originale de
mai-juin 1886).
Berrichon, qui régente l'édition de Rimbaud dans
la première moitié du XXe siècle, classe les poèmes au
petit bonheur, ou selon ses hypothèses plus que fragiles concernant
leur chronologie de rédaction. En 1945, le volume des éditions de
Cluny, dû à Y.-G. Le Dantec (éditeur verlainien et baudelairien de
la première moitié du XXe siècle), classe encore les Illuminations
dans le même ordre que la plaquette de Fénéon. La même année, le
Mercure de France reproduit purement et simplement l'édition
Berrichon de 1912 ! Leur excuse, bien sûr, c'est qu'aucun de ces
éditeurs n'a eu accès à la partie numérotée du manuscrit,
alors en possession de Lucien Graux.
Ce n'est qu'après la deuxième guerre mondiale, les manuscrits ayant enfin pu être
consultés, que les éditeurs reviennent au modèle plus
"philologique" constitué par l'édition du printemps 1886 (celle du
"périodique") en ce qui concerne la partie paginée du recueil. Ceux de la première Pléiade
(1946), Rolland de Renéville et Jules
Mouquet, reprennent purement et simplement l'ordre de publication
du périodique La Vogue, suivi des cinq poèmes de Vanier 1895,
dans l'ordre de Vanier. Mais Bouillane de Lacoste, procédant de manière
identique en ce qui concerne les premiers textes, d'Après le
Déluge à Barbare, préconise pour les manuscrits non
paginés un agencement différent, que son prestige tendra à imposer
jusqu'à la fin du XXe siècle (exception faite de Guyaux
en 1985). Bouillane de Lacoste place en premier lieu les textes
qu'il a pu réviser (les manuscrits de
NAF 14124), probablement parce qu'ils ont appartenu au même Lucien Graux
que les manuscrits paginés. Puis Promontoire,
qui est à Charleville et qu'il connaît
bien aussi. Puis les textes
peu ou pas accessibles de la collection Pierre Berès. Enfin les deux
textes dont le manuscrit a disparu. Le critère, comme on le voit,
est assez arbitraire. C'est la raison pour laquelle les plus
récents éditeurs trouvent préférable de revenir à l'agencement de
la première Pléiade, c'est-à-dire à celui des toutes premières
éditions (plaquette de 1886 mise à part). On a plus de chance, dit
Murphy, de retrouver ainsi un ordre ayant quelque chose à voir avec
les intentions de Rimbaud.
Il règne en effet, désormais, parmi les spécialistes, une parfaite
harmonie. La dernière Pléiade (2009-2015), confiée aux soins d'André
Guyaux, présente le même agencement que celui préconisé par Steve
Murphy en 2002 [3]. Notre question (je veux dire : la
question de notre titre), question qui a si longtemps divisé
les rimbaldiens, semble réglée. Tant mieux. Comme dit Rimbaud :
"Cela s'est passé. [Nous savons] aujourd'hui saluer la beauté." |
|
Retour haut de page |
|
Une question annexe .
L'attribution des Illuminations à Germain Nouveau a-t-elle quelque fondement ?
|
[36] Eddie Breuil, Du Nouveau chez Rimbaud, Champion,
2014.
[37]
"Les
Illuminations d'Arthur Rimbaud sont-elles de Germain Nouveau
?" Rencontre entre Pierre Brunel et Eddie Breuil autour du livre
de ce dernier Du Nouveau chez Rimbaud. Modérateur :
Jérôme Thélot. Univ. Lyon III.
Partie 1 (1:00:52).
Partie 2 (54:01). 25/08/2015.
[38]
Michel Murat, "Du
nouveau chez Rimbaud ?", blog Rimbaud ivre, 19 mars
2017.
[39]
Cyril Lhermelier,
compte rendu du livre d'Eddie Breuil, Du Nouveau chez Rimbaud,
Parade sauvage n°28, 2017, p.229-250.
[40]
Yalla Seddiki,
Rimbaud is Rimbaud is Rimbaud is Rimbaud. Rien de Nouveau chez Rimbaud, Non
lieu, 2018. L'auteur éclaire ainsi le titre de son ouvrage, dans
un
courrier publié par David Ducoffre sur son blog : "[...] sagissant
du titre, je ne fais que détourner
lun des vers les plus
célèbres de la poésie américaine" :
https://en.wikipedia.org/wiki/Rose is a rose is a rose is a rose
[41]
"Cette rencontre eut lieu le 14 ou le 15 mai 1875, selon M.
Pakenham. Elle fut immortalisée par le poème de Verlaine « Ce
fut à Londres, ville...»" (Lhermelier, p.235).
[42]
Cf. notamment : Lautréamont, Germain Nouveau, uvres
complètes, éd. Pierre-Olivier Walzer, bibl. de la Pléiade,
1970, "G.N. Chronologie", p.305-330.
[43]
Notice de
la Société de ventes aux enchères Pierre Bergé & Associés. Vente
du 11 décembre 2015. Bibliothèque Pierre Bergé.
Lot 106. Nouveau, Germain, sous le pseudonyme de Jean de Noves.
Épreuves des Valentines.
[44]
En 1898, lorsque Delahaye, au dire de ce dernier, communique à
Germain Nouveau l'édition des uvres de Jean-Arthur Rimbaud préparée par Berrichon et par lui-même pour
le Mercure de France.
|
|
Henry de Bouillane de Lacoste,
dans sa thèse de 1949,
a révélé la présence de l'écriture de Germain Nouveau dans le manuscrit de deux poèmes
des Illuminations
(Villes, "L'acropole officielle..." et Métropolitain). On sait que
Nouveau a cohabité avec Rimbaud de
la fin mars au début du mois de mai 1874, à Londres et l'on
pense généralement que c'est pendant cette période qu'il a aidé Rimbaud à
recopier ses Illuminations. Or, pour Eddie Breuil,
auteur d'un livre plaisamment intitulé
Du Nouveau chez Rimbaud [36], ce n'est pas
Nouveau qui a copié quelques poèmes de Rimbaud, c'est au
contraire Rimbaud qui a servi de copiste pour
calligraphier dans son entier une uvre dont le véritable auteur
est Germain Nouveau.
Les
spécialistes de Rimbaud ont adopté à l'égard du livre d'Eddie
Breuil des attitudes différenciées. Pierre Brunel, tout en se
disant imparfaitement convaincu, a loué la rigueur
philologique du jeune chercheur et célébré dans son
travail une publication opportune relançant la
réflexion sur les Illuminations : "Ma conclusion, c'est
que nous vivions sur trop de certitudes ou de quasi-certitudes
et, maintenant, la question est de nouveau ouverte" [37].
Michel Murat, à l'inverse, a jugé qu'un tel ouvrage ne méritait
même pas qu'on le discute :
"le
livre, qui repose sur une pratique systématique du soupçon, fait
bon marché non seulement du silence de Nouveau, mais de la
parole de Verlaine en dépit de ses imprécisions ; et surtout
les rimbaldiens, en tant que lecteurs, sont convaincus à la fois
de la solidarité profonde entre les membres du poète, si
disjoints soient-ils, et de lincapacité de lauteur des Valentines à écrire des textes comme
Barbare ou Génie. Ils ont considéré, sans preuve
mais avec raison, que jamais Breton ou Gracq, qui
connaissaient et aimaient les deux poètes, nauraient
donné dans ce panneau ; et ils nont pas jugé quune
réfutation fût nécessaire." [38].
Les entreprises de réfutation, il est vrai, ont
quelque peu tardé mais elles ont fini par se manifester par
l'intermédiaire d'un compte rendu de la revue Parade sauvage,
signé Cyril Lhermelier [39], et d'un volumineux essai de
Yalla Seddiki [40]. Les deux réquisitoires sont sévères
et leurs arguments se recoupent.
Le premier groupe d'arguments
concerne le témoignage de Verlaine (qui est,
rappelons-le, notre seule source d'information de première main
dans cette affaire). Ce dernier ayant toujours présenté
Les Illuminations comme une uvre de Rimbaud, Breuil
devait, pour imposer sa thèse, ruiner la crédibilité de ce
témoignage, à commencer par la lettre de Verlaine à Delahaye du 1er
mai 1875 (déjà citée, cf. note 2). Rappelons-en le passage-clé :
"Si je
tiens à avoir détails sur Nouveau, voilà pourquoi :
Rimbaud m'ayant prié d'envoyer pour être
imprimés des « poèmes en prose » siens, que j'avais ; à ce même
Nouveau, alors à Bruxelles (je parle d'il y a deux mois), j'ai envoyé (2 fr.75 de port!!!) illico [...]"
Selon
Eddie Breuil, l'expression "« poèmes en prose » siens" pourraient bien
désigner des poèmes de Nouveau. Mais la tournure possessive poèmes
siens, ici, renvoie en stricte logique syntaxique au sujet de
la phrase : Rimbaud. "Le point qui précède « Rimbaud »,
explique Lhermelier, et le point-virgule qui suit « j'avais »
unissent syntaxiquement le sujet « Rimbaud » et l'adjectif
« siens »" (p.232).
Autre argument, tout aussi
difficilement soutenable : Verlaine aurait pu "ignorer la
véritable nature des documents contenus dans le dossier de
Stuttgart" (Du Nouveau chez Rimbaud, p.53). Rimbaud
ne lui en aurait rien dit : ils avaient bien d'autres choses à
faire pendant les deux jours et demi qu'ils ont passés ensemble. Là
aussi, on juge de la vraisemblance : "Nous devons donc imaginer,
écrit Lhermelier, un grand poète français recevant de la part
d'un autre grand poète français, qu'il aime et admire, un
dossier rempli de manuscrits de celui-ci" sans qu'ils aient
songé à parler un tant soit peu littérature et notamment à
éclaircir "qui a écrit quoi" dans le dit dossier ! (p.233).
Enfin, la thèse de Breuil devient tout à fait
invraisemblable quand il postule que Verlaine, ayant mal compris
au départ quel était le véritable auteur des proses contenues dans le
dossier de Stuttgart, les aurait présentées
en toute bonne foi comme une uvre de Rimbaud, toute sa vie durant, sans
s'aviser de sa méprise et sans que Germain Nouveau ne l'en ait
jamais
détrompé. Dans les semaines qui ont suivi l'envoi postal, Verlaine,
qui ne connaissait pas jusque là Germain Nouveau, a entretenu
avec lui une "correspondance assez
suivie" (comme il le raconte dans sa lettre à Delahaye du 1er
mai 1875). Puis, ils se sont rencontrés à Londres
[41].
Ils n'auraient pas échangé, à ces occasions, le moindre mot sur
le contenu du dossier de poèmes dont la transmission venait de les
réunir ? Ils sont ensuite devenus amis et ont entretenu une
abondante correspondance jusques et y compris à l'époque où
paraissent Les Illuminations. Selon ses biographes
[42], Germain Nouveau est de retour en
France en 1885 après un séjour au Liban (1883-1884) d'où il
ramène ses
Sonnets du Liban, publiés en 1885 dans
les revues
Le Chat noir (pour
Set Ohaëdat et Kathoum)
et Le Monde Moderne (pour Musulmanes et Smala).
Il fréquente les milieux littéraires,
Verlaine et le Cabaret du Chat noir. C'est en 1885 qu'il
rencontre, dans un café de la Rive gauche, l'inspiratrice de son
recueil de madrigaux
Les Valentines (Valentine Renault). Au printemps
1887, il entreprend de publier les 52 pièces de ce recueil. En
1888, il exerce comme professeur de dessin au lycée Jeanson-de-Sailly.
Les Valentines sont sous presse,
les épreuves corrigées de la main de l'auteur, quand
Nouveau en interdit tout à coup la publication, à la suite d'une
crise de folie mystique, en 1891. À partir de cette date,
Nouveau ne cesse de guerroyer contre ceux
qui entreprennent de publier ses uvres et exige de ses amis qu'ils lui restituent les
manuscrits qu'il leur a confiés. Les années ayant passé, on le
voit même songer à récupérer les épreuves des Valentines
pour, dit-il, en tirer une "plaquette". Dans une lettre du 6 juin
1909, il accuse (à juste titre) son ami et guide spirituel
Léonce de Larmandie, polytechnicien catholique féru
d'occultisme, de confisquer son jeu d'épreuves de 1891 :
"[...] quant aux épreuves
des Valentines, nous comprenons enfin que vous ne les
rendrez ni communiquerez jamais ! Vous ne consultez dans
toutes ces questions que votre seul intérêt. C'est dommage,
car en changeant le titre de l'ouvrage, en supprimant
certaines pièces, en en corrigeant certaines autres cela
aurait pu faire une plaquette dont la publication eût pu
m'être utile. Vous me privez de mon travail."
[43]
Tout cela pour dire que Germain Nouveau s'est toujours montré,
d'une manière ou d'une autre, fort soucieux du destin de ses
productions. Présent
presque continument à Paris dans les années 1885-1891 et en pleine
activité littéraire, il a nécessairement lu Les Poètes maudits,
appris la parution des Illuminations, eu connaissance des
éloges décernés au recueil par Verlaine (dans les
Maudits et la préface de la plaquette La Vogue) et
par Fénéon (compte rendu des Illuminations dans la
revue Le Symboliste d'octobre 1886). Il serait
inconcevable qu'il n'ait pas fait savoir à ce moment-là que les proses des Illuminations étaient de lui, si tel avait été le cas. "Eddie Breuil, explique Lhermelier, balaie ces
incohérences en renvoyant à une lettre d'André Breton, parue
dans L'Éclair en 1923, dans lequel le poète-théoricien
écrivait : « Germain Nouveau, et c'est, je crois, le sens de
toute son attitude, se moquait bien de voir attribuer telle ou
telle chose à qui que ce soit, et à soi-même ». En 1920, sur son
grabat de Pourrières, sans doute. En 1886, dans les milieux
littéraires parisiens, certainement pas" (p.237).
Laissons le soin à Yalla Seddiki de résumer et de
conclure : "Pour lui [Eddie Breuil] Rimbaud n'a pas parlé du
contenu des textes qu'il a donnés à Verlaine en février 1875. Il
n'a pas dit à Verlaine qu'il est l'auteur des textes. Nouveau
n'a jamais parlé de ces textes à Verlaine ni à qui que ce soit.
Par ailleurs, d'après Eddie Breuil, il est possible que Nouveau
ait oublié l'existence de ces textes pensant les avoir égarés.
Quand, ensuite, il a vu les textes publiés et qu'il en a parlé
avec son ami Delahaye, l'un des deux éditeurs [44],
en tant que « personne modeste et humble », Germain Nouveau a
préféré se taire. Ces opinions prennent pour nous le caractère
d'une succession d'invraisemblances qui démontrent l'impasse
vers laquelle aboutit l'entreprise qui veut déposséder Rimbaud
de ses Illuminations" (p.154).
Mais, chez Cyril Lhermelier comme chez Yalla
Seddiki, le propos se complète d'un second groupe
d'arguments concernant la question sur laquelle les
rimbaldiens, selon Michel Murat, ont spontanément tranché "sans
preuve mais avec raison" : Nouveau, en tant qu'écrivain,
était-il susceptible de
produire quelque chose de semblable aux Illuminations ?
Ces dernières, inversement, sur le plan thématique,
sur celui de l'écriture, ne portent-elles pas la marque de
Rimbaud ? La conviction d'Eddie Breuil, en ces matières, se
fonde sur une multitude de citations et d'observations de détail
dont nos deux contradicteurs s'attachent à discuter la
pertinence ou la portée (que Rimbaud et Nouveau partagent un
même attrait pour certains thèmes, les évocations urbaines par
exemple, qu'on trouve du Rimbaud chez Nouveau et du Nouveau chez
Rimbaud à l'époque où ils se sont fréquentés, rien de tout cela
n'est décisif pour déposséder l'un au profit de l'autre, etc.).
En ce qui concerne la manière littéraire, Yalla Seddiki estime
qu'il est impossible de confondre
les options respectives des deux poètes. Nouveau, qui a une
prédilection pour le vers régulier, n'a quasiment pas écrit,
selon lui, de poèmes en prose. Ses productions en prose relèvent
généralement de la chronique ou du conte, dans une forme
d'écriture assez académique. Cyril Lhermelier fait le même
constat : "Les poèmes connus de Nouveau en 1874 sont de longs
et très beaux poèmes faits de quatrains d'alexandrins à rimes
croisées, ou des sonnets assez hermétiques envoyés à Mallarmé,
mais de proses semblables aux Illuminations, aucune, ni
avant 74, ni après. Rimbaud, lui, a écrit Une saison en enfer"
(p.243). Lhermelier juge notamment que les Notes parisiennes
de Germain Nouveau, dont ce que nous appelons les
Illuminations seraient issues d'après Breuil, "truffées de
noms de lieux et de personnages fantaisistes, sont toutefois
très différentes et, nous le pensons, poétiquement très
inférieures aux poèmes des Illuminations" (p.250). On
observe beaucoup plus de différences, explique Yalla Seddiki, et
c'est sa conclusion, entre les poèmes des Illuminations
et tout ce que nous connaissons par ailleurs de Nouveau qu'entre
ces mêmes Illuminations et le reste de l'uvre de
Rimbaud :
"L'analyse des lettres et textes écrits par Rimbaud entre
1870 et 1873 révèle une continuité imaginative, lexicale et
phrastique incontestable. Les mêmes expressions, les mêmes
structures avec les mêmes vocables se retrouvent d'un texte
à un autre. Sur une cinquantaine de poèmes présents dans les
Illuminations, dix-huit contiennent au moins deux
fragments citatifs que l'on peut retrouver dans des textes
et lettres, de 1870 à Une saison en enfer écrite
entre avril et août 1873. Le texte Vagabonds contient
même des convergences lexicales et sémantiques avec une
lettre de Rimbaud de 1873 et une autre de 1883.
Tous ces faits tangibles et toutes nos analyses nous
font obligation d'attribuer à Rimbaud la paternité des
Illuminations.
Arthur Rimbaud est bien l'auteur des Illuminations
d'Arthur Rimbaud" (p.246).
____________________
N.B.
Le texte a été mis en ligne le 12/04/2018. Mais nous nous sommes
autorisés après coup de nombreux embellissements. Nous en
énumérons ci-après les plus importants.
Plusieurs corrections ont été apportées sur la base d'observations
justifiées faites par David Ducoffre. Merci à lui. Un
paragraphe a été ajouté après la découverte par Frédéric Thomas
de la
lettre de Rimbaud à Jules Andrieu datée du 16 avril 1874. La
question 8 a été ajoutée fin 2019. Un commentaire des
interventions de Jacques Bienvenu et David Ducoffre dans le
débat sur la pagination des manuscrits a été ajouté en janvier
2020 à la fin de la "Question 5" (partie du texte qui suit la
note 22). En janvier 2020 aussi, le premier paragraphe de la
"Question 5" et la note 15 ont été remodelés de
manière à faire référence à notre page intitulée :
Félix Fénéon, premier éditeur des Illuminations ?
Retour haut de page |