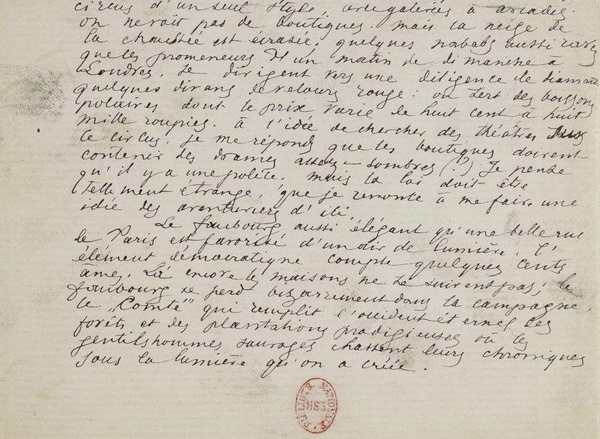|



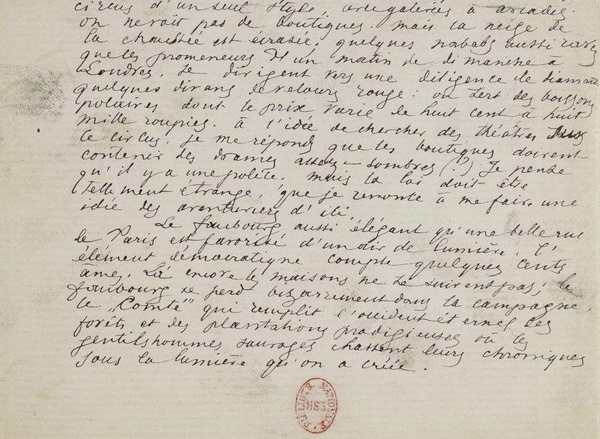 |
|
Villes
("L'acropole officielle") occupe, dans le dossier des 29 premiers
poèmes des Illuminations, la fin du feuillet 16 et le
feuillet 17 dans sa totalité (ci-contre). Henry de Bouillane de
Lacoste a identifié, en 1949, la main de Germain Nouveau dans la
transcription du poème. Le titre, par contre, a été tracé par
Rimbaud. La participation de Nouveau permet de dater ces manuscrits
du séjour commun des deux poètes à Londres, au printemps 1874. On
suppose que Nouveau s'est vu confier cette tâche en vertu de la
densité de son écriture, plus susceptible que celle de Rimbaud de
parvenir à inscrire le texte dans l'espace disponible.
On déchiffre aisément
sous le titre "Villes" le chiffre "I", raturé. André Guyaux a
proposé en 1985 l'explication suivante. Rimbaud aurait d'abord
projeté de regrouper sous le même titre les poèmes commençant par
"L'acropole officielle", numéroté "I", et "Ce sont des
villes",
numéroté "II". Mais un hasard des opérations de transcription
(peut-être une erreur de Nouveau) ayant placé le "I" à la suite du "II"
(sans possibilité d'y remédier vu le chevauchement des textes sur
les feuillets 15-16-17), Rimbaud se serait résolu à supprimer cette
numérotation et à répéter le titre "Villes" en tête de "Ce sont des
villes" (on voit effectivement un "II" biffé et surchargé sous le
titre "Villes" de "Ce sont des villes"). Cette histoire du texte
expliquerait pourquoi "L'acropole officielle", qui évoque une ville
particulière (cf. par exemple : "la profondeur de la ville"), porte
un titre au pluriel. Dans son édition de la Bibliothèque de La
Pléiade, André Guyaux rétablit dans l'intitulé des poèmes les
numéros biffés par Rimbaud, en contradiction avec l'ordre dans
lequel les poèmes apparaissent dans la même édition. D'autres
éditeurs, pour éviter cette source de confusion, présentent chacun
de ces poèmes sous un dispositif titulaire faisant suivre le mot
"Villes" de son incipit.
Ligne 5 du fo 17 :
"Quelle peinture !"
On lit dans le manuscrit : "Qu'elle peinture !".
Les éditeurs corrigent. De même, on est en droit de corriger, l.21,
"plates-formes" en "plateformes" et, l.34, "huit cent" en "huit
cents".
Lignes 7-8 du fo 17 :
"les subalternes que j'ai pu voir sont déjà plus fiers que des
Brahmas"
Longtemps considéré comme illisible, le mot "Brahmas" (surchargeant
"Nababs" dans le manuscrit) est aujourd'hui généralement admis (cf.
Guyaux, 1977, et Poétique du fragment, p.123).
Lignes 8-9 du
fo 17 :
"et j'ai tremblé à l'aspect de colosses des
gardiens et officiers de constructions"
On lit dans le manuscrit : "et j'ai tremblé à
l'aspect des gardiens de colosses et officiers de constructions."
Considérant que Nouveau s'est sans doute rendu coupable d'une
malencontreuse interversion, ainsi qu'il l'explique dans Poétique
du fragment (p.122), André Guyaux, dans son édition de la
Bibliothèque de La Pléiade (que nous suivons), corrige le texte du
manuscrit. Roger Little (op. cit.), Steve Murphy (op. cit.) et
Pierre Brunel (op. cit. 2004) ne trouvent pas cette correction
nécessaire (si les "colosses" sont des monuments colossaux, ils
peuvent en effet avoir des "gardiens"). Albert Henry, par contre, la
justifie (op. cit.).
Ligne 11 du
fo 17 : "on évince les
cochers"
André Guyaux a montré que les éditeurs l'ayant précédé ont eu tort
de lire "on a évincé". Ils ont manifestement pris pour un
accent aigu sur le e final du verbe ce qui n'est qu'une virgule
appartenant à la ligne précédente et le "a" au crayon inséré devant
le participe passé ainsi formé n'est qu'une correction allographe et
indue. Lignes 35-37
du fo 17 : "A l'idée de chercher des théâtres sur ce circus,
je me réponds que les boutiques doivent contenir des drames
assez sombres."
On lit dans le manuscrit : " [...] les boutiques doivent contenir des drames
assez — sombres (?)" Dans son édition de
la Bibliothèque de La Pléiade, André Guyaux ne conserve ni le tiret
devant "sombres", ni le point d'interrogation entre parenthèses qui
le suit. Dans Poétique du fragment (p.120-121), il penchait
pour attribuer ces bizarreries à Nouveau. Celui-ci aurait pu
allonger de façon anormale et pour une raison inconnue le trait
d'union assez courant au XIXe siècle entre l'adverbe
(l'adverbe "très" le plus souvent) et l'adjectif (cf. "très-bizarres"
dans Vagabonds et "très-méchants" dans Phrases). Il
aurait pu placer ce point d'interrogation soit parce qu'il
rencontrait un problème de déchiffrage, soit parce qu'il s'étonnait
du caractère apparemment contradictoire entre la phrase concernée
et, quelques lignes plus haut, la phrase : "On ne voit pas de
boutiques."
Steve Murphy se montre plus nuancé : certes, dit-il, on ne
rencontre nulle part ailleurs chez Rimbaud un point d'interrogation
entre parenthèses. Mais celui-ci pourrait avoir été placé par
Rimbaud pour renforcer le sentiment de perplexité qui émane de toute
cette fin de paragraphe (§2 du poème). En tous cas, il n'y a pas de
contradiction dans le texte, selon lui, même si Nouveau a pu se
méprendre : "le locuteur ne voit pas de boutiques, mais déduit qu'il
doit y en avoir" (op. cit. p.610-611).
Lignes 49-50
du fo 17 : "quelques cents âmes"
De Berrichon à Guyaux inclus, les éditeurs corrigèrent longtemps
en "quelque cent âmes". Mais Guyaux rétablit à juste titre
l'orthographe du manuscrit dans sa plus récente édition et cite
Chateaubriand : "Combien de fois l'Angleterre, dans l'espace de
quelques cents ans, a-t-elle été détruite !" (Mémoires
d'outre-tombe, XXVII, XI). |