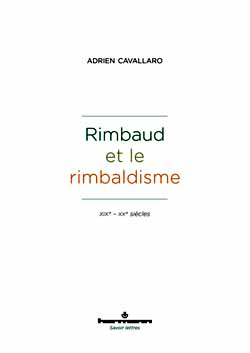|
[1] Avec l'autorisation de l'auteur, je reproduis ici, sous une forme légèrement adaptée, un extrait des p. 90-94 (3.2.1 & 3.2.2) de Rimbaud et le Rimbaldisme, XIXe-XXe siècles, Paris, Hermann, coll. "Savoir Lettres", 2019. Adrien Cavallaro y analyse le compte rendu publié par Félix Fénéon dans Le Symboliste, lors de la réimpression en plaquette des Illuminations. La revue Le Symboliste du 7 oct. 1886 est consultable sur Gallica. [2] Fénéon, Félix, « Les Illuminations d’Arthur Rimbaud », Le Symboliste, n°1, octobre 1886.
[3] « [C]hevalet féerique ! » ; « cette promesse, cette démence ! » (Illuminations, éd. citée, p. 297). [4] « Honte ».
|
Le compte rendu des Illuminations par Félix Fénéon dans Le Symboliste
UN RECLASSEMENT DES ILLUMINATIONS
par Adrien Cavallaro [1] |
|
|
3.2.1. Le geste de réagencement des Illuminations
Explicitant la succession des poèmes dans la table des matières de l’édition d’octobre 1886, ce long paragraphe, qui précède une clausule dont on serait tenté de faire la bannière formulaire du mythe, s’attache à retracer un parcours d’émancipation progressive, en quatre étapes nettement scandées qui dramatisent un rapport conflictuel entre l’individu et un ordre cosmique, urbain et social. S’il n’est pas douteux que cette dynamique d’affranchissement coïncide linéairement avec la table des matières, il est parfois malaisé de distinguer avec netteté la frontière qui sépare chacun des ensembles. Le premier regroupe ainsi les « révolutions cosmiques », et semble s’étendre d’« Après le Déluge » à « Mouvement », dans la mesure où le second, celui des « Villes monstrueuses », commence vraisemblablement avec « Villes [II] » (« Ce sont des villes ! »), poème qui compte assez aux yeux de Fénéon pour qu’il en retienne un extrait en ouverture de l’anthologie de son article. Les deux premiers ensembles organisent ainsi une genèse urbaine en ménageant la transition d’un ordre cosmique (dont les deux premiers poèmes, « Après le Déluge » et « Barbare », sont les emblèmes) à un ordre social paradoxal où « une humanité hagarde […] développe une féerie de crime et de démence ». C’est ici que la frontière avec le troisième ensemble est particulièrement trouble : « féerie » et « démence » sont des mots de « Matinée d’ivresse [3] », ce qui inviterait à inclure le poème dans cette série qui pourrait s’étendre jusqu’à « Conte ». Dans l’anthologie, cependant, Fénéon réunit « “Matinée d’ivresse”, “Tant que la lame n’aura [4]…”, “Conte”, “Vagabonds” » comme exemples de pages qui « documentent une vie intime, des détraquements saturniens » et « deviennent presque anecdotiques » : ces poèmes sont également groupés dans l’édition d’octobre 1886, et se succèdent presque dans cet ordre (« Phrases » est intercalé entre « Matinée d’ivresse » et « Conte », et « Tant que la lame n’aura… » succède à « Conte »). On inclinerait donc plutôt à ouvrir sur « Matinée d’ivresse » le troisième ensemble, centré sur l’isolement d’un « individu », moment de crise où le désir d’une « vie végétative » va de pair avec le choix formel des « labiles chansons murmurées » de 1872, c’est-à-dire ce que Verlaine appelait l’époque des « prodiges de ténuité, de flou vrai, de charmant presque inappréciable à force d’être grêle et fluet [5] ». Mais si chez Verlaine ce mouvement d’exténuation du vers lançait la carrière du prosateur, si donc la prose naissait de l’extinction du vers, le mouvement est ici exactement inverse, discrètement déterminé, aussi, par une caractérisation genrée : virile, la « primitive prose souple, musclée et coloriée », précède un vers plus féminin ; à la prose revient le récit des origines chaotiques et de la genèse urbaine, au vers, l’émancipation de l’individu. C’est donc en conférant aux questions formelles une dimension éthique et sociale que Fénéon, dans son reclassement, parvient à doter les vers de 1872 d’une nécessité interne dans le recueil, alors que leur intégration aux publications de la revue, en juin, était accidentelle. |
||
|
[7] Voir Murat, Michel, L’Art de Rimbaud, op. cit., p. 236-238.
|
De « Dévotion » à « Démocratie », enfin, le dernier ensemble, le
plus resserré, est articulé autour de « sursauts » politiques : il
s’agit d’une sortie de crise idéologique, qui retrouve la dimension
collective et sociale du deuxième ensemble, mais pourvues cette fois
de vertus régénératrices. En accord avec les convictions
anarchisantes du critique [6], le salut en passerait par une
« insulte » à la « Démocratie militaire et utilitaire ». Cette
dimension personnelle de la reconfiguration est évidente, et l’on ne
s’attardera pas ici à la gloser. Elle risquerait surtout d’occulter
ce qui motive en profondeur le choix de ce schéma quadripartite et
de son orientation : une lecture attentive, d’une profonde
intelligence, d’« Alchimie du verbe », dont un extrait est très
significativement placé en épigraphe du compte rendu (« … et avec
des rhythmes [sic] instinctifs, je me flattai d’inventer un verbe
poétique accessible, un jour ou l’autre, à tous les sens. Je
réservais la traduction. (A. R.) »).
|
|
|
[8] « Délires II. Alchimie du verbe », Une saison en enfer, éd. citée, p. 268.
[9] Ibid., p. 265.
[10] Cette « littérature » est proche du « Tout le reste est littérature » verlainien (« Art poétique », Jadis et naguère [1884], édition critique établie, annotée et présentée par Olivier Bivort, Paris, Le Livre de Poche, coll. « Les Classiques de Poche », 2009, p. 83) ou de la « vague littérature » mallarméenne (« Toute l’âme résumée… » [1895], dans Œuvres complètes, édition présentée, établie et annotée par Bertrand Marchal, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », t.I, 1998, p. 60). |
3.2.2. Un reclassement au miroir d'« Alchimie du verbe » La ressaisie paraphrastique manifeste en effet l’ambition d’ordonner cette dispersion du corpus, d’en conjurer en quelque sorte le morcellement en l’inscrivant dans un projet idéologique et existentiel, selon un modèle narratif et herméneutique clairement inspiré d’« Alchimie du verbe », et qui tisse un lien étroit entre le silence du poète et ses choix poétiques. Une phrase en particulier du paragraphe qui précède la paraphrase finale l’atteste : « Il s’évada des Lettres et des hommes […], cherchant en des voyages hasardeux à dissiper l’hallucination où se suppliciait son génie », qui fait référence à l’un des derniers paragraphes du second des « Délires » :
L’intertextualité importe ici moins que le choix d’un schéma interprétatif, à deux niveaux : Fénéon interprète le silence à l’aune du récit de crise d’Une saison en enfer, mais, bien plus, il fonde son classement éditorial des Illuminations sur celui-ci, et c’est dans ce sens qu’il convient de relire la troisième étape de la table des matières d’octobre 1886 : le désir d’une « vie végétative », les « labiles chansons murmurées, mourant en un vague de sommeil commençant », non seulement renvoient explicitement à « Alchimie du verbe » (plus précisément, au paragraphe de la « félicité des bêtes » : « J’étais oisif, en proie à une lourde fièvre : j’enviais la félicité des bêtes, – les chenilles, qui représentent l’innocence des limbes, les taupes, le sommeil de la virginité [9] ! »), mais réinvestissent la trajectoire de crise globale du sujet que décrit la section. Il n’est pas nécessaire de chercher à toute force à superposer la section et la paraphrase : c’est avant tout le schéma explicatif de crise que Fénéon retient, et qu’il reprend pour justifier l’intégration des vers de 1872, mais aussi pour orchestrer le sursaut final, qui, s’il n’est pas un « salut à la beauté », n’en est pas moins, par des voies tout autres que dans Une saison en enfer, une sortie de crise en accord avec des préoccupations personnelles. L’ambition de Fénéon pour l’édition en plaquette est donc moins philologique, comme elle a vraisemblablement pu l’être pour l’impression en revue, qu’herméneutique. Elle résulte d’un réflexe de défense critique, à la fois devant l’hermétisme du corpus, et devant ce qui, d’instinct, est perçu comme une puissance de morcellement du poème en prose rimbaldien (plus que des vers de 1872, quant à eux en instance d’effacement dans l’interprétation du critique). L’édition en plaquette des Illuminations aux Publications de La Vogue est en ce sens capitale, parce que, plus encore que l’anthologie des Poètes maudits, elle est la première expression d’un caractère imprescriptible de l’histoire éditoriale rimbaldienne, valable dès la fin du XIXe siècle : l’édition des œuvres de Rimbaud procède d’une forme d’herméneutique téléologique du parcours du poète, comme aspirée par le silence. En l’occurrence, la trajectoire organisée par le critique est inséparablement poétique, existentielle et idéologique, ce dont témoigne l’échappée signifiée par la clausule, « Œuvre enfin hors de toute littérature, et, probablement, supérieure à toute », qui est aussi le couronnement d’une confusion entre la vie et l’œuvre : de même que l’homme s’est affranchi du poète (« Il s’évada des Lettres et des hommes »), l’œuvre s’est affranchie de « toute littérature », c’est-à-dire, ici, de « toute littérature » utilitaire [10]. Le cas de Fénéon est d’autant plus intéressant que le reclassement est pleinement assumé et qu’y perce nettement un autre aspect majeur de l’histoire éditoriale rimbaldienne, à savoir que celle-ci puise ses principes dans l’œuvre du poète et répond ainsi au silence littéraire en se faisant l’écho d’une voix de l’œuvre diversement modulée par les configurations retenues. Le dessein de classer « dans un ordre logique », thématique, répond chez Fénéon à un besoin de narrativisation d’un corpus centrifuge. En éditant, le critique propose une exégèse remarquable dont il faut bien comprendre, non seulement qu’elle se réclame indirectement de l’œuvre, mais qu’elle trouve une caution dans certains de ses schémas interprétatifs, et en particulier dans ce qui est sa première matrice éditoriale, « Alchimie du verbe ». Comme chez Verlaine, se fait ainsi jour une téléologie éditoriale, aimantée par le silence littéraire, dont les ressorts sont tout ensemble poétiques et biographiques : l’agencement de l’œuvre explique le silence, en assimilant à divers degrés les choix formels et existentiels du poète, par la configuration d’une trajectoire poétique segmentée en étapes. |
|
|
|
||
|
|
||
|
|