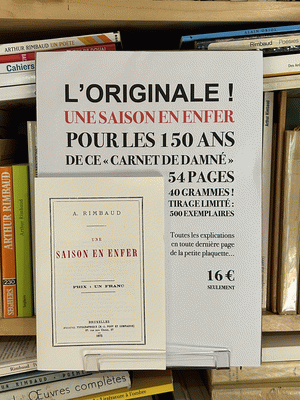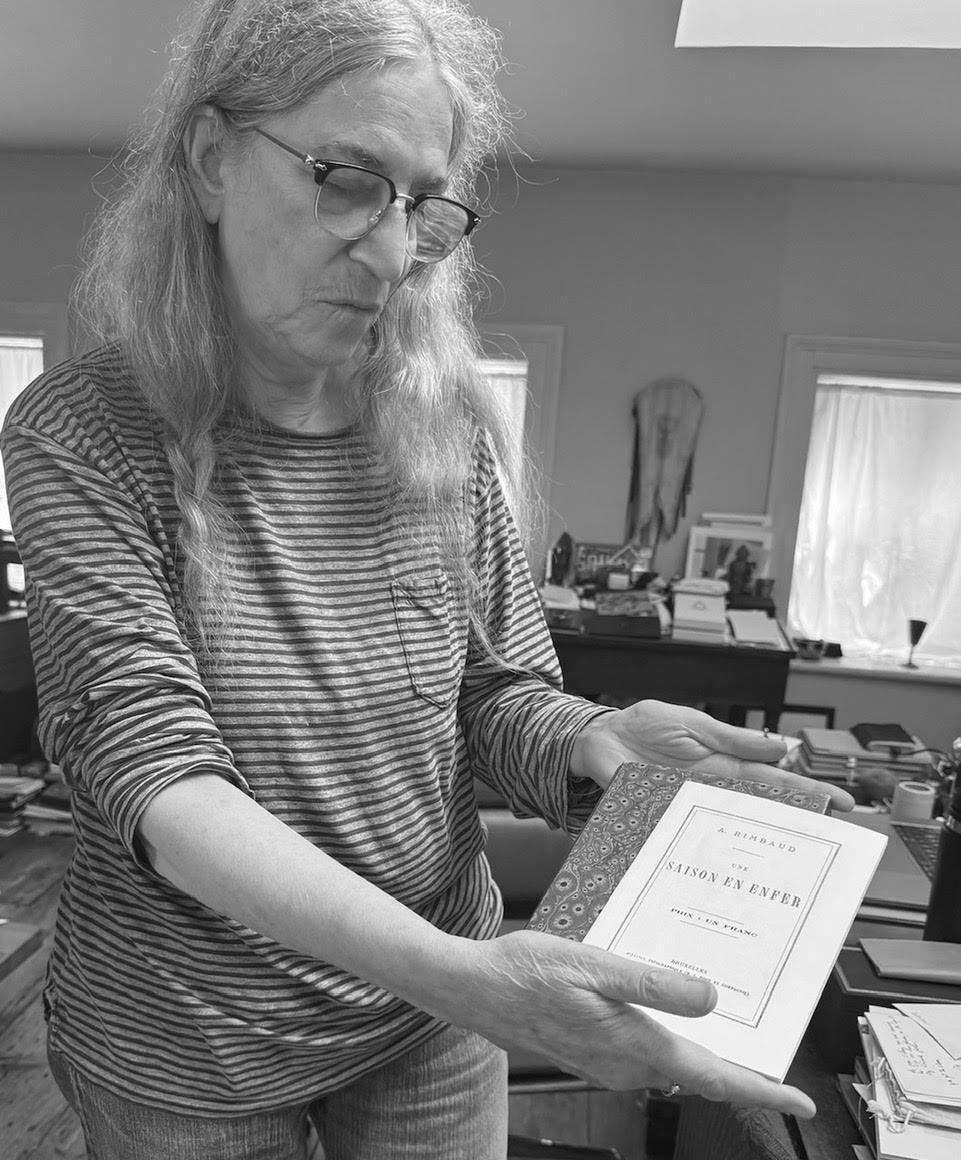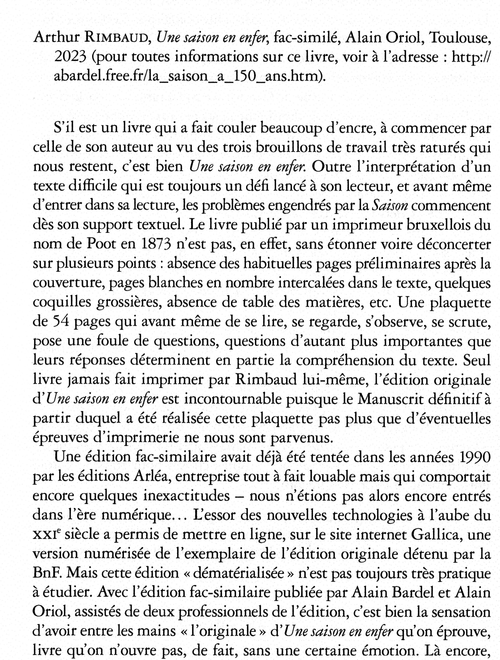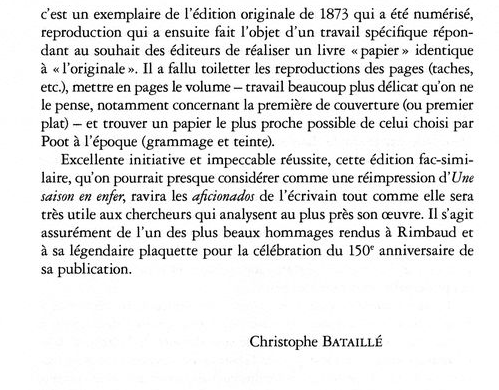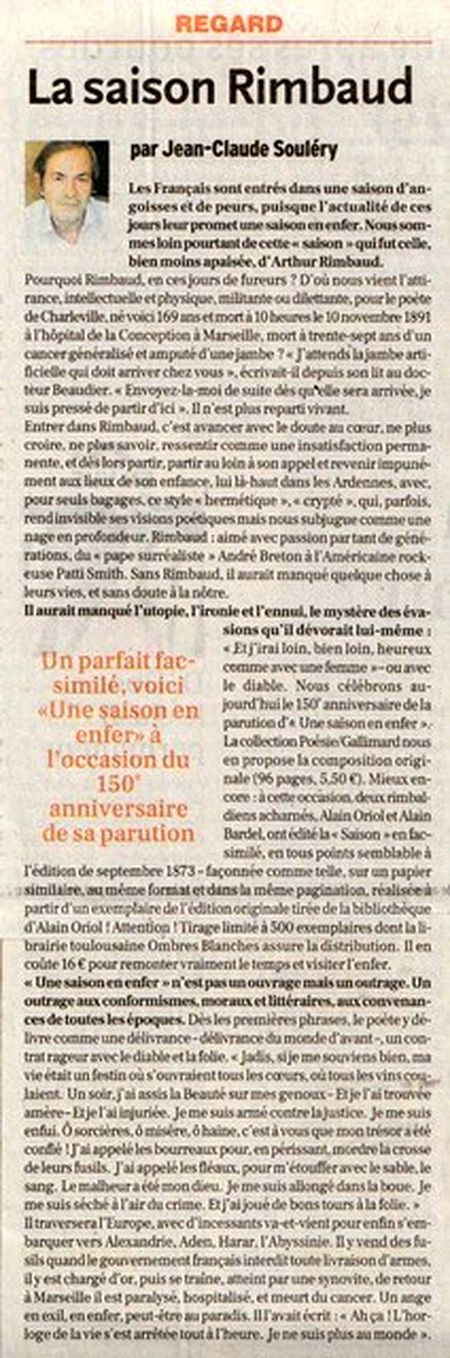|
|
||||||
|
Une
saison en enfer,
fac-similé,
Il y a cent cinquante ans, un modeste petit livre appelé à devenir
mythique est sorti des presses de L'Alliance typographique, M.-J. Poot et Compagnie, 37, rue aux Choux, Bruxelles. Son titre en
lettres rouges ressortait sur la couverture : Une saison en
enfer.
Pour la première fois, Rimbaud était parvenu à conduire une de ses
œuvres jusqu'au stade de l'impression. Ce fut aussi la dernière.
|
||||||
|
|
Gazette de la librairie Ombres blanches |
|||||
|
|
Rimbaud. Alain Oriol (éd.), Fac-similé de l’édition originale d’Une saison en enfer, Toulouse, 2023, 56 p., 16 € ; Alain Bardel, Une saison en enfer ou Rimbaud l’introuvable. Fac-similés de l’édition originale, précédés d’un essai, Toulouse, Presses universitaires du midi, 2023, 195 p., 20 €.
L’automne 2023 aura été rimbaldien. Le goût des anniversaires,
particulièrement prononcé quand il s’agit des auteurs
patrimoniaux, qui s’était exercé en 2021 avec Baudelaire dans le
domaine poétique, a favorisé de nombreuses publications autour
des 150 ans d’Une saison en enfer, la seule œuvre qu’ait
publiée Rimbaud, et qu’il a datée d’« avril-août, 1873 ». Parmi
ces publications, la plus émouvante, sans aucun doute, est le
fac-similé proposé par Alain Oriol, détenteur d’un exemplaire
original qui a servi de modèle à cette entreprise passionnée. La
quatrième de couverture commerciale, située avant la quatrième
du fac-similé à proprement parler, en définit ainsi l’ambition :
« La présente édition, façonnée comme l’originale, réalisée dans
un papier similaire, au même format et dans la même pagination,
est la première qui puisse être considérée comme une
“reproduction à l’identique”. » C’est
ce parti pris de fidélité typographique à l’édition originale
qu’adopte l’essai que le même Alain Bardel, complice d’Alain
Oriol pour le fac-similé, bien connu des rimbaldiens pour
l’excellent blog qu’il anime depuis plus de vingt ans (abardel.free.fr),
consacre à Une saison en enfer (Une saison en enfer
ou Rimbaud l’introuvable), en proposant une formule
critique originale. Le lecteur y trouvera en effet un essai (p.
9-96) sur l’« espèce de prodigieuse autobiographie
psychologique » dont parle Verlaine dans Les Poètes maudits,
suivi de fac-similés de l’édition originale (pages de droite)
annotés (page de gauche), ou plutôt commentés à chaque point de
résistance du texte. L’essai est conçu comme une introduction
aux grands enjeux de l’œuvre, qui, sans négliger ses
prédécesseurs, ne s’embarrasse pas d’un trop encombrant appareil
de bas de page. À la progression habituellement retenue dans les
ouvrages critiques portant sur Une saison en enfer,
celle qui s’attache successivement à l’élucidation de chaque
section (et que l’on trouve dans les livres de Yoshikazu Nakaji,
Combat spirituel ou immense dérision ?[Corti, 1987], de
Yann Frémy, Te voilà, c’est la force ! [Garnier, 2009],
ou plus récemment, d’Alain Vaillant, Une saison en enfer de
Rimbaud ou le livre à la « prose de diamant » [Champion,
2023]), Alain Bardel préfère une structuration en diptyque :
après avoir synthétisé les éléments de genèse nécessaires à la
compréhension du projet de l’œuvre (en particulier, la lettre
dite « de Laïtou », adressée en mai 1873 à Ernest Delahaye,
qu’avait en son temps analysée en détail le regretté Yann
Frémy), il examine d’abord la question autobiographique, avant
de revenir sur des questionnements existentiels structurants. Ce
choix, qui a le mérite de la clarté, offre au lecteur une bonne
entrée pédagogique dans l’œuvre, un accompagnement à la
compréhension, en particulier, de son vertigineux travail
énonciatif, auquel Alain Bardel applique une belle image,
lorsqu’il rapproche le questionnement rimbaldien de l’identité
du « “labyrinthe de miroirs” » de La Dame de Shanghai,
d’Orson Welles. À ce titre, l’approche d’« Alchimie du verbe »,
où Alain Bardel discerne deux voix, celle du « fou » et celle du
« sage » (p. 34-36), reprenant ainsi une tradition de glose
qu’avait magistralement nourrie Steve Murphy dans Stratégies
de Rimbaud (Champion, 2004), retient l’attention, de même
que les approches, nombreuses, des sections de « Mauvais sang ».
Les pages consacrées à « Mauvais sang » [VII] (p. 31-34 et p.
39-40) donnent également un excellent aperçu de la méthode
adoptée, patiente, proche de la lettre du texte, soucieuse de
suivre toutes les volte-face du « combat spirituel » du locuteur
et prenant l’exact contrepied de celui qui, dans « Alchimie du
verbe », affirme avoir « réserv[é] la traduction » de ses
productions en vers. Adrien Cavallaro
|
|||||
|
|
||||||
|
|
||||||