|
|
L'Homme juste (juillet 1871)
|
|
|
|
L'Homme juste
..................................................................
Le Juste restait droit sur ses hanches solides :
Un rayon lui dorait
l'épaule ; des sueurs
Me prirent :
« Tu veux voir rutiler les bolides ?
Et, debout, écouter
bourdonner les flueurs
25 D'astres lactés, et les essaims
d'astéroïdes ?
« Par des
farces de nuit ton front est épié,
Ô Juste ! Il faut
gagner un toit. Dis ta prière,
La bouche dans ton
drap doucement expié ;
Et si quelque égaré
choque ton ostiaire,
30 Dis : Frère, va plus loin, je suis
estropié ! »
Et le Juste restait
debout, dans l'épouvante
Bleuâtre des
gazons après le soleil mort :
« Alors,
mettrais-tu tes genouillères en vente,
Ô vieillard ? Pèlerin
sacré ! Barde d'Armor !
35 Pleureur des Oliviers ! Main que la
pitié gante !
« Barbe de la
famille et poing de la cité,
Croyant très doux
: ô cœur tombé dans les
calices,
Majestés et
vertus, amour et cécité,
Juste ! plus bête
et plus dégoûtant que les lices
!
40 Je suis celui qui souffre et qui
s'est révolté !
« Et ça me
fait pleurer sur mon ventre, ô stupide,
Et bien rire,
l'espoir fameux de ton pardon !
Je suis maudit, tu
sais ! Je suis soûl, fou, livide,
Ce que tu veux !
Mais va te coucher, voyons donc,
45 Juste ! Je ne veux rien à ton
cerveau torpide.
« C'est toi
le Juste, enfin, le Juste ! C'est assez !
C'est vrai que ta
tendresse et ta raison sereines
Reniflent dans la
nuit comme des cétacés !
Que tu te fais
proscrire et dégoises
des thrènes
50 Sur d'effroyables becs de
can(n)e
fracassés !
« Et c'est
toi l'œil de Dieu ! le lâche ! quand les plantes
Froides des pieds
divins passeraient sur mon cou,
Tu es lâche ! Ô
ton front qui fourmille de lentes !
Socrates et Jésus,
Saints et Justes, dégoût !
55 Respectez le Maudit suprême aux
nuits sanglantes ! »
J'avais crié cela
sur la terre, et la nuit
Calme et blanche
occupait les Cieux pendant ma fièvre.
Je relevai mon
front : le fantôme avait fui,
Emportant l'ironie
atroce de ma lèvre...
60 — Vents nocturnes,
venez au Maudit ! Parlez-lui !
Cependant que,
silencieux sous les pilastres
D'azur, allongeant
les comètes et les nœuds
D'univers,
remuement énorme sans désastres,
L'ordre, éternel
veilleur, rame aux cieux lumineux
65 Et de sa drague en feu laisse filer
les astres !
Ah ! qu'il s'en
aille, lui, la gorge cravatée
De honte, ruminant
toujours mon ennui, doux
Comme du sucre sur
la denture gâtée.
—
Tel que la chienne après l'assaut des fiers
toutous,
70 Léchant son flanc d'où pend une
entraille emportée.
Qu'il dise charités
crasseuses et progrès...
—
Ô j'exècre tous ces yeux de Chinois
[...] daines,
[...]
qui chante :
nana, comme un tas d'enfants près
De mourir, idiots
doux aux chansons soudaines :
75 Ô Justes, nous chierons dans vos
ventres de grès !
|
|
|
Interprétations |
|
|
|
La mention
"op. cit." renvoie à la bibliographie proposée en fin de
page.
Le Juste :
Ce terme, qui désigne le "fantôme"
(v.38) pris à partie par le narrateur, ne renvoie pas à
Jésus-Christ comme le voulait une lecture ancienne du poème. Une
interprétation plus récente, suggérée par Marc Ascione
dès 1984 (op.cit) et solidement argumentée par Yves Reboul dans
son article de 1985 (op. cit.) y a décelé la figure de Victor
Hugo.
Seul parmi les rimbaldiens de quelque
autorité, Pierre Brunel continue de préférer l'explication
traditionnelle (le Juste = le Christ). Cette lecture s'appuie sur le
fait que le Christ est souvent appelé le Juste dans les Évangiles.
C'est aussi, précise Pierre Brunel, le nom donné aux hommes
qui seront déclarés dignes du salut au jugement dernier (Rimbaud,
Oeuvres complètes, La Pochothèque, p.271, note 1).
Mais Yves Reboul et, à sa suite, Antoine
Fongaro, Steve Murphy, ont produit de nombreux
exemples démontrant que Victor Hugo utilise avec insistance ce
qualificatif, notamment dans "Pas de représailles", un
poème publié le 21 avril 1871 dans Le Rappel et que Rimbaud
pouvait très bien avoir lu. Ce texte manifeste hautement la
désapprobation de Hugo à l'égard de la "loi des otages"
par laquelle la Commune menaçait Versailles d'exécuter trois
otages pour chaque fédéré assassiné. L'auteur de L'Année
terrible y prodigue ses conseils de modération au parisien
aveuglé par l'esprit de vengeance : "Sois juste, c'est ainsi
qu'on sert la république ; / Le devoir envers elle est l'équité
pour tous ; / Pas de colère ; et nul n'est juste s'il n'est
doux."
"Le premier livre des Misérables,
note encore Antoine Fongaro (De la lettre à l'esprit,
p.128, note 11) s'intitule Un juste ; l'évêque Myriel,
autoportrait de Hugo, prêche la justice : "soyez des
justes", et la met en pratique : "ainsi vivait cet homme
juste"".
Enfin, il est frappant de trouver chez
Baudelaire (article sur Pierre Dupont, 1851) ce jugement : "Le
public était tellement las de Victor Hugo, de ses infatigables
facultés, de ses indestructibles beautés, tellement irrité de
l'entendre toujours appelé le juste... " (cité par André
Guyaux, "Sur L'homme juste de Rimbaud", Studi
Francesi, 93, 1987). 
restait
droit :
Ce détail descriptif est repris trois vers
plus loin par "debout". C'est la pose hugolienne par
excellence : "Si c'est debout, écrit Yves Reboul (op.
cit. 1985, p.48 et note 11, p.54), que le dérisoire héros de
Rimbaud voudrait se livrer à sa contemplation cosmique, sans doute
est-ce en un rappel sarcastique de la figure si hugolienne du
contemplateur d'infini, qui presque toujours nous est montré debout
sur un faîte" :
Le pâtre songe, solitaire [...]
Mais il sonde l'éther profond.
Toute solitude est un gouffre,
Toute solitude est un mont.
Dès qu'il est debout sur ce faîte,
Le ciel reprend cet étranger.
Victor Hugo
"Magnitudo parvi", III. 
Un
rayon lui dorait l'épaule :
"La figure du mage, comme celle
du Juste chez Rimbaud, est souvent éclairée de rayons dans
la mythologie hugolienne ; cf. par exemple Les mages, XI :
"Ô géants, vous avez encore / De ses rayons dans les
cheveux" (Yves Reboul, op. cit. 1985, p.54). 
Tu
veux voir rutiler les bolides ? :
"Impossible, on en conviendra,
commente Yves Reboul (op.cit. 1985, p.48), de ne pas penser à Hugo
en lisant ces vers : bolides ou astres monstrueux soudainement
apparus, c'est bien la vision de l'univers que développe la poésie
du temps de l'exil. Qu'on se reporte, entre vingt autres textes, à
"Magnitudo parvi" :
Quel est ce projectile inouï de l'abîme ?
Ô boulets monstrueux qui sont des univers !
On comprend dès lors que si le Juste souhaite voir
"rutiler" les bolides, c'est sans doute par allusion au
"flamboiement" stellaire, "de l'infini formidable
incendie" ("Magnitudo parvi" II, v.56)."
Steve Murphy va plus loin et, au
delà de l'aspect simplement parodique, il considère l'évocation
du spectacle des astres dans ce poème comme une métaphore filée
faisant référence au bombardement de Paris par les Versaillais :
"L'isotopie stellaire fournit aussi et surtout à L'homme
juste un stock de comparants pour un comparé qu'il faut mettre
au jour. Les bolides sont des boulets de canon ou obus qui
tombent [...]" (op. cit., p.204). Voir aussi la note suivante. 
écouter
bourdonner les flueurs /
D'astres lactés, et les essaims
d'astéroïdes :
flueurs : "Le mot flueurs peut
évidemment être pris comme déverbal libre à partir du verbe
fluer "couler", explique Steve Murphy (op. cit., p.205). Il y aurait là dans ce cas, semble-t-il penser, un
métaphorisme assez conventionnel, l'idée de la "voie
lactée" suggérant une image liquide. Cependant, faut-il
négliger le sens médical précis du mot désignant d'après le Petit
Robert "des sérosités qui s'épanchent de quelque
partie du corps" ? "L'acception la plus courante, poursuit
Steve Murphy, était "menstrues" et Antoine Adam a donc
choisi cette acception en citant Littré ("Littré dit :
inusité, synonyme de menstrues"), suivi en cela par Jean-Luc
Steinmetz" (ibid. 206). Rimbaud peut avoir aussi songé au sens
de "flueurs blanches", "pertes blanches",
désignant le symptôme féminin de la blennorragie, retrouvant là
pour évoquer la répression de la Commune la métaphore de "la
putain Paris" utilisée dans "L'orgie parisienne",
"où les versaillais sont qualifiés de syphilitiques"
(ibid. 206).
bourdonner, essaims : Toujours
d'après le même critique, le métaphorisme entomologique du
passage décrit le bombardement de Paris par les Versaillais : les
astéroïdes sont des obus, dont les essaims, comme de juste,
bourdonnent. Cf. sa glose sur "bolides".
"Les essaims d'astéroïdes, conclut
Steve Murphy, sont donc des essaims dans le sens entomologique, une
pluie pour ainsi dire de météorites militaires, car ces coulures
sont à la fois vénériennes et martiales" (ibid. 207). 
Par des
farces de nuit ton front est épié
:
Les avis divergent sur l'interprétation de
ce vers, entre Yves Reboul et Steve Murphy : pour le
premier, les "farces de nuit" sont les contemplations
cosmiques
du Juste ; pour le second ces "farces de nuit" sont une
allusion à la lapidation nocturne de la maison de Hugo à
Bruxelles, le 27 mai 1871 (que "certains commentateurs qui
tenaient autant à minimiser l'événement que Hugo à le
dramatiser" avaient présenté comme une "blague" de
jeunes gens éméchés). Voir : Reboul, op. cit. 2005, p.59, note 23
; Murphy, op. cit. 2005, p.198. 
La bouche dans ton
drap doucement expié :
"Selon les imprécations du Maudit, la
bouche de Hugo n'exprimerait plus librement sa pensée ; il l'a
cachée dans son drap puisque, pour être digne de l'hospitalité
belge, il faut se taire." Steve Murphy, op. cit. p.219. 
Et si quelque égaré choque ton ostiaire :
"Le mot ostiaire a ici le sens
de porte" (Reboul, op. cit. 1991, p.1091).
Steve Murphy écrit : "Pour le
mot ostiaire, on a pu proposer deux acceptions :
1° ""porte", sens déduit
de gueux de l'hostiaire (hostiaire chez Rabelais), gueux qui
va de porte en porte" (A. Guyaux, suivi par Y. Reboul).
2° "Le Dictionnaire de l'Académie
dit : autrefois, portier" (A. Adam, suivi notamment par J.-L.
Steinmetz et par L. Forestier)." (op. cit., p.202).
La plupart des commentateurs remarquent que
le terme "égaré" est celui que les bourgeois, et Victor
Hugo lui-même, utilisaient fréquemment pour désigner les
Communeux (ces fous, ces brebis égarées).
"C'est sans aucun doute par allusion
à l'offre d'asile faite à Bruxelles que Rimbaud imagine l'un d'eux
frappant à la porte de Hugo." (Reboul, op. cit. 1985,
p.52). 
après le soleil mort :
Suzanne Bernard commente : "Le soleil
mort est une allusion à l'Évangile où il est dit que le
soleil s'obscurcit à la mort du Christ." (Rimbaud, Oeuvres,
Classiques Garnier, 1961).
Steve Murphy n'estime pas
nécessaire d'abandonner cette référence dès lors qu'on identifie
le Juste à Victor Hugo (et non au Christ) : "Le soleil en
question, c'est la République Sociale sous la forme contemporaine
de la Commune, la Passion de la Révolution s'exprimant dans une
image qui porte l'empreinte de celle du Christ selon une
réciprocité métaphorique traditionnelle, notamment dans la
caricature contemporaine." (op. cit. p.211). 
Alors,
mettrais-tu tes genouillères en vente :
Yves Reboul commente : "Chacun
sait que Hugo priait fréquemment et qu'il n'a pas cessé dans ses
vers d'exalter la prière. Pensons à "La prière pour
tous" dans le recueil déjà ancien des Feuilles d'automne ("À
genoux, à genoux, à genoux sur la terre") ou, dans les Contemplations,
à "Croire, mais pas en nous" qui dans l'architecture
du recueil précède immédiatement "Pleurs dans la nuit"
: "Pensons et vivons à genoux ; / Tâchons d'être sagesse,
humilité, lumière ; / Ne faisons pas un pas qui n'aille à la
prière." Inutile d'insister : l'agenouillement du Juste renvoie
lui aussi à Hugo et donne une clé supplémentaire de cette
imprégnation chrétienne qui a tant contribué à égarer la
critique en lui faisant identifier le héros du poème au Christ :
si Rimbaud sarcastiquement assimile Hugo à un Jésus détesté,
c'est d'abord parce que se vouant à la prière et espérant une
rédemption spirituelle de l'humanité, le poète des Contemplations
participait dès lors de l'aliénation chrétienne, devenait du coup
cet "estropié" que dénonce le poème." (op. cit.
1985, p.50). 
Barde d'Armor :
Répondant à l'argument de Pierre Brunel
selon lequel "Barde d'Armor" ne saurait désigner le Hugo
de Jersey ou de Guernesey dans la mesure où ces îles ne sont pas
armoricaines, Yves Reboul (op. cit. 2005, p.56) avance trois
arguments. Premièrement, ce pourrait être une licence poétique
("la géographie de Hugo de la Légende des siècles offrirait
à cet égard d'impérissables citations"). Deuxièmement, Les
Travailleurs de la mer montrent bien le lien naturel unissant la
Bretagne et spécifiquement Saint-Malo à l'archipel de la Manche.
Troisièmement, le mot Armorique, dans l'usage classique, ne
désignait pas la seule Bretagne mais l'ensemble des pays de la
façade océanique (et Reboul de citer sur ce point la Guerre des
Gaules de César). 
Pleureur des Oliviers
:
La formule désigne blasphématoirement le
Christ, sur le Mont des Oliviers. C'est l'épisode célèbre de la
Passion où le Fils de Dieu éprouve un moment terrible de détresse
et de doute : "Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?" Mais
on remarquera avec quelle pertinence Rimbaud rabat ici la figure du
Christ sur celle de Hugo, dont la poésie cosmique exprime souvent
ce même vertige du doute : l'angoisse devant le vide des cieux, la
quête inquiète du Dieu caché. 
Barbe
de la famille et poing de la cité :
"À qui (ce vers) pourrait-il mieux
s'appliquer, écrit Yves Reboul (op. cit. 1985), qu'à celui qui, au
même moment, se baptisait lui-même "représentant du Peuple
et bonne d'enfants" ?" (Victor Hugo, bien sûr, dans ses Carnets,
à la date du 21 février 1871, cf. L'Année terrible, Poésie/Gallimard,
p.279). 
Croyant très doux :
Cette expression appartient au groupe des
"impossibilités textuelles" qui, pour Yves Reboul,
invalident l'identification du Juste avec la figure du Christ.
Quelle logique y aurait-il en effet, dans ce cas, à ce que "l'Homme
juste soit appelé croyant — et non pas
Maître ou Sauveur — ou encore qu'il soit désigné comme vieillard
et comme Barde" ? (op. cit. 2005, p.54). Par contre,
appliquée à Hugo, la formule sonne comme une critique (commune en
son temps) de la religiosité de Hugo, de sa "douceur"
sans cesse proclamée (thème repris dans l'avant-dernière strophe
du poème :
doux / Comme du sucre sur
la denture gâtée.). 
lices
:
La lice est la femelle du chien de chasse.
"Comme dans Les Assis, Accroupissements ou Les
Pauvres à l'église, sa caricature recourt à l'animalisation.
Hugo est associé aux lices et aux chiennes par le
biais des comparaisons, aux lentes par contiguïté (en fait,
la pensée de Hugo serait elle-même pouilleuse...), mais aussi aux cétacés
..." (Steve Murphy, op. cit. p.217). 
l'espoir fameux de ton pardon ! :
Le Maudit repousse sarcastiquement
le "pardon" du Juste. Il y a là sans aucun doute
possible une allusion d'actualité. Victor Hugo, tout au long de la
Commune, n'a cessé de préconiser le pardon mutuel des
belligérants, en se donnant lui-même comme exemple de cette
mansuétude (autre attitude éminemment christique par parenthèse).
Yves Reboul (op. cit. 1985, p.50) rappelle qu' "il y
avait déjà eu eu un pardon hugolien fameux et c'était celui que
le poète des Châtiments accordait en un sens aux
responsables du 2 décembre, et même à Napoléon III, en
s'abstenant de demander leur mort (qu'on se reporte par exemple à
la pièce IX du livre VII : "Du vieux charnier humain nous
avons clos la porte. / Tous ces hommes vivront. — Peuple,
pas même lui !"). En avril 1871, s'insurgeant implicitement,
dans "Pas de représailles", contre la "loi des
otages" votée par la Commune, Hugo plaide le refus de la loi
du talion et le pardon pour l'offense reçue : "Ceux que
j'ai terrassés, je ne les brise pas [...] Si je les vois liés, je
ne me sens pas libre ; / À demander pardon j'userais mes genoux /
Si je versais sur eux ce qu'ils jetaient sur nous". En juin, la
Commune brisée, Hugo prend avec les mêmes arguments la défense
des Communeux et leur offre publiquement l'asile dans sa maison de
Bruxelles. C'est cette main tendue que le Maudit refuse.
Rimbaud, dont la sympathie pour la Commune est bien connue, a du
être ulcéré par l'attitude de Hugo, jugée trop conciliatrice et
"lâche" (comme dit le texte). 
Reniflent dans la
nuit comme des cétacés :
"L'expression reniflent dans la nuit
comme des cétacés, commente Steve Murphy, sembl(e) se
référer à la colonne d'eau violemment projetée en l'air par les
baleines, image hyperbolique des pleurnicheries de Hugo et variante
du cillement aqueduc qui visait dans "Chant de
guerre parisien" le plus célèbre pleureur de l'époque, Jules
Favre. Cette critique n'est pas nouvelle, Barbey d'Aurevilly
traitant Hugo de pleutre pleurard d'humanitaire et Paul
Lafargue vilipendant sa fraternité pleurarde de crocodile"
(op. cit. p.217).
Yves Reboul évoque à propos de ce vers le
poème "Pleurs dans la nuit" (Les Contemplations). 
Que tu te fais proscrire :
On pense spontanément, bien sûr, à la
proscription de 1851, dont Hugo s'était fait complaisamment un
drapeau. Il le reconnaît d'ailleurs plaisamment lui-même lorsqu'il
écrit dans "Pas de représailles" : "Et je donne un
asile à mon proscripteur même ; / Ce qu'il fait qu'il est bon
d'avoir été proscrit." Mais Rimbaud pense plutôt ici,
semble-t-il (comme le montre la suite de la phrase, voir note
suivante), à une autre proscription : celle dont Victor Hugo vient
d'être la victime le 30 mai 1871 lorsque le gouvernement belge,
irrité par l'offre d'asile faite par Hugo aux Communeux en fuite,
expulse le poète vers le Luxembourg. Voir le poème "Expulsé
de Belgique", L'Année terrible, édition Yves Gohin,
chez Poésie/Gallimard, p. 160-164. 
et
dégoises des thrènes / Sur d'effroyables becs de can(n)e fracassés :
Le manuscrit porte "becs de
canne", ce qui semble être une faute d'orthographe de Rimbaud.
Certains éditeurs corrigent en "becs de cane".
"Le mot bec de canne (ou bec de cane :
les deux orthographes existent au XIXe siècle) désigne
ici une serrure ou une poignée. Ce vers fait sarcastiquement
allusion à un incident survenu le 28 mai 1871 : cette nuit-là, une
bande exaspérée par l'offre d'asile faite par Hugo aux Communeux
attaqua sa maison de Bruxelles et aurait tenté d'en briser la
porte." (Yves Reboul, op. cit. 1991, p.91).
On trouvera certains des échos hugoliens
de l'événement (les "thrènes", c'est à dire les
lamentations funèbres, "dégoisés" par le poète) dans
l'édition de L'Année terrible par Yves Gohin, chez Poésie/Gallimard.
Voir notamment : "Lettre de Victor Hugo à Monsieur le
Rédacteur en chef de L'Indépendance belge", p.258-260
et le poème "Une nuit à Bruxelles", p.158-159.
Pour Steve Murphy, la réaction
rimbaldienne à l'exploitation mélodramatique par Hugo de
l'incident de Bruxelles est au coeur de l'inspiration du poème :
"On comprend maintenant le rapport entre les becs de canne
fracassés et ces phénomènes cosmiques. Le Maudit (figuration plus
ou moins distanciée de Rimbaud) tient à montrer comment Paris se
trouve bombardé de projectiles. Grâce à l'analogie burlesque, le
Juste doit saisir le ridicule achevé de ses lamentations sur les
dommages résultant de la lapidation de sa maison, au regard des
souffrances de la capitale soumise, elle, à une pluie de feu. Le
narcissisme du mage le rendrait aveugle à l'événement historique,
"cécité" qui en fait une image a contrario de la
poétique du Voyant" (op. cit. p.211). 
l'oeil de Dieu :
Allusion probable, disent la plupart des
commentateurs, à "La Conscience", dans La Légende des
siècles ("L'oeil était dans la tombe et regardait
Caïn"). Hugo est "l'oeil de Dieu" parce qu'il
poursuit les Communeux de ses discours moralisateurs, de ses appels
à la conscience, à la modération, à la réconciliation avec
Versailles. Ce qui fait de lui en réalité pour Rimbaud "le lâche".

Ô
ton front qui fourmille de lentes
:
Les "lentes" sont les oeufs
déposés par les poux dans les cheveux.
Le large front est, chez Hugo,
l'attribut habituel du songeur (c'est à dire du poète) ou du
penseur (c'est à dire du prophète, du mage). C'est à dire de
lui-même. Les caricaturistes (Gavarni et autres) se sont
fréquemment moqué du narcissisme hugolien en prêtant au visage du
poète un front démesuré. Représenter ce "front" envahi de poux,
comme Rimbaud le fait ici, c'est bien entendu suggérer que Victor
Hugo est gagné par la corruption et la décomposition de son
génie. 
Socrates et Jésus,
Saints et Justes, dégoût :
"Élargissement de l'anathème,
commente Suzanne Bernard, qui atteint les Saints et les
Justes, Socrates (au pluriel) désignant tous les sages,
conformistes et passifs, qui préfèrent, comme Socrate, périr
injustement plutôt que de braver les lois. En face d'eux, le
Maudit suprême est à la fois Satan, Caïn et Rimbaud
lui-même." (Rimbaud, Oeuvres, Classiques Garnier,
1961). 
sous les pilastres
/ D'azur :
Les "pilastres d'azur" sont une
métaphore classique du ciel (les
colonnes invisibles qui soutiennent la voûte céleste), comme on le
voit bien dans cet exemple emprunté à Hugo : "Le ciel est un
dôme aux merveilleux pilastres" ("À la mère de l'enfant
mort"). Cette métaphore revient régulièrement sous la plume
de Hugo, notamment dans Les Contemplations. Yves Reboul en
cite quatre exemples (p.54, note 13) dont celui-ci, tiré du
célèbre poème "Ibo" : "Vous savez bien / Que
j'irai jusqu'aux bleus pilastres", où l'image se charge d'un
symbolisme mystique. De même, dans "À la fenêtre, pendant la
nuit" : "Ne verrons-nous jamais briller de nouveaux astres
? / Et des cintres nouveaux , et de nouveaux pilastres / Luire à
notre oeil mortel [...] ?" 
les nœuds
/ D'univers :
"Les "noeuds d'univers" évoquent
"Ce que dit la Bouche d'ombre" (poème des Contemplations)
: "De la création compte les sombres noeuds, / Viens, vois,
sonde" (Yves Reboul, op. cit. 1985, p.48). 
L'ordre, éternel
veilleur, rame aux cieux lumineux / Et de sa drague en feu laisse filer
les astres :
Steve Murphy commente : "Dieu
apparaît bien dans "L'homme juste", sous la forme du
"veilleur" (de nuit) qui figure en fin de poème,
défenseur (du Parti) de l'Ordre. Comme si souvent dans la
littérature anticléricale, il apparaît comme un vieillard sénile
(ressemblant en cela, dans l'idée de Rimbaud, à Hugo), comme une
parodie Cybèle qui laisse tomber des astres comme par distraction :
"Et de sa drague en feu laisse filer des astres ! " Il
s'agit bien entendu d'étoiles filantes et Rimbaud parodie
probablement ici, comme l'a vu Antoine Fongaro, l'un des poèmes
utopiques les plus célèbres de Hugo, "Plein Ciel", où
l'aéroscaphe est le symbole du Progrès. On y trouvait ces vers :
La Nuit tire du fond des gouffres
inconnus
Son filet où luit Mars, où rayonne Vénus,
Et pendant que les heures sonnent,
Ce filet grandit, monte, emplit le ciel des soirs,
Et dans ses mailles d'ombre et dans ses réseaux noirs
Les constellations
frissonnent.
Rimbaud semble
procéder par homonymie (filet > filer) et par synonymie
partielle (filet > drague)" (op. cit., p. 208). 
Qu'il dise charités
crasseuses et progrès... :
Cette allusion au "progrès"
constitue un des arguments d'Yves Reboul, dans son article de
1985, pour remettre en cause l'idée que le Juste pourrait être le
Christ. On ne sache pas que la prédication du Christ puisse être
assimilée à un discours en faveur du Progrès. Et encore moins
l'idéologie diffusée par l'Église catholique à l'époque de
Rimbaud, comme le montre le critique en citant le Syllabus, qui anathémise ceux qui prétendent que "le pontife romain peut et
doit se réconcilier avec le progrès" (op. cit. 1985, p.46).
Il en est tout autrement, évidemment de Victor Hugo, qui combinait
une religiosité touchant parfois au mysticisme avec une posture
nettement anticléricale et un culte affirmé du Progrès. 
ces yeux de Chinois [...] daines
:
Polémiquant contre "Va-et-vient :
Rimbaud, Hugo, Claudel" de Pierre Brunel, Yves Reboul
écrit : "Il affirme par exemple en une phrase rapide ne pas
comprendre pourquoi les "yeux de Chinois" de la fin du
poème seraient ceux de Hugo. C'est, effectivement, de peu
d'importance et il est possible qu'il ne soit pas frappé par les
yeux bridés de l'auteur de L'Homme qui rit sur certains de
ses portraits de vieillesse ; mais un Christ "aux yeux de
Chinois" lui semble-t-il plus convaincant" (op. cit. 2005,
p.57).
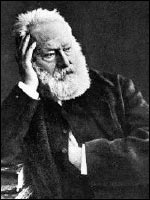
La fin du vers, sur
le manuscrit, est difficilement lisible. Certaines éditions (Antoine
Adam, Pierre Brunel) restituent "Chinois à bedaines" (Alphonse Daudet,
parlant de Bouddhas en céramique, évoque des "Chinois à bedaines
violettes" dans Le Petit Chose, 1868). Mais d'autres éditeurs
estiment que cette solution n'est absolument pas lisible sur le
manuscrit. Louis Forestier préfère rester prudent ( "[...] daines")
et André Guyaux, se réclamant de David Ducoffre, propose : "de
daines" dans l'édition 2009 de la Pléiade. On lira avec
intérêt, sur le blog rimbaldien de Jacques Bienvenu (op.cit.),
l'article que David Ducoffre a consacré à l'analyse
philologique minutieuse de ce vers. Il y propose la lecture :
"– Ô j’exècre
tous ces yeux de Chinois ou daines,"
"Les daines,
femelles du daim, explique notamment l'auteur, sont à leur place
dans un poème qui abonde en métaphores animales et expressions de la
douceur idiote."

[...] qui chante :
nana, comme un tas d'enfants près / De mourir, idiots
doux aux chansons soudaines :
Selon Steve Murphy, cette
évocation étrange pourrait désigner des chants d'église. 
Ô Justes, nous chierons dans vos
ventres de grès :
"À la fin, ce sont aussi sans
doute les yeux du Juste qui sont objets de dérision, mais le
Maudit l'avait déjà accusé de "cécité". Le poème se
termine en proférant une menace : "Ô Justes, nous chierons
dans vos ventres de grès", ce qui pourrait suggérer que le
Juste et ses semblables ressemblent à des magots chinois, qu'on
peut ouvrir et utiliser en guise de pots de chambre." (Steve
Murphy, op. cit. p.222). 
|
|
Commentaire |
|
|
Sois juste, c'est ainsi qu'on sert la
république ;
Le devoir envers elle est l'équité pour tous ;
Pas de colère ; et nul n'est juste s'il n'est doux.
Victor Hugo
"Pas de représailles"
(Avril 1871,
L'Année terrible)
|
À la difficulté habituelle des poèmes
de Rimbaud, "L'Homme juste" ajoute celle d'être un texte
tronqué, dont il nous manque le début. Cette mutilation n'a pas
peu contribué, sans doute, à fourvoyer longtemps la critique dans
une interprétation aberrante, qui a été (et est encore) l'enjeu
d'un débat entre érudits rimbaldiens. Enfin, la bonne
compréhension du texte mobilise un savoir historique que le lecteur
d'aujourd'hui, même cultivé, est loin de posséder toujours. Car
s'est imposée peu à peu l'idée que Rimbaud a rédigé "L'Homme
juste" en réponse à une actualité intensément vécue, celle
de la Commune, et pour exprimer sa profonde déception du rôle que
Victor Hugo y avait joué. Cet ensemble de facteurs nous a paru
rendre indispensable, avant de nous lancer dans une périlleuse lecture
linéaire du texte, de fournir au lecteur un dossier, le plus succinct
possible, sur ce qu'il faut savoir pour ne pas s'y perdre.
1) Ce qu'il faut savoir
a) L'état du texte :
Nous ne connaissons "L'Homme
juste" que par ce qu'il est convenu aujourd'hui d'appeler le
"Dossier Verlaine". Entre septembre 1871 et février 1872 environ, Verlaine
constitua un dossier paginé
des poèmes de Rimbaud. Dans ce dossier (aujourd'hui conservé à la
BNF), "L'Homme juste"
occupait probablement les pages 4 à 6. On est obligé de dire
"probablement" car la page 4 a été perdue (ainsi que la
page 3 qui en constituait le recto et qui contenait sans doute
"Les Chercheuses de poux"). Les pages 5 et 6, qui nous
sont restées, contiennent 55 vers. Or, il se trouve que nous
connaissons le nombre de vers du poème : "75 vers". Cette
information nous est donnée en haut de la page 7 du "Dossier
Verlaine", en même temps qu'un rappel du titre : "L'Homme
juste" et sa date de composition : "juillet 1871".
Nous en déduisons (sans peine) qu'il nous manque exactement les
vingt premiers vers du poème. Pour rendre la chose tout à fait
manifeste dans la présentation du texte ci-dessus, j'ai opté pour
numéroter les vers de 21 à 75.
Lorsqu'on observe le manuscrit, qui est un
manuscrit autographe, on remarque une différence notable
d'écriture et de présentation entre les deux derniers quintils
(vers 66-75) et tout ce qui précède : la graphie est plus serrée,
négligée, illisible à plusieurs endroits. Et c'est au point que
Steve Murphy, qui est aujourd'hui le critique faisant autorité sur
le plan de l'étude graphologique et codicologique, exprime
ouvertement l'hypothèse d'une rédaction dans un état d'ébriété
avancé (cf. op. cit. p.184). En tout cas, il est certain que ces
deux derniers quintils ont été ajoutés après coup car ils ne
figuraient pas sur la copie de ce poème par Verlaine, dont nous
possédons le dernier feuillet (il s'agit de la fameuse page 7 du
"Dossier Verlaine", en haut de laquelle on peut voir,
barrée de la main de Verlaine parce qu'elle faisait double emploi
avec l'autographe rimbaldien, la dernière strophe d'un précédent
état du texte). Pour matérialiser dans la présentation du poème,
ci-dessus, cette hétérogénéité de la graphie, nous avons
utilisé les italiques dans la transcription des deux strophes
finales.
b) Le débat critique :
Se fondant sur quelques éléments de
satire religieuse et une allusion indiscutable à la figure du
Christ ("pleureur des Oliviers"), la critique a longtemps
considéré qu'on avait là un exemple de plus de cette inspiration
violemment antichrétienne qui caractérise l'oeuvre de Rimbaud
(notamment pendant cette année 1871, avec Les Premières
Communions et Les Pauvres à l'église). Il était
communément admis que le Juste du poème n'était autre que
Jésus-Christ. Jusqu'à ce qu'Yves Reboul remarque (en 1985) que
"toute une série d'impossibilités textuelles invalidaient
cette exégèse reçue (par exemple, que l'Homme juste soit appelé croyant —
et non pas Maître ou Sauveur — ou encore qu'il soit désigné
comme vieillard et comme Barde)."
(Y. R. op. cit. 2005, p.54). Par contre, les termes en question
("vieillard", "croyant", "Barde
d'Armor") convenaient parfaitement à Victor Hugo. Nombre des
traits satiriques du poème (l'ironie contre une religiosité et un
humanisme douceâtres ; les accents parodiques du lyrisme cosmique)
pouvaient fort bien viser l'auteur des Contemplations. La
date du poème (juillet 1871, autrement dit : les lendemains
immédiats de la Commune) pouvait largement expliquer un
ressentiment violent du très communard Rimbaud à l'égard du Grand
Homme, qui avait continûment refusé de s'engager du côté des
insurgés et avait même publié dans Le Rappel plusieurs
poèmes renvoyant dos à dos les révolutionnaires et leurs
bourreaux. L'affaire fut donc entendue. Reboul d'abord, puis à sa
suite la plupart des spécialistes de Rimbaud, déchiffrèrent les
allusions, accumulèrent les preuves. Si bien que toute la famille
rimbaldienne fut bientôt convaincue ... sauf un : Pierre
Brunel, qui a maintenu jusqu'ici (notamment dans son édition des Oeuvres
complètes à la Pochothèque, en 1999) l'ancienne
lecture du texte. Pour plus d'information sur ce débat critique,
nous renvoyons le lecteur à notre panorama des interprétations
(ci-dessus) et à notre bibliographie
(en fin de page).
c) Le contexte historique
(Hugo et la Commune) :
À la suite de la capitulation de Napoléon
III à Sedan, des manifestations se déroulent à Paris, des comités
de vigilance républicains commencent à se créer dans tous les
arrondissements, un Gouvernement de la Défense nationale est
désigné, la République est proclamée (4 sept. 1870). Victor Hugo
arrive à Paris, retour d'exil, le lendemain. Pendant les mois qui
suivent, la gauche républicaine et socialiste milite pour la guerre
à outrance contre l'envahisseur et accuse le Gouvernement de livrer
le pays aux Prussiens. De fait, le Gouvernement joue double jeu :
tout en tâchant de réorganiser l'armée en province et en livrant
ponctuellement bataille, il semble considérer la situation comme
désespérée. Et surtout, effrayé par la mobilisation croissante
des parisiens derrière les éléments les plus radicaux de la
gauche, il négocie en secret l'armistice avec les Prussiens.
Pendant toute cette période, à en juger selon ses carnets, Hugo
est fortement sollicité par les deux camps : il refuse de
participer au Gouvernement tout comme de marcher en tête des
manifestations que les futurs Communeux organisent déjà contre
Trochu, Thiers et compagnie... Le 29 janvier 1871, l'armistice est
signé. Le 8 février, Hugo est élu député de Paris et gagne
Bordeaux où la nouvelle Assemblée s'est repliée, Paris étant
jugé peu sûr. Le 18 mars, le Gouvernement, qui s'est déplacé
avec l'Assemblée à Versailles (depuis le 10 mars), tente de
déménager
par la force les canons de la Garde nationale de Paris :
insurrection populaire, le Comité central (émanation des comités
de vigilance républicains d'arrondissements) s'installe à l'Hôtel
de Ville. C'est le début d'une situation de double
pouvoir et de guerre civile ouverte.
Trois jours après (21 mars), Hugo quitte
Paris pour Bruxelles afin de régler la succession de son fils
Charles, qui vient de mourir. Mais il n'en reviendra pas de si tôt.
21 avril : le Rappel, journal du clan Hugo, publie "Pas
de représailles", poème où Hugo condamne la loi sur les
otages votée par la Commune. 7 mai : le même Rappel publie
"Les Deux Trophées" qui renvoient les deux camps en
conflit dos à dos, les unissant dans une même réprobation (le
Gouvernement pour le bombardement de l'Arc de triomphe, la
Commune pour le déboulonnement de la Colonne Vendôme).
21-27 mai : "semaine sanglante". 21 mai : les Versaillais
entrent dans Paris. 25 mai : le gouvernement belge ayant décidé de
refuser l'asile aux Communeux en fuite, Hugo proteste par une lettre
adressée à la presse et offre l'asile dans sa maison de Bruxelles.
Le 27 mai, jour des exécutions en masse au Père-Lachaise
("mur des fédérés"), une manifestation violente de jeunes
bourgeois réactionnaires tente de forcer la porte du domicile bruxellois de Hugo. Le
1er juin, Hugo, expulsé par le gouvernement belge, gagne le Luxembourg.
Pendant toute la période de la Commune,
les Carnets et la correspondance privée de Hugo attestent
son opposition véhémente à un processus insurrectionnel qui
remettait en cause un ordre républicain issu d'élections
régulières. Si hostile qu'il ait pu être à la politique de
démission nationale du Gouvernement, à la négation des droits de
Paris à s'ériger en Commune, enfin à la répression sanglante du
peuple de Paris, Hugo n'a jamais pu approuver la victoire de la rue
contre un gouvernement élu. On ne peut pas savoir exactement ce que
Rimbaud a connu de cet itinéraire politique de l'auteur des Châtiments
pendant la Commune. Mais Hugo était un homme public, dont la
moindre prise de position était mentionnée par la presse,
répercutée par la rumeur, notamment dans les milieux littéraires
et républicains où Rimbaud avait ses antennes. Rimbaud, c'est
sûr, a suivi tout cela avec beaucoup d'attention, comme le montre
"L'Homme juste".
2) Lecture linéaire
Le
texte suit un mouvement que l'on peut approximativement découper en
cinq séquences. Dans une première étape (v.21-30), le Juste se tient debout devant un ciel nocturne passablement tourmenté,
où les bolides et les astéroïdes évoquent peut-être les bombes
qui se sont abattues sur Paris pendant la Commune. Il conseille narquoisement au
contemplateur de "gagner un toit" (c'est à dire d'aller se
mettre à l'abri) et de prier. Mais comme le Juste reste là, le
narrateur redouble d'ironie et s'emporte jusqu'à l'insulte (v.31-40). Le vers 40 fait en quelque sorte
transition en définissant, pour la première fois dans le texte,
l'identité du narrateur : "Je suis celui qui souffre et qui s'est
révolté". La séquence suivante
(v.41-55) marque une évolution
dans la mesure où elle combine, de la part de ce narrateur, un discours
nouveau d'auto-affirmation ("je suis maudit", "le Maudit
suprême") et la poursuite des invectives contre le Juste,
accusé de lâcheté, et dont le "révolté" repousse avec
orgueil les offres de pardon. Enfin, du v.56 au v.65, le fantôme a fui
(le Juste est sans doute allé se coucher) et le narrateur se retrouve seul
sous un ciel apaisé, où l'ordre cosmique (et politique, bien sûr) est
rétabli. Cependant, au vers 66, les imprécations contre le Juste reprennent
de plus belle, pour atteindre un paroxysme de violence dans le vers
final.
1ère séquence (v.21-30)
|
Le Juste restait droit sur ses hanches solides :
Un rayon lui dorait l'épaule ; des sueurs
Me prirent : « Tu veux voir rutiler
les bolides ?
Et, debout, écouter bourdonner les flueurs
25 D'astres lactés, et les essaims d'astéroïdes ?
« Par des farces de nuit ton front
est épié,
Ô Juste ! Il faut gagner un toit. Dis ta
prière,
La bouche dans ton drap doucement expié ;
Et si quelque égaré choque ton ostiaire,
30 Dis : Frère, va plus loin, je suis estropié ! » |
Le Juste
apparaît au narrateur sur fond de nuit étoilée. Le texte revient
à trois reprises sur la posture : "droit" (21),
"debout" (24), "debout" (31). C'est la pose
traditionnelle du contemplateur dans les poèmes de Hugo.
L'aura qui entoure la silhouette (le "rayon" (2) qui
l'éclaire par derrière) est aussi un effet hugolien. L'évocation
cosmique est une parodie de celles
qu'on rencontre chez l'auteur des Contemplations. L'extrême
agitation du spectacle stellaire semble, à première vue, relever essentiellement de l'embellissement
poétique (hyperboles et métaphores) : les planètes traversent
l'espace comme des "bolides", la Voie lactée coule comme
un fleuve ("flueurs" peut être compris comme un simple
dérivé du verbe "fluer"), les étoiles filantes
("astéroïdes") volent en "essaims" et
"bourdonnent" comme des abeilles. Ce spectacle grandiose
provoque l'ironie du narrateur qui parle de "farces de
nuit" et suggère au poète qu'il ferait mieux d'aller se
coucher ("Il faut gagner un toit") plutôt que de rester dehors à
baguenauder devant les étoiles. Faisant allusion au mysticisme inhérent aux
visions célestes de la poésie hugolienne et s'adressant au grand
homme comme à un enfant, il lui conseille de faire sa prière avant
d'aller essuyer son drap de sa bouche. Jusque là, on pourrait à la
rigueur rendre compte du texte (comme nous venons de le faire) en se
contentant d'y déceler une volonté rimbaldienne de traiter par la
dérision la rhétorique de Victor Hugo et son angoisse métaphysique devant le silence des espaces
infinis.
Mais les deux vers suivants (29-30)
embrayent sur un tout autre terrain : celui de la polémique
politique. Le narrateur conseille pour finir au poète de cesser de
jouer les amis du peuple, les guides de la nation. Plus
précisément, il est vraisemblable que le mot "égaré"
désigne ici les Communeux (c'est ainsi que les désignaient
souvent leurs adversaires) et que Rimbaud, en imaginant qu'un de ces Communeux vienne frapper
à la porte du poète, fait allusion à l'offre d'asile émise par
Hugo depuis sa maison de Bruxelles, au lendemain de la Semaine
sanglante. Hugo donc, suggère Rimbaud, ferait bien de se
dispenser de ce genre de forfanterie et de reconnaître qu'il est
"estropié", c'est à dire inutile et impuissant.
On peut finalement se demander, avec Steve Murphy
(voir notre rubrique "interprétations"), si l'ensemble de
ces deux strophes ne fait pas allusion à la Commune. Ce serait
d'une certaine manière plus cohérent. L'évocation du grand
déménagement d'étoiles dans le ciel n'évoquerait-il pas
les bombardements de Paris par les Versaillais ? On comprendrait mieux,
dès lors, dans la suite du poème, l'utilisation de qualificatifs
extrêmes pour décrire ce paysage comme : "épouvante /
Bleuâtre des gazons" (v.31-40), "soleil mort"
(v.40), "nuits sanglantes" (v.55). Les "flueurs",
dont le sens médical est celui de "menstrues" pourraient
suggérer dès lors une pluie de sang s'abattant sur Paris. Les
"bolides" seraient des bombes. Et la raillerie vis à vis
de Hugo prendrait une autre ampleur : elle stigmatiserait la naïveté politique et la lâcheté (thème qui
apparaît, en tout état de cause, dans la suite du poème) de celui
qui n'a rien prévu, rien compris ou rien voulu voir et qui se
trouve maintenant effaré devant l'évidence du désastre. D'où le
conseil : va te mettre aux abris, va faire ta prière puisque c'est
tout ce que tu sais faire. Il n'est plus temps de venir en aide aux
Communeux à qui tu as systématiquement refusé ton soutien tout le
temps qu'a duré la révolution. Dans cette optique, on pourrait
peut-être admettre l'interprétation du même Murphy (Murphy, op. cit. 2005,
p.198) pour le vers 26. Les "farces de nuit"
seraient une
allusion à la lapidation nocturne de la maison de Hugo à
Bruxelles, le 27 mai 1871 (que "certains commentateurs qui
tenaient autant à minimiser l'événement que Hugo à le
dramatiser" avaient présenté comme une "blague" de
jeunes gens éméchés). Le narrateur dirait en somme à Hugo :
voilà ce qui se passe à Paris et toi, tu te laisses impressionner
par ce qui n'est rien d'autre qu'une mauvaise farce !
2ème séquence (v.31-40)
|
Et le Juste restait debout, dans l'épouvante
Bleuâtre des gazons après le soleil mort
:
« Alors, mettrais-tu tes genouillères
en vente,
Ô vieillard ? Pèlerin sacré ! Barde
d'Armor !
35 Pleureur des Oliviers ! Main que la pitié gante !
« Barbe de la famille et poing de la
cité,
Croyant très doux : ô cœur tombé dans
les calices,
Majestés et vertus, amour et cécité,
Juste ! plus bête et plus dégoûtant que
les lices !
40 Je suis celui qui souffre et qui s'est révolté ! |
Les vers 31-32 confortent
une lecture symbolique (et communarde) de la scène décrite par le
poème. Le Juste fait face à un spectacle d'"épouvante". Le mot serait fort s'il ne
s'agissait que d'un ciel étoilé. "Après le soleil mort"
veut-il seulement dire : "après le coucher du soleil" ?
L'expression a-t-elle un sens symbolique et lequel ? La mort du
"soleil" figure-t-elle celle de la République sociale,
c'est à dire de la Commune ? Rimbaud a-t-il joué consciemment sur
les connotations christiques du personnage du "Juste" et
a-t-il pensé à l'éclipse qui, d'après le récit de la Passion,
aurait suivi la mort de Jésus ? Rien de tout cela n'est impossible
et nous pensons même souhaitable d'accepter la
superposition de ces divers niveaux de signification. Rimbaud a
très bien pu assimiler le massacre des
Communeux au calvaire du Christ, et symboliser l'un et l'autre par un coucher de soleil.
Le Juste ne suit pas les conseils
qu'on lui donne. Il reste là. Ce qui déchaîne, à partir du vers
33, une bordée de sarcasmes de la part du narrateur.
Le Juste refusant apparemment de faire sa
prière, comme on le lui a conseillé, le narrateur lui demande
d'abord ironiquement s'il veut se débarrasser de ses "genouillères"
(v.33). Rimbaud raille le goût de Hugo pour la prière : "Pensons et vivons à genoux ; / Tâchons d'être sagesse,
humilité, lumière ; / Ne faisons pas un pas qui n'aille à la
prière." écrivait Hugo dans "Pleurs dans la nuit",
poème des Contemplations. Il va de soi que l'allusion aux
"genouillères" est une perfidie contre cette piété
hugolienne.
On trouve alors
(v.34-38) une longue énumération de formules dont chacune renvoie à un aspect du mythe
Hugo : "Ô vieillard", c'est l'image solennelle de
patriarche que le poète offre de lui dans ses derniers
recueils ; "Pèlerin sacré" rappelle le père
effondré de "Demain dès l'aube ..." ; "Barde
d'Armor", le poète de l'Océan, le proscrit de Jersey et
Guernesey, nouvel Ossian ; "Pleureur des Oliviers" fait
penser à celui qui, tel le Christ au Jardin des Oliviers, doute
parfois de Dieu et s'abîme dans l'angoisse devant le vide des
cieux ; "main que la pitié gante" évoque
l'humanisme hugolien en suggérant qu'il n'est qu'un paternalisme de
bourgeois ; "Barbe de la famille" fait allusion à
l'une des postures favorites du poète, celle du père ou du
grand-père, aimant et doux avec les enfants ; "poing de la
cité" rappelle l'auteur des Châtiments, le lutteur
infatigable, l'homme public aspirant à un rôle politique ;
"croyant très doux : ô coeur tombé dans les calices"
évoque non seulement le chrétien, mais plus précisément l'éloge
constant chez Hugo de cette vertu chrétienne par excellence qu'est
le sens du pardon, le sens du sacrifice (dont le "calice"
est le symbole"). On reconnaît l'une des insistances du texte,
le thème de la douceur (qui sera repris dans l'avant-dernière strophe
du poème :
doux / Comme du sucre sur
la denture gâtée) : Rimbaud stigmatise
là manifestement un principe de passivité, principe qui a incité
Hugo, pendant la Commune, à plaider en permanence la conciliation, au
nom ce cette même douceur ("nul n'est juste s'il n'est
doux" : voir la citation de "Pas de
représailles" que nous reproduisons en tête de ce
commentaire, en guise d'épigraphe). Le vers 38 : "Majestés et vertus, amour et
cécité " entreprend de résumer Hugo par un ensemble de
quatre substantifs regroupés deux par deux, également répartis
entre les deux hémistiches de l'alexandrin, mais faussement
symétriques car les trois premiers mots sont laudatifs (c'est
l'image que Hugo veut donner de lui-même) tandis que le quatrième
dénonce la "cécité" du prétendu Voyant. Et nous
retrouvons ici, par conséquent, cette critique essentielle de
Rimbaud à l'égard de l'attitude politique de Hugo pendant la
Commune : il n'a rien compris.
Le vers 39
initie un changement de ton : de l'ironie, on passe à l'insulte.
C'est le ton de la caricature épaisse, n'hésitant pas recourir à
l'injure grossière ("bête", "dégoûtant") et
à l'animalisation (la "lice" est la femelle du chien de
chasse : Rimbaud entend-il assimiler Hugo aux "chiens de
chasse" Versaillais ?).
Le vers 40, enfin, confirme l'exacerbation
violente du discours en faisant entendre le cri du narrateur : cri
de détresse et de provocation à la fois de celui qui
"souffre" parce qu'il "s'est révolté" et qu'il
se sait vaincu, éternel
paria. Pour la première fois dans le texte, du moins dans le
fragment que nous en possédons, le narrateur se caractérise
lui-même : "Je suis celui qui souffre et qui s'est révolté !".
Ce révolté qui souffre est-il Rimbaud lui-même ?
Les termes ne seraient-ils pas mieux adaptés à l'ouvrier parisien,
au Communeux qui en ce mois de juillet 1871, s'il n'a pas péri
pendant la Semaine sanglante, se trouve prisonnier au camp de
Satory ou dans les pontons des ports de l'Atlantique, traîné devant les
conseils de guerre, ou contraint à se cacher, à s'exiler pour fuir
la répression féroce du parti de l'Ordre ? Laissons la question
ouverte pour l'instant. Nous y reviendrons, car ces deux derniers
vers ne font qu'annoncer les thèmes et le ton qui vont être ceux
des trois strophes suivantes.
3ème séquence (v.41-55)
|
« Et ça me fait pleurer sur mon
ventre, ô stupide,
Et bien rire, l'espoir fameux de ton pardon
!
Je suis maudit, tu sais ! Je suis soûl,
fou, livide,
Ce que tu veux ! Mais va te coucher, voyons
donc,
45 Juste ! Je ne veux rien à ton cerveau torpide.
« C'est toi le Juste, enfin, le Juste
! C'est assez !
C'est vrai que ta tendresse et ta raison
sereines
Reniflent dans la nuit comme des cétacés
!
Que tu te fais proscrire et dégoises des
thrènes
50 Sur d'effroyables becs de canne fracassés !
« Et c'est toi l'œil de Dieu ! le lâche
! quand les plantes
Froides des pieds divins passeraient sur
mon cou,
Tu es lâche ! Ô ton front qui fourmille
de lentes !
Socrates et Jésus, Saints et Justes, dégoût
!
55 Respectez le Maudit suprême aux nuits sanglantes ! » |
La
caractéristique de ces strophes est une rhétorique de
l'imprécation (c'est à dire de la malédiction lancée contre un
adversaire) qui combine quatre éléments : l'ironie, l'insulte, la
diatribe politique, la menace.
Relèvent de l'ironie les nouvelles
allusions au mythe hugolien comme : "Et c'est toi l'oeil de
Dieu" (51), qui renvoie au célèbre poème "La
Conscience" dans La Légende des siècles ; ou comme :
"reniflent dans la nuit" (48) qui fait penser au poème
des Contemplations "Pleurs dans la nuit". La cible
de cette ironie est encore et toujours la propension de Hugo à se
présenter comme un "mage", porte-parole de l'humanité
souffrante et intermédiaire privilégié entre Dieu et les hommes.
Au titre de l'insulte, on notera la
poursuite de la caricature animalière (avec la rime équivoquée :
"cétacés/c'est assez" et les "lentes" qui
infectent le "front" auguste du penseur), ou encore
l'utilisation d'épithètes injurieuses comme celles de la rime
"stupide/torpide" ("torpide" reprend l'idée de
"cécité" : Hugo dort, son cerveau somnole, les
événements de la Commune ont mis en évidence son décalage par
rapport à la réalité concrète). Enfin, il y a l'accusation
redoublée de lâcheté (v.51 et 53). Mais avec cette idée nous
abordons le chapitre de l'allusion politique.
La colère de Rimbaud contre son
grand aîné se cristallise ici autour de ce qu'un biographe de
Victor Hugo appelle "l'incident belge" (édition Yves
Gohin de L'Année terrible, Poésie/Gallimard, p.258-260).
C'est à cette péripétie que font allusion les
vers 41-42. Le syntagme "L'espoir fameux de ton pardon" se
réfère à la lettre envoyée par Hugo à la presse Bruxelloise le
27 mai 1871, lettre dans laquelle le poète rappelle avec emphase son
opposition à la Commune, tant qu'elle a été victorieuse, mais
prône une attitude de magnanimité et de réconciliation,
maintenant qu'elle est vaincue. C'est la fameuse lettre où Hugo
proteste contre la décision du gouvernement belge d'extrader vers
la France les Communeux cherchant refuge en Belgique et offre
d'ouvrir sa porte à tous ceux qui y frapperaient. Une autre
allusion sarcastique à cet épisode se trouve aux vers 49-50 : une
manifestation nocturne de jeunes bourgeois réactionnaires s'était
attaquée à la porte de Hugo, d'où les "effroyables becs de
cannes fracassés". Ce sont d'ailleurs moins les poignées de
portes qui sont effroyables que les assaillants eux-mêmes, tels que
Hugo et sa famille les ont perçus (on parlera si l'on veut
d'"hypallage"). L'adjectif hyperbolique est là, en tout
cas, pour railler l'émotion manifestée par Hugo et par son clan dans
la presse de l'époque (puis ultérieurement dans un poème de L'Année
terrible que Rimbaud, en 71, ne pouvait pas connaître). Cette
émotion, Rimbaud la trouve manifestement excessive comme le montre
la formule "et dégoises des thrènes" (49). Les
"thrènes" sont des lamentations funèbres, et il est bien
évident que si quelque événement mérite des
"thrènes", en ce début d'été 1871, ce ne sont pas les
serrures cassées de la maison bruxelloise de Victor Hugo. Le
mépris présent de Rimbaud pour Victor Hugo est tel qu'il se permet
d'ironiser sur la nouvelle proscription du poète (expulsé par le
gouvernement belge fin mai 1871 et réfugié au Luxembourg). Il
semble même insinuer que Hugo a recherché délibérément cette
proscription : "tu te fais proscrire" (49) pour
pouvoir une fois de plus s'afficher en victime, à égalité avec
les Communeux persécutés, alors même qu'il n'a participé à
rien, ayant gagné la Belgique dès le début de la guerre civile.
Cette désertion de Hugo, cette volonté de la masquer par une
démonstration de solidarité aussi spectaculaire que gratuite et
sans risques, cette manie de vouloir toujours tirer la couverture à
soi, voilà ce qui mérite sans doute, pour Rimbaud, l'épithète de
"lâche".
Enfin, le narrateur continue à ordonner au
"fantôme" d'aller se coucher (44) et, élargissant la
menace en direction de tous les lâches qui se mettent à genoux
devant la Loi ("Socrates et Jésus, Saints et Justes, dégoût
!", v.54), il leur intime l'ordre de respecter
"le Maudit suprême aux nuits sanglantes" (v.55). Qui se
cache derrière cette terrifiante allégorie satanique ? Ce
"Maudit suprême", c'est évidemment en premier lieu le
Peuple, le peuple révolutionnaire, dont tous les tartufes libéraux
à la Hugo doivent craindre l'inévitable revanche. Mais c'est
aussi, n'en doutons pas, Rimbaud lui-même. Ce n'est pas seulement parce que le narrateur se confond le plus
souvent avec l'auteur, du moins en poésie, que le Maudit
doit être tenu comme une représentation de la personne du poète.
Il suffit de se reporter aux fameuses lettres du 13 et du 15 mai
1871 (dites "du voyant), lettres écrites pendant la Commune,
pour comprendre à quel point le narrateur de "L'homme
juste" est la réplique fidèle du poète voyant tel que Rimbaud
le définit dans ces textes fondateurs. Il s'y décrit comme un jeune
homme ayant résolu de ne pas suivre "la bonne ornière"
(13 mai), partisan passionné de la Commune : "les colères folles me poussent vers la bataille de
Paris — où tant de travailleurs meurent pourtant encore tandis que je
vous écris !" (13 mai). Il est décidé à
"s'encanailler", c'est à dire à traîner dans les cafés
et à se faire entretenir, nous dit-il, par les "imbéciles de
collège" (13 mai) qu'il y rencontre. Il est décidé à ne pas
travailler, sauf à la poésie. Tout cela parce qu'il "veu(t)
être poète" (13 mai). Ne peut devenir véritablement poète
et créer du nouveau que celui qui rompt avec les fausses valeurs
enseignées par la morale et la religion. C'est seulement ainsi
qu'il peut "se faire voyant. Le Poète se fait voyant
par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les
sens. Toutes les formes d'amour, de souffrance, de folie ; il
cherche lui-même, il épuise en lui tous les poisons, pour n'en
garder que les quintessences. Ineffable torture où il a besoin de
toute la foi, de toute la force surhumaine, où il devient entre tous
le grand malade, le grand criminel, le grand maudit, — et le suprême
Savant ! —
" (15 mai). Est-ce assez
clair ? Le Maudit suprême de "L'Homme juste" n'est
autre qu'Arthur Rimbaud.
4ème séquence (v.56-65)
|
J'avais crié cela sur la terre, et la nuit
Calme et blanche occupait les Cieux pendant
ma fièvre.
Je relevai mon front : le fantôme avait
fui,
Emportant l'ironie atroce de ma lèvre...
60 — Vents nocturnes, venez au Maudit !
Parlez-lui !
Cependant que, silencieux sous
les pilastres
D'azur, allongeant les comètes et les nœuds
D'univers, remuement énorme sans désastres,
L'ordre, éternel veilleur, rame aux cieux
lumineux
65 Et de sa drague en feu laisse filer les astres ! |
Ce
passage est celui sur lequel nous pouvons nous fonder pour tenter de
restituer la logique narrative d'ensemble du poème, logique que la
perte des vingt premiers vers rend difficilement saisissable. Il semble que le poème soit le récit d'un
cauchemar. En effet, le narrateur dit au vers 58 : "Je relevai
mon front : le fantôme avait fui [...]". Le
"fantôme" est celui que le poème appelle
"le juste". Le mouvement vers le haut du "front"
du narrateur suggère-t-il une opposition debout/couché, une
apparition dans le ciel ou sur fond de ciel ? Il est suggéré
nettement, en tout cas, que cette rencontre avec le
"fantôme" est le fruit d'une hallucination maladive : "J'avais crié cela sur
la terre, et la nuit / Calme et blanche occupait les cieux pendant
ma fièvre" (v.56-57). La précision "sur la terre"
indique-t-elle le lieu de la vie réelle par opposition au ciel, qui
a fourni le décor de la vision, le lieu de l'apparition ? Le
"cri" poussé par le rêveur (v.56), c'est sans doute le
discours entier du poème (discours de colère, cri de détresse),
mais plus spécifiquement peut-être l'appel récurrent lancé au
fantôme dans le but de le chasser : "Ô juste ! il faut gagner un toit." (v.27) ;
"Mais va te coucher, voyons donc, / Juste ! Je ne veux rien à
ton cerveau torpide" (v.44-45) ; "C'est toi le Juste,
enfin, le Juste ! C'est assez !" (v.46) ; "Ah qu'il s'en
aille, lui, la gorge cravatée / De honte [...]" (v.65-66). Le
scénario semble donc être celui d'un malade fiévreux ("soûl,
fou, livide, / Ce que tu veux", v.43-44) cherchant à se
débarrasser de la vision cauchemardesque qui l'obsède. Tandis que,
dans le beau vers 60, en une image qui rappelle le romantisme
gothique, le narrateur fait appel au "vent nocturne", aux
forces mystérieuses de la nuit, pour le consoler et régénérer sa
combativité.
Cette quatrième séquence constitue donc
le dénouement : dernier moment du récit, celui où le cauchemar
s'est enfin dissipé, moment d'apaisement dont la strophe 61-65 développe
ensuite la description. Les vers 56-57 nous apportent sur ce point une
indication très claire : "pendant ma fièvre", c'est à
dire pendant le cauchemar, pendant tout ce qui précède, "la
nuit / Calme et blanche occupait les cieux". Ce passage oppose
donc le moment présent, environnement réel du narrateur ("la
nuit calme et blanche") avec le paysage tourmenté des vers
précédents, paysage imaginaire, fruit de la fièvre, constitué
(comme nous avons essayé de le montrer) de souvenirs des
bombardements de Paris et de la Semaine sanglante, vision
rétrospective donc.
Mais ce calme est celui de la défaite : la
nuit étoilée, qui ressemblait naguère à un champ de bataille,
est maintenant devenue métaphore du rétablissement de l'ordre.
L'expression "la drague en feu" ("drague", au
sens de filet) reprend ici, semble-t-il, une métaphore de Victor
Hugo qui, dans "Plein ciel" (La Légende des siècles),
comparait les constellations aux mailles d'un filet rempli
d'étoiles frétillantes, filets que
le Grand Horloger de l'univers tire sans jamais se lasser au dessus
de nos têtes :
|
La Nuit tire du fond des gouffres
inconnus
Son filet où luit Mars, où rayonne Vénus,
Et pendant que les heures sonnent,
Ce filet grandit, monte, emplit le ciel des soirs,
Et dans ses mailles d'ombre et dans ses réseaux noirs
Les constellations
frissonnent. |
Or, ce
grand ratissage nocturne est désigné par Rimbaud comme
"l'ordre, éternel veilleur", idée rimbaldienne s'il en est qui réunit sous une même allégorie
sinistre le Parti de
l'Ordre et le Parti de Dieu, la répression versaillaise et la
cosmologie hugolienne. Pourquoi ce Veilleur laisse-t-il "filer
les astres" ? Steve Murphy suggère que c'est peut-être parce
que Rimbaud s'imagine Dieu comme un vieillard sénile (op. cit.
p.208) : peu convaincant ! Peut-être n'y a-t-il là au fond qu'un
détail descriptif : l'immobilité générale du ciel traversée par
moments par quelque étoile filante, anomalie qui confirme
l'impression générale de calme, plutôt qu'elle ne la trouble.
La parodie, il faut l'avouer, a
du panache. Rimbaud emprunte tout, ou presque (les pilastres d'azur,
les noeuds d'univers, la drague, la rime en "-astre", ...
tout vient de Hugo, voir notre rubrique
"interprétations"). Mais l'imitation rivalise aisément
avec le modèle, grâce à la concentration et à l'expressivité
des images ("drague en feu" vaut bien "filet où luit
Mars") ; grâce à la beauté du rythme, aussi : l'habileté
des enjambements notamment, qui perturbent un peu la régularité des
premiers alexandrins (v.61-63) pour faire ressortir la plénitude des deux
derniers (64-65).
5ème séquence (v.66-75)
|
Ah ! qu'il s'en aille, lui, la gorge cravatée
De honte, ruminant toujours mon ennui, doux
Comme du sucre sur la denture gâtée.
— Tel que la chienne après
l'assaut des fiers toutous,
70 Léchant son flanc d'où pend une entraille emportée.
Qu'il dise charités crasseuses et progrès...
— J'exècre tous ces yeux de
Chinois [...] daines,
[...] qui chante : nana, comme
un tas d'enfants près
De mourir, idiots doux aux chansons
soudaines :
75 Ô Justes, nous chierons dans vos ventres de grès ! |
Nous avons
déjà signalé, au début de ce commentaire, les particularités
graphiques de cette dernière partie du manuscrit, qui font penser
à un ajout tardif, plus ou moins improvisé. En outre, l'analyse
linéaire que nous venons de conduire tend à montrer que ces
quintils additionnels ne s'insèrent pas parfaitement dans le
mouvement général du texte. Il y a d'abord une sorte de "faux-raccord"
narratif : il n'est pas très logique que le narrateur s'écrie
"qu'il s'en aille" alors que le "fantôme" a
déjà disparu au vers 58. Par ailleurs, sur le plan du ton (cette
montée de la colère, de l'ironie à l'injure et de l'injure à la
menace, que nous avons essayé de décrire) le passage paraîtrait
mieux placé avant ce que nous avons appelé la quatrième
séquence, c'est à dire avant ce tableau du ciel après la
bataille qui nous est proposé dans les vers 56-65. Il semble
que le poème ait été logiquement conçu pour se terminer sur une
retombée de la fureur vengeresse et un retour à la triste
réalité de l'Ordre rétabli, comme cet autre tombeau de la
Commune qu'est "Paris se repeuple", poème qui
s'achève, rappelons-le, par la strophe :
|
—
Société, tout est rétabli :
— les orgies
Pleurent leur ancien râle aux anciens lupanars :
Et les gaz en délire, aux murailles rougies,
Flambent sinistrement vers les azurs blafards !
|
Mais ce
n'est pas à nous, bien sûr, de "corriger" un travail que
Rimbaud aurait laissé inachevé, ce qui d'ailleurs n'est pas
prouvé.
L'analyse des deux quintils finaux montre
en tout état de cause des éléments de progression remarquables :
ils poursuivent le poème dans la ligne de l'insulte mais en
exploitant, plus nettement que ce qui précède, le registre trivial
(les basses parties du corps : "denture gâtée", "entraille",
"ventre", "nous chierons") et l'apparence
physique du personnage visé ("la gorge cravatée de
honte", qui symbolise le vêtement bourgeois ; "les yeux
de Chinois", qui semblent avoir été une caractéristique
physique de Hugo vieillissant, trait physique dans lequel
Rimbaud veut voir peut-être un indice de duplicité). Il reprend
(v.69) l'image de la "chienne" (cf. "lices" au
vers 39), avec ce que la double connotation (animal, femelle) peut
avoir de conventionnel dans la rhétorique de l'insulte (Steve
Murphy décèle en outre dans l' "entraille emportée" un
fantasme de castration sexuelle ou de viol. Cf. op. cit. p.221).
L'adjectif "crasseuses" appliqué aux
"charités" du poète ne dépare pas dans la trivialité
ambiante . Les vers 73-74 pourraient, quant à eux, faire allusion
à la naïveté enfantine des chants d'église et, comme
l'expression "charités crasseuses", mêler dans un commun
dégoût le corps déchu du poète et sa religiosité.
Enfin, la chute du poème menace en termes
choisis les bourreaux de la Commune d'une terrible vengeance
scatologique. Ce vers final, dans le cadre d'une poétique
pré-surréaliste de l'insulte, ne manque pas de force : la belle
régularité de l'alexandrin, le contraste entre le caractère
familier du verbe et la solennité de l'invocation dans le premier
hémistiche, l'étrangeté du complément, qui évoque paraît-il des pots de chambre
moulés en forme de magots chinois (c'est à dire, de Bouddhas), comme
nous l'apprend Steve Murphy (op. cit. p.222)... ! On notera
en outre, dans ce dernier vers, l'apparition de la première
personne du pluriel ("nous chierons") qui tend à
restituer autour du narrateur une communauté de classe : ce sont,
avec Rimbaud, tous les travailleurs parisiens qui conchient les
Justes, Hugo, Socrate, Jésus et tous les Saints. Amen !
Conclusion
"L'Homme juste", ce texte que pendant si
longtemps personne n'a su lire, nous semble rentrer désormais dans la liste des
poèmes de Rimbaud dont on saisit suffisamment la signification
d'ensemble, même si de nombreux détails restent encore délicats
à interpréter.
Cela, grâce au travail patient de la recherche rimbaldienne. Notamment Yves Reboul et Steve
Murphy qui ont su éclairer de façon convaincante les enjeux
littéraires et idéologiques du poème. Malgré son amputation (qui
n'est peut-être que provisoire, sait-on jamais...?), il mérite une
place de choix aux côtés de ces autres magnifiques
"tombeaux" de la Commune que sont "Les Mains de Jeanne-Marie"
et "L'Orgie
parisienne ou Paris se repeuple". Poèmes brutaux, certes, mais
qu'on excuse quand on songe à ce que durent être pour le jeune
poète ces
temps d'affliction et de rage impuissante où il les rédigea.
Certains refusent encore de
reconnaître dans la figure du Juste la personne de Hugo. Et
pourtant, cela crève les yeux ! Victor Hugo incarne (en juillet
1871) tout ce que Rimbaud a
décidé de détester : l'illusion religieuse et la lâcheté
politique. Comment expliquer une condamnation aussi violente de ce
grand poète que Rimbaud, dans sa lettre du 15 mai, tout en le
trouvant "trop cabochard" et trop amateur "de Jéhovahs et de colonnes, vieilles énormités
crevées", saluait encore comme un Voyant ? C'est qu'entre le 21 et le 27 mai, il y avait eu la Semaine
sanglante et ses vingt mille morts, ouvriers et
petits-bourgeois parisiens, hommes, femmes et enfants, coupables
d'avoir voulu instaurer la République Sociale... Ou d'ailleurs
non-coupables d'un tel crime car on exécuta beaucoup, au hasard,
sur le tas, sur ordre du Gouvernement républicain de la
France, "Gauche" comprise... Et on ne peut pas comprendre ce
poème,
comme beaucoup d'autres de Rimbaud, si l'on n'a pas bien en tête
cet événement-là.
Et puis, il y a eu la lettre du 27 mai 1871
à l'Indépendance belge, que Rimbaud a sûrement lue (à
Charleville, on n'est pas loin de la Belgique). Or Victor Hugo, de
crainte sans doute de passer pour un sympathisant des
"rouges" au moment où il leur offrait solennellement
l'asile, commençait cette lettre par un véritable réquisitoire
contre la Commune, où il forçait quelque peu le trait : "Je
n'étais pas avec eux [...]. J'ai protesté contre leurs actes, loi
des otages, représailles, arrestations arbitraires, violations des
libertés, suppression des journaux, spoliations, confiscations,
démolitions, destruction de la Colonne, attaques au droit, attaques
au peuple [...] Je n'ai jamais compris Billioray, et Rigault m'a
étonné jusqu'à l'exécration ; mais fusiller Billioray est un
crime ; mais fusiller Rigault est un crime. [...] Ne faisons pas
verser l'indignation d'un seul côté [...]" (L'Année terrible, édition
Yves Gohin,
chez Poésie/Gallimard, p.258). C'était plus, probablement,
que Rimbaud ne pouvait en supporter. D'où le fond de son discours
dans le poème : votre "pardon", à ce prix ... jamais !
Avec le recul, on peut certes
trouver injuste que Rimbaud ait pris pour cible privilégiée l'un des rares écrivains
français qui n'ait pas applaudi à la répression des insurgés du
18 mars. « Je
trouve qu’on aurait dû condamner aux galères toute la Commune et
forcer ces sanglants imbéciles à déblayer toutes les ruines de
Paris, la chaîne au cou, en simples forçats », écrira
Gustave Flaubert à George Sand avant d’ajouter : « Ah !
quelle immorale bête que la foule, et qu’il est humiliant d’être
homme ! ». Barbey d’Aurevilly demandera
que l’on mette les Communards dans des cages et qu’on les expose
en public. Théophile Gautier parlera de ces « sauvages,
un anneau dans le nez, tatoués de rouge » qui
imitent la danse du scalp sur les débris fumants de la Société.
« J’espère que la répression sera telle que rien ne
bougera plus et, pour mon compte, je désirerais qu’elle fût
radicale », s’exclamera Leconte de Lisle. Quant à Dumas
fils, il osera écrire : « Nous ne dirons
rien de leurs femelles, par respect pour les femmes à qui elles
ressemblent quand elles sont mortes. » Hugo a montré
vis à vis de la Commune une compréhension politique et une
capacité de commisération bien au-dessus de tous ceux-là, mais il eut le tort, aux yeux de Rimbaud, de la mépriser un peu
trop.
|
|
Bibliographie |
|
|
Suzanne Bernard,
Rimbaud, Oeuvres, Classiques Garnier, 1961.
Cette édition peut être
consultée pour se faire une idée de ce qu'était
l'interprétation traditionnelle de ce poème (Le Juste = Le
Christ). Dans les rééditions ultérieures, André Guyaux
signale la lecture d'Yves Reboul.
|
Marc Ascione,
"Hypothèse sur quelques détails de sens", Centre
culturel Arthur Rimbaud (Charleville-Mézières), 9, 1984.
Première évocation d'une
possible référence hugolienne dans "L'Homme
juste".
|
Yves Reboul,
"À propos de L'Homme juste", Parade
sauvage n°2, avril 1985, p.44-54.
Contribution essentielle, qui
a éclairé de façon décisive la lecture du texte en
démontrant la référence hugolienne.
|
Yves Reboul,
note sur "L'Homme juste" de l'édition Oeuvre-vie,
édition du centenaire établie par Alain Borer et
alii, Arléa, 1991.
Reprend pour l'essentiel
l'article de 1885.
|
Pierre Brunel,
Rimbaud, Oeuvres complètes, Pochothèque, 1999,
p.271-273 et 805-806.
Maintient l'interprétation
traditionnelle du poème.
|
Pierre Brunel,
Va-et-vient Hugo, Rimbaud, Claudel, Klincksieck, 2003,
p.35-43.
Ces pages contiennent une
réfutation peu convaincante de l'exégèse d'Yves Reboul.
|
Steve Murphy,
"Architecture, astronomie, balistique : le châtiment de
Hugo", Parade sauvage, colloque n°5, 16-19
septembre 2004, 2005, p.183-224.
Se situant dans le cadre de
l'interprétation d'Yves Reboul, cet article la précise sur
certains points et propose de voir dans les pyrotechnies
célestes du texte une allégorie du bombardement de Paris par
les Versaillais.
|
Yves Reboul,
"De Hugo et d'une critique rimbaldienne", Cahiers
de littérature française II, Rimbaud, dirigé par
André Guyaux, Bergamo University Press, L'Harmattan, 2005,
p.51-61.
Réfutation de la réfutation
: Yves Reboul répond à Pierre Brunel (Va-et-vient ...).
|
|
David Ducoffre, "L'Homme juste, deux vers enfin
déchiffrés", blog
Rimbaud ivre, 31 octobre 2010. |
|
À consulter aussi :
Franck Laurent,
"Victor Hugo, Le Rappel et la Commune", compte rendu de
la communication au Groupe Hugo du 13 mars 2004 :
http://www.wmaker.net/lesgaribaldiens/Victor-Hugo-le-rappel-et-la-Commune_a11.html
|
|
|
|