|
LE CERCLE ZUTIQUE Un ouvroir de poésie libertaire au lendemain de la Commune Bernard Teyssèdre, Arthur Rimbaud et le foutoir zutique, Éditions
Léo Scheer, 2011.
Les études zutiques se sont multipliées ces dernières années sur la lancée des travaux de Steve Murphy. L'Album zutique dans sa totalité a été réédité en avril 2008 par les Éditions du Sandre, sous forme de fac-similé de l'édition savante procurée par Pascal Pia en 1962. Les appareils de notes des éditions courantes se font plus consistants grâce aux apports de chercheurs comme, notamment, David Ducoffre. Certains textes ont fait l'objet d'exégèses particulièrement éclairantes. Le poème intitulé Paris, par exemple, a inspiré coup sur coup quatre microlectures (de Steve Murphy, Yves Reboul, Bernard Teyssèdre, Robert St. Clair) dévoilant sa visée politique et montrant sa profonde originalité. Enfin, l'essai de Bernard Teyssèdre (désormais B.T.) et l'ouvrage collectif publié chez Garnier sous la direction de Seth Whidden (désormais S.W.), premières études de cette ampleur qui aient été consacrées au livre d'or du Cercle zutique, viennent d'accroître d'un coup, considérablement, la bibliographie disponible. On peut les compter d'ores et déjà parmi les indispensables du rimbaldisme.
L'essai de Bernard Teyssèdre étudie un à un les textes de Rimbaud, mais pas du tout comme dans les habituels recueils de commentaires. Il suit presque jour après jour la vie du Cercle pendant les cinq à six semaines qu'ont duré, d'après l'auteur, sa cohésion et son activité effective (du 15 octobre à la fin novembre 1871 tout au plus). Les pages où Teyssèdre expose les résultats de son enquête sur ces questions de chronologie, tant dans l'ouvrage collectif Garnier (S.W. p.33-52) que dans son propre bouquin (B.T. p.117-131, 493-506) sont d'ailleurs parmi les plus passionnantes de l'ensemble. En tentant de restituer autour des textes la vie même du Cercle, en prenant en compte la dynamique de groupe qui s'y développe et se reflète dans le travail de création, il parvient à éclairer de façon nouvelle et très intéressante beaucoup de ces textes. Il met en évidence la fonction stratégique dévolue par Verlaine au Sonnet du trou du cul pour sélectionner au sein de la mouvance parnassienne les esprits les plus libres susceptibles d'appartenir au groupe zutique. Il analyse dans Jeune goinfre et quelques autres textes le reflet des agaceries de Rimbaud à l'égard de Verlaine (et les réactions irritées de ce dernier sur l'Album). Il suggère que dans Les Remembrances du vieillard idiot, Rimbaud, en même temps que Coppée, chambre le "vieux" (38 ans) Cabaner qui lui a fait des propositions malhonnêtes dans le fameux À Paris, que fais-tu poète, / De Charleville s arrivé ? L'auteur cherche à resituer l'expérience zutique de Rimbaud dans le cadre de sa biographie. Il y a quelque chose du roman dans la façon dont il raconte l'histoire du zutisme (ce qui contribue au charme et à la fécondité de sa démarche mais n'est pas toujours sans inconvénient : une tendance à l'approximation, voire à l'invention dans les références biographiques). Teyssèdre montre aussi la répercussion dans les textes de l'actualité littéraire et politique. Il y relève des allusions aux manœuvres restaurationnistes des monarchistes et des bonapartistes dans les mois qui ont suivi la Commune, aux campagnes de Monseigneur Dupanloup contre la laïcisation de l'enseignement, aux compromissions de certains collègues parnassiens avec l'Empire ou avec Versailles, aux succès faciles remportés par Coppée sur les scènes parisiennes avec ses pièces d'un moralisme affligeant. Et comme, en outre, l'entreprise est véritablement encyclopédique (775 pages) et que le bouquin est truffé d'informations historiques, de références critiques, d'hypothèses d'interprétation, la lecture est toujours suggestive et enrichissante, même quand, parfois, les thèses défendues peuvent paraître contestables. Une existence à la fois très brève et très intense Michael Pakenham, dans un exposé extrait de sa thèse de doctorat (Une revue d'avant-garde au lendemain de 1870 : La Renaissance littéraire et artistique), démontre que les productions littéraires consignées dans l'Album zutique émanent en fait de deux groupes distincts agissant à deux moments différents. Le premier était constitué d'une
quinzaine de personnages dont le nom apparaît dans le texte Propos du
cercle (feuillet 2, recto) qui sert en quelque sorte d'introduction
au recueil :
Il faut ajouter à ces noms celui de Camille Pelletan. Ce premier groupe a créé l'album en octobre 1871 et, d'après Pakenham, a cessé d'être actif au plus tard en décembre 1871 (S.W. p.23-24). Bernard Teyssèdre, dont l'article est consacré à une enquête minutieuse sur la datation des contributions de Rimbaud propose une chronologie "hypothétique" plus resserrée encore, allant du 15 (ou 16) octobre (Sonnet du trou du cul) au 17 (ou 18) novembre (Ressouvenir). Nous y reviendrons. Le second groupe, "le groupe de Richepin" (S.W. p.23), incluant Nouveau, Bourget et Ponchon, aurait ajouté ses contributions à l'album au cours de l'hiver 1872-1873, à une époque où Rimbaud et Verlaine ne se trouvaient plus à Paris (depuis juillet 72). C'est Charles Cros qui le leur aurait prêté, nous apprend Denis Saint-Amand (S.W. p.67). Les membres de ce deuxième groupe, outre les feuillets 27 à 30, auraient utilisé pour y déposer leurs œuvres quelques blancs disponibles parmi les feuillets 1 à 26 ayant servi aux initiateurs de l'album, ce qui a pu faire croire de façon erronée que certains d'entre eux avaient participé aux séances de 1871. Bernard Teyssèdre (B.T. p.117-131, 493-506 et S.W. p.33-52) parvient à reconstituer l'enchaînement chronologique des contributions rimbaldiennes à l'Album zutique en s'appuyant sur quelques principes de méthode qui paraissent assez rigoureux :
Voici à titre d'exemple le faisceau d'indices que mobilise Bernard Teyssèdre pour dater l'installation des Zutistes dans leur local, dont il suppose qu'elle a correspondu avec la mise en service de l'Album (j'espère ne pas trop trahir la pensée de l'auteur en tentant de résumer en quelques lignes une démonstration complexe étalée sur une bonne dizaine de pages) :
Tout cela reste sans doute un peu aléatoire, mais le raisonnement
paraît solide. Je ne tente pas de résumer une démonstration
d"ensemble par trop
complexe. Mais voici les conclusions qu'en tire l'auteur (je m'appuie
sur son propre tableau, B.T. p.506 et S.W. p.51-52) concernant
la chronologie des inscriptions rimbaldiennes :
"Le cercle zutique, écrit Michael Pakenham, fut la cristallisation, à l'arrivée de Rimbaud à Paris, d'un groupement — la faction Verlaine, Valade, Cros et Cabaner, née de la dissolution du Parnasse et de la Commune [...]. Le Cercle zutique n'existait pas avant l'arrivée de Rimbaud à Paris mais fut formé aussitôt après sa venue" (S.W. p.25 & 28).
Denis Saint-Amand et Lionel Cuillé analysent l'Album zutique en sociologues. Saint-Amand dégage les caractéristiques communes qui ont pu contribuer à l'unité de ce "groupuscule littéraire". Mis à part Cabaner et Antoine Cros, plus âgés, et Rimbaud, nettement plus jeune, ils appartiennent tous à une même génération littéraire (ils sont nés entre 1839 et 1850). Parisiens de longue date pour la plupart d'entre eux, ils connaissent les règles du milieu littéraire et plus largement d'une capitale dont ils ont fréquenté en commun certains lieux de sociabilité (le salon d'Antoine Cros, celui de Nina de Villard, les dîners des Vilains Bonshommes ...). Ceci dit, ils ne vivent pas de leur art. Ils ont un métier à côté, au revenu modeste, qui leur assure la subsistance. Ils viennent presque tous d'une classe moyenne au statut social instable ("en voie de déclassement ou de reclassement") ce qui a pu "faciliter une tendance à l'anticonservatisme" qui s'est manifestée par "une attitude réfractaire partagée à l'égard de l'institution scolaire" (S.W. p.82) et dans la contestation de l'autorité politique.
Ainsi, selon Pakenham, le regroupement est né
avant tout de la volonté de se retrouver entre soi de personnages qui se trouvaient
désormais en porte-à-faux, en tant que sympathisants de la Commune, dans
le milieu artiste plus large que regroupaient les "Vilains Bonshommes".
Bernard Teyssèdre, dans le second chapitre de son livre raconte en
détail toute cette préhistoire du Cercle Zutique et en présente, un à
un, les protagonistes, avec une érudition sans égale (B.T. 73-114).
Au-delà de leur complicité politique, ces futurs Zutistes avaient été séduits,
selon Pakenham, par le
projet rimbaldien de "dérèglement de tous les sens" et de "liberté
libre" : liberté au sens politique, bien sûr, mais aussi liberté
sexuelle, homophilie, propension à l'ivrognerie et intérêt pour les
psychotropes (cf. dans un dessin de Valade, feuillet 19 verso,
l'admonestation en direction de Verlaine prêtée à Albert Mérat). Or, ces
attitudes libertaires les coupaient Lionel Cuillé, contrairement à Michael Pakenham, doute que la lettre dite "du Voyant" puisse être considérée "comme une sorte de manifeste théorique ou comme un texte susceptible de donner une direction au groupe zutique dont [Rimbaud] aurait pu apparaître comme le chef de file" (S.W. p.92). "Ce qui frappe en revanche dans l'Album, ajoute-t-il, c'est que Rimbaud ne laisse pas de vouloir occuper le terrain : par le nombre de ses interventions, par les thèmes abordés — l'anticléricalisme scatologique, l'attirance incestueuse (pour le "bout noir" du père), l'emblème pornographique (le fameux Sonnet du Trou du Cul) — le jeune poète ne cesse d'accentuer sa différence." (ibid.) Son "Merde" retentissant, à la pointe du sonnet liminaire du recueil (Propos du Cercle), traduit cette radicalité dans le refus et révèle la place éminente reconnue au proférateur du juron au sein du groupe.
Cette volonté de se différencier caractérise l'attitude de Rimbaud dans
le groupe mais elle caractérise aussi, dit Lionel Cuillé, la position du groupe dans le champ littéraire : "l'Album zutique s'accommode d'une
approche en termes de champ : objet circonscrit, il délimite un cercle
d'écrivains qui affirment leur cohésion en opposition différentielle à
une cohorte d'autres noms évoqués implicitement ou non" (p.98). De cette
cohésion témoigne particulièrement, comme le note Arnaud Bernadet
(S.W. p.122), les nombreux poèmes exhibant une double signature ou relevant
implicitement d'une écriture à quatre mains, preuve que les
La règle du jeu, pour les membres du Cercle, consistait donc à affirmer
collectivement ce qu'Arnaud Bernadet appelle "un esprit d'anarchie" (S.W. p.124)
les caractérisant en tant que groupe tout en affirmant chacun sa différence
par rapport aux autres membres du groupe. Ces jeunes gens, de fait, affectionnaient par dessus tout de se
parodier mutuellement (c'est-à-dire d'écrire à la manière de
... tout en imposant chacun sa propre manière au détriment du camarade
parodié) et de se gausser les uns des autres, avec un
sens certain de l'autodérision mais sans
être toujours bien conscients des limites à ne pas franchir.
L'exercice était difficile et il tourna court. Nous l'avons vu.
Peut-être, surtout, à cause des débordements de Verlaine et Rimbaud qui
tendaient à perturber la cohésion d'un groupe moins homogène qu'il
pouvait y paraître et
sans règles de conduite suffisamment définies (cf. l'article en
ligne de Denis Saint-Amand, 2006). D'où la brouille rapide avec Mérat (qui
refusera de siéger au Coin de table aux côtés de Verlaine et
Rimbaud) et
sans doute d'autres, moins connues. Leçons de lecture L'avouerai-je ? Malgré l'intérêt et le plaisir que j'ai pris à lire les commentaires de textes procurés par ces deux volumes, j'ai éprouvé parfois une impression pénible de gauloiserie obsessionnelle, de délire exégétique, de surinterprétation. Aussi ai-je été reconnaissant à Bernard Teyssèdre d'exprimer à son propre compte des doutes comparables aux miens : "Le plus osé n'est pas toujours sûr", p.231 ; "le risque de surinterpréter, dès lors qu'il s'agit des poèmes zutiques de Rimbaud est omniprésent", p.538 ; "souvent je serais bien en peine de dire si l'interprétation est vraie ou fausse", p.537. Conscient d'avoir à affronter chez son lecteur d'inévitables réticences et incompréhensions, il déploie dans la dernière partie de son livre (chapitre XVII, notamment) un remarquable effort pédagogique pour expliquer et justifier la méthode qu'il vient d'utiliser. Je me contenterai ici, en suivant étroitement les propres réflexions de l'auteur, d'aborder deux questions touchant aux difficultés d'interprétation propres à la littérature zutique :
La question du destinataire (du lectorat ou du "public" ciblé) Est-il légitime d'établir le sens d'un texte sur des intentions supposées de l'auteur quand le texte, manifestement, ne contient pas les indices suffisants pour y faire penser son lecteur ? Cette première question en amène immédiatement une seconde : à quel(s) lecteur(s) un poème zutique est-il destiné ? Quand on étudie un texte de Rimbaud, autre que zutique, même si l'on sait bien qu'il n'a pas été publié, on suppose ce texte destiné à la publication, c'est-à-dire rédigé de manière à être compris par le lecteur lambda de l'époque ou, du moins, par tout lecteur baignant dans le même contexte culturel que l'auteur. Mais en ce qui concerne les textes zutiques, les choses sont moins claires.
Certains des poèmes inscrits dans l'Album ne se distinguaient pas pour
leurs auteurs de ceux qu'ils destinaient à la publication. Plusieurs,
d'ailleurs, ont inséré tels quels dans des recueils ultérieurs des
pièces d'abord consignées dans l'Album zutique (pièces qu'ils
avaient aussi, dans certains cas, probablement composées avant même que
le Cercle ne soit constitué). De tels textes ont donc été rédigés en vue
d'être lus par un lecteur standard. Mais d'autres
poèmes, c'est certain, ne furent destinés, dans l'esprit de leurs
auteurs, qu'au groupe lui-même, c'est-à-dire à un "public" extrêmement
restreint, aux compétences optimales, complice, et dont chacun pouvait
supposer être compris à demi-mot. Ce qui justifie qu'on puisse y
rechercher des significations hors de portée de compréhension pour tout
lecteur extérieur au groupe. Certains sous-entendus, selon Teyssèdre,
pouvaient même n'être destinés qu'à un seul membre du groupe. Ce serait
particulièrement le cas de certains textes de Rimbaud
visant Verlaine.
L'Angelot maudit, par exemple, pour Teyssèdre, ciblerait secrètement Verlaine, selon un schéma comparable (quoique nettement moins explicite) à celui que l'on peut observer dans Jeune goinfre. Rimbaud y parodierait Le Gourmand de Ratisbonne, où le jeune Paul est puni par des coliques de ses goinfreries (de pommes) et de ses méprises (il prend pour des bonbons les pilules de sa mère). Mais, dans la pièce zutique, l'indigestion de pilules et de pommes serait remplacée, en apparence, par l'abus de "jujube" et, en réalité, par une allusion à l'attirance excessive et précoce du jeune Paul (Verlaine) pour des gourmandises ... particulières, au temps où il était en pension du côté de la Rue Blanche. Mais qui pouvait posséder ce type d'informations sur le lieu de scolarisation et les premières expériences sexuelles de Verlaine, même parmi les membres du Cercle zutique ?
L'Angelot maudit reçoit un sens tout à fait suffisant (inversion satirique — et satyrique — de la représentation angélique de l'enfance) sans qu'il soit nécessaire de faire appel à une "clé", par exemple à une glose biographique. Dans des cas de ce genre, je le reconnais, mon premier (et bête) réflexe est de m'agacer contre le critique qui cherche midi à quatorze heures (qui voit dans l'Angelot une représentation du Prince impérial, de Louis Veuillot, du Docteur Véron, etc. cf. B.T.541-544 et Murphy, S.W.292-294). Pourtant, je finis par m'en convaincre, plusieurs niveaux de lecture sont également légitimes. Certes, comme Teyssèdre le reconnaît, le risque de surinterprétation est considérable. Mais il vaut mieux, pour le critique, prendre délibérément ce risque que de rester l'arme au pied, crainte de se tromper.
Ratisbonne,
La
Comédie enfantine
La question des blagues érotiques Est-il légitime d'inclure dans la signification du texte des allusions, des connotations supposées (notamment des "blagues érotiques" p.529), n'entrant pas de façon satisfaisante dans une cohérence narrative et/ou discursive ? Si manque de cohérence il y a, dans des cas comme ceux que l'on va
envisager maintenant, ce n'est pas la faute du critique. C'est le texte
lui-même qui présente de brusques perturbations logiques qui
correspondent à des changements d'aiguillages, à des disruptions
allusives. Le poème intitulé Le Balai (feuillet 9, verso) évoque comme on sait "un humble
balai de chiendent" qui n'est autre que celui des chiottes.
Autre exemple : le poème commençant par J'occupais un wagon de troisième...
Mais ces images graveleuses ne sont pas cohérentes entre elles ni ne forment un récit acceptable : "Un vieux prêtre ne peut pas mettre à la fenêtre tout à la fois sa pipe et son derrière" (B.T. 529).
Album zutique, feuillet 3,
recto (détail : colonne de droite). Dessins de Rimbaud.
Conclusion (je la laisse à Bernard Teyssèdre) :
Album zutique, feuillet 38.
|



 inévitablement du
Parnasse, dont les représentants les plus en vue s'étaient clairement
rangés du côté de l'Ordre au moment de la Commune et dont la pratique
poétique obéissait à des canons nettement plus formalistes (pour ne pas
dire conventionnels).
inévitablement du
Parnasse, dont les représentants les plus en vue s'étaient clairement
rangés du côté de l'Ordre au moment de la Commune et dont la pratique
poétique obéissait à des canons nettement plus formalistes (pour ne pas
dire conventionnels).  membres du
groupe sont unis par une "axiologie collective" qui "déborde l'identité
des auteurs et la formalité des styles" (S.W. p.124 et 122). C'est cette
éthique collective éminemment marginale et subversive qui justifie
sans doute le frontispice d'inspiration carnavalesque, voire tératologique,
dessiné par Antoine Cros sur le premier feuillet de l'Album
(ci-contre).
membres du
groupe sont unis par une "axiologie collective" qui "déborde l'identité
des auteurs et la formalité des styles" (S.W. p.124 et 122). C'est cette
éthique collective éminemment marginale et subversive qui justifie
sans doute le frontispice d'inspiration carnavalesque, voire tératologique,
dessiné par Antoine Cros sur le premier feuillet de l'Album
(ci-contre).

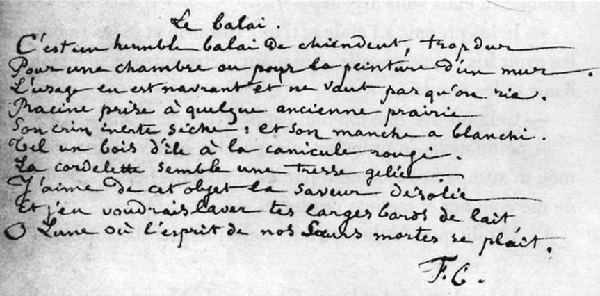


 Seth WHIDDEN (Villanova University)
Seth WHIDDEN (Villanova University)
