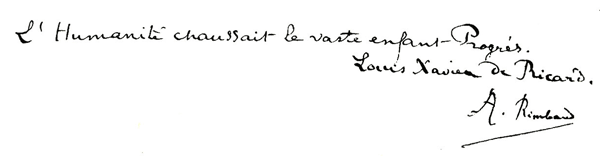|
|
|||||||
|
|
*
Le choix du verbe ("chaussait") est, par contre, surprenant. Dans le champ lexical concerné, c'est plutôt "marcher" qui était attendu. Rimbaud, comme souvent, joue à déformer et détourner un stéréotype, stéréotype que David Ducoffre (cf. biblio) a retrouvé conventionnellement formulé dans un poème de l'auteur ciblé par la parodie :
L.-X. de Ricard, L'Égoïste et la Leçon de la mort (Les Chants de l'aube, p.158) Remarquons cependant que Xavier-Louis de Ricard, tout idéologue "progressiste" (possiblement "naïf") et fondateur de la Revue du Progrès qu'il ait été, ne place pas ce cliché dans la bouche du "Poète", son porte-parole, mais dans celle de "l'Égoïste", son contradicteur. La formule (sinon l'idée) était donc, déjà, dans l'intertexte signalé, motif de raillerie. La tirade de "l'Égoïste" d'où la précédente citation est extraite s'achève d'ailleurs sur une sentence brocardant elle aussi la métaphore de la marche : "L'humanité n'avance pas d'un pied" (ibid.). Comme le rappelle Bernard Teyssèdre, un calembour d'esprit très proche se trouve dans une poème de Verlaine paru dans Le Rappel en 1869, Au pas de charge : "Le progrès poursuit sa marche, / Voyez : Godillot fournit / L'armée [...]". Rimbaud, donc, songe peut-être moins, ici, à parodier un stéréotype (le cliché de la marche au progrès) qu'à parodier une parodie elle-même parvenue au rang de cliché, détournement au second degré dont l'instrument est le verbe "chausser". De quoi Rimbaud se moque-t-il avec ce verbe "chausser" ? Le Progrès étant présenté dans la suite de la phrase comme un enfant et Ricard exaltant volontiers dans son œuvre la mission confiée aux mères de nous forger un avenir meilleur en élevant leurs enfants dans l'amour de l'humanité, on a pensé que Rimbaud pouvait avoir pris pour cible cette mièvrerie. Il aurait allégorisé l'Humanité sous l'aspect d'une bonne mère, veillant à chausser son enfant, le Progrès, en vue de la longue marche qui l'attend. Mais il est peu probable que Rimbaud se soit contenté de cette raillerie (malicieuse, si l'on veut, mais gentillette) pour ridiculiser la marche au Progrès. On est donc enclin à soupçonner de sa part quelque signification au second degré. Aussi nos deux critiques ont-ils retenu l'un et l'autre cette déjà ancienne proposition de Jean-Pierre Chambon (cf. biblio) selon laquelle Rimbaud exploiterait ici le sens argotique du verbe "chausser" : chausser une femme, c'est la bien baiser, avoir ce qu'il faut pour la combler, au propre et au figuré, sens attesté par le Dictionnaire érotique moderne de Delvau. Le Progrès étant un vaste idéal que l'Humanité poursuit pour l'embrasser, pour le posséder, l'équivoque sexuelle n'est pas invraisemblable. Et on va voir que cette allégorie est riche d'implications politiques bien plus intéressantes que la précédente. On a évidemment noté cet autre facteur d'incongruité que constitue l'usage de l'imparfait dans la forme verbale. Cet imparfait transforme la maxime en récit, la vérité générale en histoire particulière. L'histoire d'un échec, en toute logique, car si l'action verbale est conjuguée au passé c'est que l'Humanité, aujourd'hui, ne chausse pas (ne chausse plus) l'enfant Progrès. L'entreprise a échoué, soit qu'elle ait été fondamentalement illusoire (c'est l'interprétation ontologique de Bruno Claisse), soit sous l'effet d'une cause historique déterminée, comme l'écrasement de la Commune (ce serait plutôt celle de Bernard Teyssèdre). On y reviendra. En quoi le Progrès peut-il être appelé un "vaste enfant" ? Claisse et Teyssèdre proposent sur ce point des justifications intertextuelles assez convergentes. Claisse relève chez Ricard le syntagme "vaste élan", pour désigner la marche de l'humanité vers une aurore (le recueil s'intitule Les Chants de l'Aube) qui sera pour elle comme une nouvelle naissance, une nouvelle enfance. Victor Hugo, rappelle de son côté Teyssèdre, n'a cessé d'exalter les "larges horizons" s'ouvrant à "l'immense Humanité". Et ce que l'auteur de L'Année terrible reproche, à égalité, à Versailles et à la Commune (avec un beau culot), c'est de s'être montrés bien petits à l'échelle de ce vaste idéal :
V.Hugo, L'Année terrible, Mai, II.
C'est au fond le même constat que fait Rimbaud dans l'Album zutique : les hommes espéraient enfanter le Progrès, s'ouvrir un immense
horizon ou, en transposant l'idée de façon obscène (car "l'obscénité,
ainsi que l'a dit Jean-Pierre Chambon, est chez Rimbaud le langage
naturel de la subversion"), ils croyaient forcer l'"enfant Progrès", mais
le cul de l'"enfant Progrès" s'est révélé trop "vaste" pour leur faible Force. Et finalement, si l'on comprend bien les insinuations pédophiliques et sodomitiques de
l'allégorie (si l'on se
souvient, aussi, du Cœur supplicié), c'est lui, l'Enfant-Poète, qui
s'est fait chausser ! *
Au "monde moderne" ? C'est la conclusion que semble tirer Bruno Claisse :
Le "monde moderne" a bon dos ! Aux Versaillais, alors, aux insuffisances de la Commune ? Ce serait plutôt la conclusion de Teyssèdre :
Du coup, ce critique est évidemment beaucoup moins sévère avec Ricard que ne l'est Claisse :
Ce n'est donc pas à Ricard que Rimbaud s'en prend mais à l'Humanité : "L'Humanité n'est pas mûre pour mériter le progrès" (ibid. p.202). Ce jugement de Bernard Teyssèdre est naturellement discutable. Certes, l'immaturité des Communeux et, surtout, ne l'oublions pas, l'hypocrisie des Justes, ces progressistes modérés qui n'ont pas été les derniers à se déchaîner, au printemps 1871, contre les prétentieux instigateurs d'une République Sociale, explique en bonne part les sarcasmes de Rimbaud à l'égard de la pensée progressiste. Mais si cette ironie s'exprime avec tant d'insistance dans son œuvre ultérieure à la Commune (L'Homme juste, Ce qu'on dit au poète..., la Saison...) c'est que cette expérience malheureuse a réveillé et renforcé en lui un scepticisme mélancolique déjà existant, peut-être dû à l'empreinte de la métaphysique chrétienne (petitesse de l'homme, infinité de l'univers, etc.) dans la formation de sa personnalité. Ne traitait-il pas déjà de "fantaisies" (certes "admirables") les discours révolutionnaires du Cri du peuple, en avril 1871 ? Bruno Claisse, de son côté, "répond" par avance à Teyssèdre en portant comme lui le débat, dans la seconde partie de son article, sur Les Illuminations. Il montre qu'une caractéristique de la manière rimbaldienne dans ce recueil consiste à "cantonne[r] l'expression du désir à une scène imaginaire, où il est à la fois joué et mis à l'écart de la réalité", ce qui témoigne chez l'auteur du "refus de voir le désir s'emparer du réel", contrairement à ce qu'on peut observer dans l'œuvre d'un L.-X. de Ricard "où l'optimisme moral — cas particulier du désir — efface d'emblée les difformités du réel par l'évocation grandiloquente" d'un Avenir fantasmé. Et tout cela est très vrai. Sauf que l'on pourrait rétorquer à Bruno Claisse que l'auteur des Illuminations, loin de séparer hermétiquement le rêve et la vie réelle, ne cesse de présenter le premier comme le ferment nécessaire de la seconde. Ce "Génie" que l'Homme, pour s'accomplir, poursuit dans les nuées de l'avenir comme un "drapeau d'extase", le poète le montre d'un autre côté déjà à l'œuvre dans la vie réelle et bien "présent" en lui-même :
Autrement dit, sans la foi dans une possible émancipation, jamais l'Enfant-Poète n'aurait osé claquer la porte, "sur la place du hameau", et tourné ses bras, "compris des girouettes et des coqs des clochers de partout, sous l'éclatante giboulée." (Après le Déluge). Ce qui prouve que Bernard Teyssèdre n'a pas tort lorsqu'il dit que Rimbaud ne désespère pas du "progrès". Car Rimbaud est moins un mélancolique (il est trop énergique pour ça) qu'un inquiet. Et l'inquiétude rimbaldienne, ce qu'il appelle lui-même son "Angoisse", c'est très clair dans l'illumination qui porte ce nom, est faite d'un balancement éternel entre ces deux postulations contraires : lucidité et espoir. "L'Humanité" (puisque c'est d'elle qu'il parle dans son monostiche zutique) est à son image. Malgré les prophètes de la fin de l'Histoire et les déconstructeurs postmodernes de l'eschatologie révolutionnaire, elle continue, comme le montrent les révolutions en chaîne auxquelles nous assistons ces temps derniers, à vouloir "chauss[er] le vaste enfant Progrès." 03/03/11
|
||||||