|
|
Le Cœur supplicié (1871) |
|
|
Le
Cœur
supplicié.
Mon triste cœur
bave
à la poupe ...
Mon cœur est plein de caporal!
Ils y lancent des jets de soupe,
Mon triste cœur bave à la poupe...
Sous les quolibets de la troupe
Qui lance un rire général,
Mon triste cœur bave à la poupe,
Mon cœur est plein de caporal!
Ithyphalliques et
pioupiesques
Leurs insultes l'ont dépravé;
À la vesprée, ils font des fresques
Ithyphalliques et pioupiesques;
Ô flots abracadabrantesques,
Prenez mon cœur, qu'il soit sauvé!
Ithyphalliques et pioupiesques,
Leurs insultes l'ont dépravé.
Quand ils auront tari
leurs chiques,
Comment agir, ô cœur volé?
Ce seront des refrains bachiques
Quand ils auront tari leurs chiques!
J'aurai des sursauts stomachiques
Si mon cœur triste est ravalé!
Quand ils auront tari leurs chiques,
Comment agir, ô cœur volé?
|
|
|
Lexique |
|
|
|
fantaisie
: voir la note sur ce mot dans la page consacrée à Ma
Bohême.
cœur
: le mot est polysémique : organe de la circulation du sang / estomac
(avoir mal au cœur) / siège de la sensibilité morale, des sentiments
(Baudelaire : Mon cœur mis à nu; Rimbaud : "Je ne
regrette pas le siècle des cœurs sensibles" Mauvais sang) / bonté
(avoir du cœur, avoir le cœur sur la main, "Ce sans-cœur de
Rimbaud" - signature d'une lettre à Izambard) /
amour (donner son cœur) / courage (avoir du cœur au ventre)
/ etc... Dans sa nouvelle licencieuse Un cœur sous une soutane et
dans certains de ses poèmes,
Rimbaud utilise ce terme de façon équivoque, avec de constantes
allusions sexuelles. Voir par exemple ce quatrain d'Oraison du soir
: "Tels que les excréments chauds d'un vieux colombier, / Mille
rêves en moi font de douces brûlures : / Puis par instants mon cœur triste est comme un aubier / Qu'ensanglante l'or jeune et sombre des
coulures." (symboles phalliques conjugués du cœur triste et
de l'arbre printanier). Dans leur article Les zolismes de
Rimbaud, Marc Ascione et Jean-Pierre Chambon l'affirment et le
démontrent définitivement : "d'une manière générale dans l'œuvre
de Rimbaud tout entière, le cœur désigne le sexe de
l'homme" (Revue Europe, numéro spécial Rimbaud, mai-juin
1973, pages 114-132). 
poupe
: l'arrière d'un navire, par opposition à la proue. 
caporal
: grade militaire; tabac de qualité inférieure. 
quolibets
: "Façon de parler basse et triviale, qui renferme ordinairement une
mauvaise plaisanterie. Les pointes, les équivoques, les trivialités, les
turlupinades, les calembours, les jeux de mots de toute espèce, se
confondent sous la dénomination de quolibets" Dictionnaire
Bescherelle, cité par Steve Murphy, op. cit. p. 310. 
Ithyphalliques
: l'ithyphalle est le phallus en érection. Les figures
ithyphalliques sont fréquentes dans l'art religieux des civilisations
antiques (Egypte, Inde, civilisation gréco-romaine). 
abracadabrantesque
: néologisme, adjectif en -esque dérivé de
l'adjectif abracadabrant qui dérive lui-même du nom abracadabra.
Sens superlatif :
supérieurement étonnant, extraordinaire. Suzanne Briet a rapporté
que : "Dans la grammaire de son enfance (Grammaire nationale, par
Bescherelle aîné), Rimbaud avait glissé un unique signet de papier,
recouvert du triangle magique, où 'abracadabra' disposait ses voyelles
et ses consonnes comme un filet à prendre l'invisible. Et l'enfant avait
noté sur le papillon de papier cette phrase : 'pour préserver de la
fièvre'" (Rimbaud notre prochain, Nouvelles éditions latines,
1956, p.111, cité par Georges Kliebenstein et Steve Murphy,
op. cit. p.178)
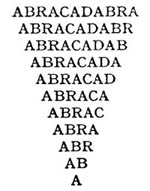
De tels papiers ornés du cône magique étaient suspendus au cou des malades
par les thaumaturges des premiers siècles, d'après la savante notice des
auteurs ci-dessus cités. "Écrivez, sorcières, / Abracadabra", dit Victor
Hugo dans La Ronde du Sabbat (Odes et Ballades). La formule
pourrait donc garder, dans notre poème, quelque chose de cette origine
magique, le poète s'adressant aux "flots" pour être sauvé
−
le poète, peut-être, soulevant les flots, relevant les Déluges, comme on
pourra lire plus tard dans Les Illuminations. Avec évidemment une
distance humoristique, de la part de Rimbaud. 
chique
: les "chiques" étaient des
morceaux de tabacs roulés ou tressés que l'on mâchait. Les marins
étaient traditionnellement représentés en train de chiquer. Cette
façon de consommer du tabac impliquait de devoir cracher de loin en loin
le jus amer produit par la mastication, d'où le sens argotique de
"tirer une chique" : tirer un coup, éjaculer. 
bachique
:de Bacchus, dieu du vin; une chanson bachique est une chanson à boire. 
stomachique
:de l'estomac. 
ravalé
: avalé de nouveau (re-avalé); au sens figuré : avili, rabaissé. Un
exemple chez Rimbaud, dans Un cœur sous une soutane : le
supérieur du Séminaire convoque le jeune Léonard pour le réprimander
au sujet d'un poème licencieux écrit de sa plume; pour se moquer de son
élève, le supérieur lit le poème à haute voix en bégayant : "Il
ravalait ma poésie! il crachait sur ma rose! il faisait le Brid'oison, le
Joseph, le bêtiot, pour salir, pour souiller ce chant virginal !"
(Pochothèque, page 145). 
|
|
Interprétations |
|
|
|
La
mention "op. cit." renvoie à la bibliographie proposée en fin
de page.
Le Cœur supplicié : Trois
versions ultérieures et différentes de ce poème nous sont connues. Le 10 juin 1871, Rimbaud envoie une lettre à Demeny
contenant Le Cœur du pitre : ce nouveau titre met en relief
l'identité du narrateur, le pitre, c'est à dire le clown, l'histrion, le
funambule, le poète. En août 1871, Delahaye recopie pour Rimbaud une
nouvelle version destinée à Verlaine intitulée Le Coeur volé :
ce titre met semble-t-il davantage l'accent sur l'idée de viol, et sur
les conséquences morales des violences subies par le narrateur. Verlaine,
enfin, fait figurer dans Les Poètes maudits (1886), sous le titre Le
Cœur volé, une nouvelle version des deux premiers triolets. Le mot
"cœur" est repris dans toutes les versions, ce qui tend à
confirmer le rôle central de ce mot, dans ses différents sens. 
soupe
: type de cigarettes, en usage au XIX° siècle d'après Claude Jeancolas (Rimbaud, L'Oeuvre,
Textuel, p.100, 2000). Littré donne la définition suivante :
"tabac frisé roulé dans une demi-feuille de choix". 
à la
vesprée : au soir; terme disparu de la langue moderne mais connu
de tous par l'ode célèbre de Ronsard : "Mignonne allons voir si
la rose / Qui ce matin avait déclose / Sa robe de pourpre au soleil / A point perdu cette vesprée / Les plis de sa robe pourprée / Et son teint
au vôtre pareil." Antoine Fongaro (op. cit. pages 10-12)
signale en outre la présence de ce mot chez Verlaine et chez Gautier. Sa
reprise dans le contexte prosaïque de ce poème peut dès lors être
attribué à une intention parodique, à l'égard des préciosités de la
poésie "subjective". 
pioupiesques; :
Adjectif forgé par Rimbaud à partir de pioupiou
: soldat.
Beaucoup d'encre a coulé sur la question de savoir
qui pouvaient être les pioupious du texte, et s'il y avait
une clé biographique susceptible d'éclairer ce point.
Certains ont vu
dans ces soldats des Communards, sur la base d'un témoignage de Delahaye
racontant un séjour de Rimbaud à Paris, pendant la Commune, dans une
caserne de la garde nationale. Certains ont plutôt vu dans ces soldats, des
Versaillais, en s'appuyant sur le contexte historique de 1871 et
l'antipathie bien connue de Rimbaud pour le gouvernement de monsieur
Thiers.
D'autres ont trouvé plus vraisemblable d'y
déceler le souvenir de mauvais traitements
qu'aurait subis Rimbaud de la part des gardiens ou de ses co-détenus, lors
de son emprisonnement à Mazas en 1870. Antoine Fongaro écrit par
exemple : "Je soulignerai, au passage, une phrase de Delahaye parlant
du premier voyage de Rimbaud à Paris dans son Rimbaud de 1905
(cité à la page 177 du livre de Eigeldinger et Gendre, Delahaye,
témoin de Rimbaud) : "L'aventureux gamin fut d'abord enfermé
dans la cour du Dépôt [...] où il eut à défendre sa vertu contre des
voisins qui s'ennuyaient", où je vois, pour ma part, l'origine du
poème Le cœur supplicié" (Studi francesi, janvier-avril
1976, p.176-178).
Tout cela reste incertain. La mise au point la plus récente et complète est sans doute celle
proposée par Steve Murphy, op. cit. p.286, 5° partie de l'article
(Tout ce qu'on a pu inventer : la caserne de Babylone) : l'hypothèse selon laquelle Rimbaud aurait subi un viol à la caserne de
Babylone, de la part de soldats communards, en mai 1871 est considérée
par ce critique comme entièrement dépourvue de fondement. 
|
|
Commentaire |
|
|
|
Ce poème était inclus
dans une lettre envoyée par Rimbaud à son ancien professeur, Georges
Izambard, le 13 mai 1871 : Lettre dite
"du voyant" . Rimbaud consacrait deux
petits paragraphes, en fin de lettre, à présenter et à commenter ce
texte.
Il est utile d'associer l'analyse de ces deux passages à notre
explication. Voici le paragraphe introductif :
|
Vous n'êtes pas Enseignant pour moi. Je vous donne ceci : est-ce de la
satire, comme vous diriez ? Est-ce de la poésie ? C'est de la fantaisie,
toujours. − Mais, je vous en supplie, ne soulignez ni du crayon, ni
−
trop −
de la pensée : |
Steve Murphy
résume ainsi le sens de cette fin de lettre : " [Rimbaud] essaie de transformer ses rapports avec son
ancien professeur. Il refuse d'être le petit protégé d'Izambard et,
tout en écrivant « Vous n'êtes pas Enseignant pour moi », il sait que
son lecteur veillera à maintenir cette relation hiérarchique : « Mais, je vous en supplie, ne soulignez ni du crayon, ni - trop
- de la pensée ». Par cette allusion au crayon correcteur de
l'enseignant, il prévoit les réactions d'Izambard qui, même s'il ne
manie pas le crayon bleu du censeur, résistera nécessairement à ses
arguments et finira par censurer Rimbaud par la pensée" (op. cit. p.
275-276).
Le jeune homme craint que son ancien maître refuse tout simplement de
considérer Le Cœur supplicié comme de la poésie, se
débarrassant de l'objet non identifié par le terme "satire".
Autrement dit : une caricature, une pochade de collégien. Aussi
revendique-t-il le terme "fantaisie", qui au XIX° siècle tend
à désigner une oeuvre picturale ou poétique se préoccupant davantage
de libérer l'imagination que de suivre les règles. Ce n'est pas du tout
un terme péjoratif pour Rimbaud, qui a déjà utilisé le mot pour
caractériser en sous-titre un de ses textes les plus novateurs : Ma
Bohême (Fantaisie).
Certes, semble reconnaître Rimbaud par le
choix de ce terme, il y a dans "Le Cœur supplicié" une part de
parodie. Le texte reprend une forme poétique
extrêmement savante, celle du triolet, petite pièce de huit octosyllabes reposant sur
un seul jeu de rimes (qui ici se révèlent en outre particulièrement
riches : 3 ou 4 sons identiques, la plupart du temps). Le vers 1 revient trois fois (en 1, 4 et 7), le
vers 2 deux fois (en 2 et 8). Il s'agit d'une forme régulière (imitée
de Théodore de Banville, qui l'avait lui-même empruntée à la vieille
poésie française), mais aussi d'une forme ludique et
légère. Cependant, le vocabulaire et les thèmes poétiques
traditionnels y sont fort
malmenés, et c'est cette entreprise antilyrique qui va probablement choquer
Izambard. Rimbaud le sait fort bien et
c'est même pour ça - probablement - qu'il le lui envoie.
Pour autant, Rimbaud tente d'éviter que
son correspondant ne voie dans son poème que la parodie d'une forme
classique et de la moquerie à l'égard de la poésie subjective,
interprétation fortement suggérée par la lettre, juste donc mais
insuffisante. Aussi rejette-t-il implicitement le terme de
"satire" que son ancien professeur ne manquera pas d'employer.
Il y a là-dedans quelque chose à comprendre, en plus de la satire.
Quelque chose, peut-être, de plus personnel.
Le Cœur supplicié.
Mon triste cœur bave
à la poupe ...
Mon cœur est plein de caporal!
Ils y lancent des jets de soupe,
Mon triste cœur bave à la poupe...
Sous les quolibets de la troupe
Qui lance un rire général,
Mon triste cœur bave à la poupe,
Mon cœur est plein de caporal !
|
Le
titre annonce une tonalité pathétique : le mot "cœur" y
désigne apparemment le siège de la sensibilité morale, et le participe
"supplicié" signifie : torturé, mis à mort. Si ce titre
évoque quelque chose de la lettre, c'est la comparaison entre le calvaire
du poète et la passion du Christ suggérée par la citation latine
("Stat mater dolorosa, dum pendet filius"), mais
ici, pour l'instant du moins, sans l'aspect parodique de la
lettre.
Le premier vers change les données de
l'interprétation : après un groupe nominal sujet conforme aux
stéréotypes de la poésie "subjective" (pour reprendre le
terme de la lettre, on pourrait dire aussi "sentimentale", voire
"romantique") : "mon triste cœur", le groupe verbal
se signale par un vocabulaire trivial : "bave à la poupe". La
"poupe" est normalement un terme de marine désignant l'arrière
d'un bateau. Le sens du verbe "baver", dans ce contexte, ne peut
désigner que l'action de vomir. Le mot "cœur" prend donc ici,
en plus de son sens premier, le sens d"estomac" (avoir mal au cœur). Le second vers semble confirmer le premier en évoquant une
nausée due au tabac (le caporal est un tabac de mauvaise
qualité). Le troisième fait entrer en scène un groupe de personnes
("ils") qui sera désigné au vers 5 par le mot
"troupe". Ce groupe semble avoir fait du narrateur son
souffre-douleur : "ils y lancent des jets de soupe", ce qui dans
le contexte peut vouloir dire qu'ils crachent sur lui le jus de leurs
"soupes" (type de cigarettes, en usage au XIX° siècle d'après certains commentateurs), voire
leurs propres vomissements, et se
moquent de lui ("quolibets, rire général"). Résumons la
scène : le narrateur se trouve donc sur un bateau et s'est placé à la
poupe pour vomir (ce qui est, comme on le sait, plutôt conseillé), sous les
moqueries de ses compagnons de voyage. On est passé d'une tonalité
pathétique à une tonalité grotesque. Et nous n'en sommes pas outre
mesure surpris,
sachant ce que l'auteur de la lettre pense de la poésie
"subjective", "horriblement fadasse". Si la
trivialité du vocabulaire nous paraît conforme au renouvellement du
langage souhaité par le "voyant", la thématique de l'ordure n'est pas sans évoquer la volonté affichée de rompre
avec les normes morales et ce goût de la provocation qui transparaissait
déjà dans sa lettre ("tout ce que je puis inventer
de bête, de sale, de mauvais, en action et en parole, je le leur livre :
on me paie en bocks et en filles"). Sans doute a-t-il encore
inventé pour nous, lecteurs, une histoire dans le style de celles qu'il
sert aux "anciens imbéciles de collège".
Ithyphalliques et
pioupiesques
Leurs insultes l'ont dépravé;
À la vesprée, ils font des fresques
Ithyphalliques et pioupiesques;
Ô flots abracadabrantesques,
Prenez mon cœur, qu'il soit sauvé!
Ithyphalliques et pioupiesques,
Leurs insultes l'ont dépravé.
|
La
deuxième strophe change à nouveau les données de l'interprétation. Les
deux adjectifs "ithyphalliques et
pioupiesques" sont en effet de nature à nous surprendre et
nous obligent même à réviser le sens que nous avons donné à la
première strophe - ou du moins à lui accorder un double sens.
Littéralement, ce sont les "insultes" qui sont "ithyphalliques et
pioupiesques" (vers 2), puis les "fresques" (vers
3). Il serait à la
rigueur possible de comprendre que le narrateur a été
"dépravé", c'est à dire avili, par des insultes et des
dessins obscènes (ithyphalliques) émanant de soldats (pioupious). Mais
n'est-ce pas le groupe lui-même qui se trouve dépeint comme une
"fresque ithyphallique"? Sans doute! Et dans ce cas, il faut
envisager une relecture obscène de la première strophe : le
"cœur" désigne souvent chez Rimbaud le sexe; la
"poupe", en argot, est le derrière d'une personne; le
champ lexical du liquide présent dans la première strophe (bave, jets de
soupe) peut très bien être compris comme sperme, éjaculations;
enfin, le mot "caporal" est aussi un grade militaire, et l'on
sait que Rimbaud, dans une correction ultérieure de son poème intitulée
Le Cœur volé, a réécrit ce vers 2 : "Mon cœur couvert de
caporal" (où "couvrir" signifie évidemment s'accoupler).
Dans cette perspective, donc, le narrateur est en train de subir une
sodomisation de la part d'un groupe de soldats. Il sent son
"cœur" souillé et en appelle aux flots purificateurs de la
mer. La scène se passe le soir :
c'est ce qu'indique "à la vesprée" avec un effet parodique dû
à la présence, insolite dans ce contexte, d'un syntagme issu d'un des
fleurons de la poésie lyrique française (Mignonne, allons voir si
la rose ...). Cette nouvelle version de la
scène opère un recentrement de la tonalité sur l'idée de supplice
évoquée par le titre et sur le sens de l'adjectif "triste".
L'invocation aux "flots abracadabrantesques" exprime en termes
burlesques une idée pathétique. La blague commence à grincer, et le
lecteur y est d'autant plus sensible que l'écriture à la première
personne suggère une possible source biographique. Le rapprochement avec
la "lettre du voyant", notamment avec le thème du "dérèglement de
tous les sens" où chacun est à même d'entendre - entre autres -
l'appel à l'expérimentation de "toutes les formes d'amour"
(lettre du 15 mai), valide cette réception du texte.
Quand ils auront tari
leurs chiques,
Comment agir, ô cœur volé?
Ce seront des refrains bachiques
Quand ils auront tari leurs chiques!
J'aurai des sursauts stomachiques
Si mon cœur triste est ravalé!
Quand ils auront tari leurs chiques,
Comment agir, ô cœur volé?
|
Cette
troisième strophe confirme toutes les hypothèses de sens que les deux
précédentes nous ont suggérées : les "chiques" (qui ne sont
plus guère de mode aujourd'hui) étaient
des morceaux de tabacs roulés ou tressés que l'on mâchait. Les marins
étaient traditionnellement représentés en train de chiquer. Cette
façon de consommer le tabac impliquait de cracher de loin en loin
le jus amer produit par la mastication, d'où le sens argotique (attesté
par les dictionnaires spécialisés) de
"tirer une chique" : tirer un coup, éjaculer. Nous
retrouvons donc la polysémie tabac/sexe. Les
"refrains bachiques" sont des chansons à boire :
première apparition explicite de l'alcool comme cause possible des
"sursauts stomachiques" du narrateur, tout à fait compatible
avec les autres causes mentionnées, la mer, le tabac, et le dégoût sexuel. Le
participe "ravalé" qui signifie rabaissé, avili,
reprend l'idée de "quolibets", "insultes", "rire
général" et s'inscrit de façon connotative dans le lexique
stomachique. L'expression "ô cœur volé" reprend à la fois la
signification sentimentale du titre et l'idée obscène du viol :
"volé" signifie prendre de force, il suggère un
individu non consentant, ou au minimum : naïf, abusé, bien qu'à demi
consentant (interprétation obscène); en abusant du narrateur
"ils", les soldats, ont meurtri sa sensibilité, l'ont
moralement anéanti (interprétation sentimentale). La scène a maintenant
acquis son profil définitif : une scène de beuverie au cours de laquelle
un individu naïf se fait violenter et insulter par une troupe de soldats
priapiques et avinés. La scène se passe sur un bateau, à moins que la
présence de la mer et du mal de mer ne soit finalement qu'une métaphore
imageant la nausée éprouvée par le narrateur.
La
question finale : "comment agir ?" n'est pas facile à
interpréter. Le narrateur se demande-t-il seulement comment ré-agir lorsqu'il aura subi jusqu'au
bout les crachats et/ou les assauts sexuels de "ils" ? On
peut risquer une lecture biographique de cette phrase et du poème dans
son ensemble à la lumière de la lettre où il trouve place. Rimbaud
évoque dans cette lettre la vie dépravée et la situation précaire qui
sont les siennes à Charleville en ce mois de mai 1871, sans argent, se
faisant "entretenir" par des compagnons qu'il méprise
(compagnons de bistrot et, peut-on supposer, de beuverie et de
débauche) : l'anecdote du poème pourrait fort bien être comprise
comme une représentation allégorique de cette situation vécue. Par
ailleurs, les deux lettres "du voyant" témoignent du besoin
d'agir, d'agir politiquement, qui s'impose au jeune poète en ces temps de
révolution communarde. Ce que nous savons des activités politiques de
Rimbaud pendant son séjour à Douai auprès d'Izambard en sept.-oct. 70
confirme cette préoccupation. Or, la lettre à Izambard du 13 mai 1871,
qui contient "Le Cœur supplicié", montre aussi que Rimbaud
hésite à rejoindre le Paris de la Commune où ses désirs l'appellent.
Il est plus que probable que le jeune homme se sent, pendant ces journées
révolutionnaires de mai 1871, englué dans une vie médiocre et
dégradante, et coupable de s'y complaire alors que tout (ses engagements
politiques, l'idée qu'il se fait de la poésie) devrait le porter vers
cette "bataille de Paris, où tant de travailleurs meurent pourtant
encore tandis que je vous écris !" D'où peut-être ce cri de
désarroi : "Comment agir, ô cœur volé ?"
La lettre du 13 mai
s'achevait par ces quelques mots, très significatifs de la façon dont
Rimbaud percevait la réception de ses oeuvres :
|
Ça ne veut pas rien dire. −
RÉPONDEZ-MOI : chez M. Deverrière, pour A. R.
Bonjour de cœur,
Art. Rimbaud.
|
Rimbaud tente de prévenir la réaction négative qu'il
redoute chez son lecteur. En l'occurrence, son premier lecteur : Izambard.
Il suppose que cette réaction sera un brutal : "ça ne veut rien
dire". Et donc, sur le même ton familier, il prend soin d'avertir :
"ça ne veut pas rien dire".
Rimbaud est conscient de l'incompréhension que
risque de rencontrer le langage poétique nouveau qu'il est en train de
mettre au point. Non seulement sur le plan de la théorie (voir plus haut
: "vous ne comprendrez pas du tout, et
je ne saurais presque vous expliquer"), mais aussi sur le plan de la
lisibilité des textes. On constate en effet, avec Le Cœur supplicié qu'il
fait porter son effort sur plusieurs plans :
− un
renouvellement thématique à tonalité parodique et satirique, le "voyant" doit débarrasser la
poésie de cette conception sublimée et fausse de la vie, de l'amour, de
la sexualité que l'on est habitué à associer à l'idée même du
"poétique", il doit pouvoir dire en toute lucidité la violence des
rapports humains (des rapports sociaux dans d'autres textes), le dégoût que cette violence
engendre;
− un
traitement nouveau du vocabulaire, fondé sur le choix de termes
polysémiques, permettant au poète de superposer dans le texte plusieurs
niveaux de lecture.
− la
greffe sur la tradition du lyrisme personnel (poésie subjective) d'une
dimension allégorique et symbolique à portée générale (poésie
objective). Ainsi, l'argument du poème est trop caricatural
("fantaisiste", fantastique) pour pouvoir
être assimilé à une histoire vécue par le poète : le bateau, les
déluges de bave et de vomissures, le viol par des soldats, ne renvoient
probablement pas, tels quels, à un souvenir précis de l'auteur, même s'il
ne fait aucun doute que Rimbaud transpose ici une expérience des
beuveries, et peut-être même de la sodomie. Le narrateur est une représentation
de l'auteur, mais une représentation stylisée
susceptible d'ouvrir des perspectives symboliques.
Ainsi, les
commentateurs ont pu y déceler tour à tour ou
simultanément un symbolisme esthétique, psychologique, politique.
− Un
symbolisme esthétique : Le narrateur serait une allégorie du poète
sentimental "fadasse" démenti et déniaisé par la découverte
de l'amère réalité; le poème, une version parodique de l'Albatros de
Baudelaire (d'où l'environnement marin). Cette interprétation est
validée par le titre donné par Rimbaud à sa deuxième version du poème
: Le Cœur du pitre (le pitre, le bouffon, le saltimbanque, sont
des allégories traditionnelles du poète). Cette lecture est aussi
confortée par la présentation que Rimbaud fait de son poème dans la
lettre à Demeny du 10 juin 1871 : "c'est une antithèse aux douces
vignettes pérennelles où batifolent les cupidons". Autrement dit,
c'est une charge contre la poésie lyrique et sentimentale stéréotypée.
C'est pourquoi Rimbaud s'excuse auprès de Demeny qui (comme Izambard)
pourrait se sentir visé : "Voici - ne vous fâchez pas" - (2
fois)
− Un
symbolisme psychologique : Pour Steve Murphy : "Le Cœur volé s'inscrit dans un
ensemble de poèmes (des années 70-71) montrant de façon satirique le
jeune homme inexpérimenté, face aux problèmes de la sexualité (...) Le
narrateur du Cœur volé partage avant tout la passivité des
personnages de ces autres textes. Comment agir? se demande-t-il
(...) L'être passif a toutes les chances de se faire exploiter
sexuellement" (op. cit. p.293). Le poème serait fondamentalement le récit
d'une initiation homosexuelle; c'est ainsi que le comprenait Verlaine qui
dans un poème "particulier" reprend ainsi le premier vers de
Rimbaud : " Mon triste cœur bave à la quoi, bave à la merde"
(Verlaine, Oeuvres poétiques, édition de la Pléiade, 1954, page
720).
− Un
symbolisme politique : beaucoup d'encre a coulé sur la question de savoir
qui pouvaient être les "pioupious" du texte, et s'il y avait
une clé biographique susceptible d'éclairer ce point. Certains ont vu
dans ces soldats des Communards, sur la base d'un témoignage de Delahaye
racontant un séjour de Rimbaud à Paris, pendant la Commune, dans une
caserne de la garde nationale. Certains ont vu dans ces soldats, des
Versaillais, en s'appuyant sur le contexte historique de 1871 et
l'antipathie bien connue de Rimbaud pour le gouvernement de monsieur
Thiers. D'autres y ont décelé le souvenir de mauvais traitements
qu'aurait subis Rimbaud de la part des gardiens et de ses co-détenus, lors
de son emprisonnement à Mazas en 1870. Tout cela est aléatoire. Mais, en
tout cas, tout le monde perçoit bien la provocation anticonformiste et
antibourgeoise que constitue ce texte, ce qui en fait sans aucun doute
possible un poème d'esprit communard.
Ces
caractéristiques novatrices (antilyrisme, polysémie du
vocabulaire, multiplication des niveaux de lecture et des perspectives
symboliques) contribuent à compliquer sérieusement la lecture des
textes. D'où la mise en garde : "Ça ne veut pas rien
dire!"
Certains
commentateurs ont perçu en outre dans ce conseil de lecture une sorte
d'appel au secours, un appel en tout cas à plus de compréhension morale
de la part d'Izambard. Ils ont certainement raison : l'ambiguïté de
Rimbaud est totale dans les rapports qu'il entretient avec ses lecteurs,
et notamment avec ces premiers lecteurs et confidents particuliers que
furent en ces années-là Banville, Izambard et Demeny. Rimbaud essaie de
les choquer, polémique
parfois violemment avec eux, directement ou indirectement par le biais des
poèmes qu'il leur adresse, mais il n'est pas rare que le réquisitoire
contre tout ce qu'ils représentent laisse la place à de pathétiques
appels à l'aide. Voir par exemple la lettre à Demeny du 28 août 1871.
Il en est de même dans cette lettre à Izambard. Mais ce qui frappe par dessus
tout dans Le Cœur supplicié, c'est la façon dont la tonalité
pathétique (l'appel à la pitié) finit par l'emporter sur tout l'arsenal parodique (la fantaisie).
Le contraste est saisissant, sur ce point, entre l'atmosphère du poème
et le ton
provocateur et
plein de superbe de la lettre par laquelle Rimbaud l'adresse à son
ancien professeur, Georges Izambard (lettre
du 13 mai 1871). Ce qui nous émeut dans le texte tient moins au
texte lui-même qu'au lien que nous établissons entre ce qui nous est raconté et ce
que nous savons ou croyons deviner de la vie et de la personnalité de l'auteur. Peu
importe, de ce point de vue, que les clés biographiques alléguées par
les uns ou les autres aient un fondement ou pas. Peu importe que le
narrateur ne puisse pas être totalement identifié à l'auteur. Car
nous sentons que dans ce poème Rimbaud parle de lui, du
"mouchoir de dégoût qu'on [lui] a enfoncé dans la bouche"
(lettre à Demeny du 28 août 1871). Et, du coup, la trivialité forcée
du texte nous apparaît comme un masque, et les efforts faits par l'auteur
pour se cacher derrière ce masque renforcent en
réalité chez le lecteur l'intuition de sa détresse. Paradoxalement, ce poème de combat
antilyrique est un puissant exemple de lyrisme personnel, d'un genre
nouveau. Le refus du
sentimentalisme n'est chez Rimbaud qu'une façon de serrer les dents pour
dominer la souffrance. Reprenant probablement une formule de sa mère à
son encontre, Rimbaud aime à se présenter comme un
"sans-cœur". Mais, comme le note Steve Murphy : "il allait
sans dire, pour Delahaye comme pour Izambard, que ce n'était pas le
véritable Rimbaud, mais son masque protecteur : le sans-cœur était
une façade, servant à cacher les émotions authentiques du jeune homme.
Ainsi, la parodie, l'écriture satirique, ont-elles protégé du regard la
personnalité réelle, blessée, du poète".
|
|
Bibliographie |
|
|
|
|
| La Crise du Logos et la quête du mythe, par
Mario Richter, À la Baconnière, 1972 (1976). |
| Lettres du voyant, éditées et commentées
par Gérald Schaeffer, Droz, 1975. |
| Le Cœur supplicié, dans Poèmes
de la révolte et de la dérision, par Gérald Schaeffer, dans Études
sur les "Poésies" de Rimbaud, À la Baconnière - Payot,
1979. |
| Le sacré-cœur volé du poète,
par Steve Murphy, dans Lectures de Rimbaud, Revue de
l'Université de Bruxelles, n°1-2, pages 27-45, 1982 |
|
Rimbaud : Projets et réalisations, par
Pierre Brunel, pages 63-71, 74-79, 1983. |
| À propos du Cœur supplicié,
par J. Chocheyras, dans Parade sauvage n°3, pages 33-35, 1986. |
| Rimbaud intertextuel, par
Michael Riffaterre, dans Parade sauvage, colloque n°2, pages
93-106 (plus particulièrement, pages 100-105), 1990. |
| La Figure du pitre : Le Cœur
volé,
par Steve Murphy, dans Le Premier Rimbaud ou l'apprentissage de la
subversion, pages 269-316, 1991. |
| Le Cœur supplicié − Le Cœur du pitre,
par Yasuaki
Kawanabe, dans Rimbaud : 1891−1991,
Actes du colloque d'Aix-en-Provence et de Marseille, pages
27-37, 1994. |
| Le Cœur du poète, par Jacques Bienvenu,
dans Parade sauvage n°14, pages 43-54, mai 1997.
|
| Le cœur parodié : Rimbaud
réécrit par Izambard, par Steve Murphy, dans Parade sauvage
n°15, pages 49 à 66, novembre 1998.
|
| "Vesprée, poupe, alme et le
reste", par Antoine Fongaro, dans Parade sauvage n°16,
mai 2000. Il s'agit, entre autres, d'une réfutation de l'article de
Jacques Bienvenu qui donnait à "poupe" - vers 1 - le sens
de "seins". Voir aussi la réponse de Jacques Bienvenu à
cette critique dans Parade Sauvage n°17-18, Août 2001,
pages 7-9 : "Le Cœur du pitre : une réponse".
|
| "Un
hapax magique : abracadabrantesque", par
Steve Murphy et Georges Kliebenstein, Rimbaud. Poésies, Une saison en enfer, édition Atlande, 2009,
p.176-179. |
|
|
|