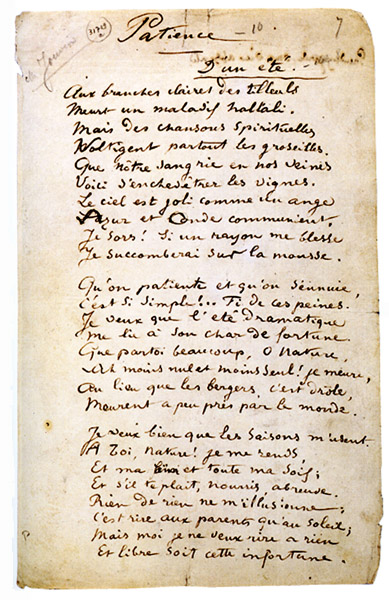|
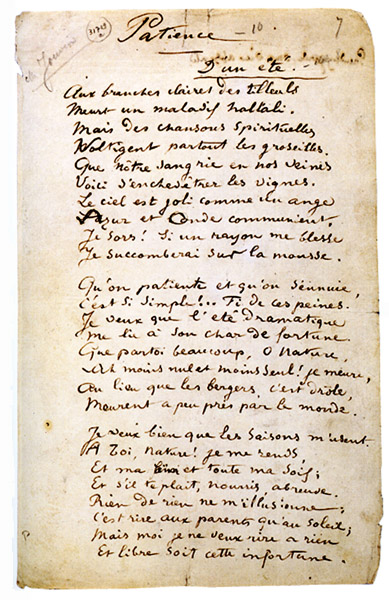
Source : Histoires littéraires n°17
Janvier-février-mars 2004
>>>
Commentaire
|
|
Patience (d'abord intitulé
Bannières de mai) présente un découpage assez
classique en strophes d'octosyllabes (un dizain suivi de
deux huitains). Mais le texte frappe par
sa versification
désinvolte (suppression des rimes), le style oral du langage ("c'est drôle", "rien de rien ne
m'illusionne") à la limite du
galimatias parfois (qu'est-ce que : mourir beaucoup
ou mourir à peu près ?), les constructions plus que
bizarres (v.4), la syntaxe elliptique (ô combien !), l'enchaînement rapide
et léger de
formules concises, l'humour
grivois
(v.9-10, v.17-18). Tout
cela produit une impression de
nouveauté et de grande liberté.
Les trois
strophes, plus qu'un discours suivi, constituent trois volets
relativement autonomes d'une célébration de la nature et du
soleil. Rimbaud semble y délibérer entre trois façons
distinctes de capter l'énergie vitale émanant
du renouveau printanier : la participation à la naïve allégresse
collective, l'holocauste fusionnel, la libre
infortune. La dernière de ces postures
existentielles est celle à laquelle, finalement, le poète se range.
|
Dans le dizain, Rimbaud évoque l'universelle allégresse ayant coutume
d'accueillir le retour du printemps. Il emprunte à l'imagerie chrétienne
(le sang et la vigne, le ciel et les anges) mais aussi à la tradition
bucolique de l'antiquité païenne : il revisite brillamment, non sans
ironie, les lieux communs propres aux célébrations vernales. Répondant à
l'appel de la nature en fête, le poète risque-t-il vraiment de
"succomber" sous les dards du soleil ? Bergers et bergères, il est vrai,
"succombent" volontiers aux flèches de Cupidon ou de Phbus, quand le
printemps revient. Mais ils n'en meurent qu'"à peu près".
Le ton change du tout au tout dans la deuxième strophe. En proie à
la "patience" (c'est-à-dire à la souffrance de l'attente) et à
l'"ennui", le sujet lyrique se montre décidé à dire "adieu au monde"
(selon la formule employée dans
Alchimie du verbe pour caractériser les "drôles de romances" du
printemps 1872). Il s'agit encore de "mourir" dans et par la nature,
mais "beaucoup" cette fois. C'est la tentation d'une "mort solaire",
intense et entière, mort dans la communion avec le Grand Tout, raison pour
laquelle on s'y sent "moins nul et moins seul". Mort érotique aussi
puisqu'elle consiste à s'enchaîner au char du dieu Soleil, "foyer de
tendresse et de vie", qui "verse l'amour brûlant à la terre ravie" (Soleil
et Chair).
Le second huitain marque, sinon une opposition, du moins une nette
inflexion, par rapport au précédent. Il suffit pour s'en convaincre de
comparer le "Je veux" de la strophe 2 avec le "Je veux bien" qui ouvre
la troisième : on est passé d'un élan impérieux à une acceptation
résignée. Acceptation de l'usure des saisons, de la vie soumise au
Temps ! Cette dernière strophe procède au dépassement des solutions
illusoires : "Rien de rien ne m'illusionne".
Après avoir moqué, pour sa naïveté, la célébration conventionnelle du cycle des
saisons, c'est-à-dire l'ancestrale patience (strophe 1), Rimbaud prend
ses distances avec l'impatiente mort mystique (fantasmée dans la strophe
2). Il sait illusoire, hélas, cette prise de congé radicale qui relève de
ce qu'Alchimie
du verbe
appellera "les sophismes de la folie" : "Aucun des sophismes de la folie, la folie
qu'on enferme, n'a été oublié par moi : je pourrais les redire tous,
je tiens le système." Il opte donc finalement pour une
philosophie à mi chemin de ces deux extrêmes : la patience pure,
l'impatience pure. Il choisit la "liberté libre" (lettre
du 2 novembre 1870), dont il sait désormais qu'elle ne préserve pas
de "l'infortune". Mais il supplie la Nature de lui réserver,
pour assouvir (imparfaitement) sa "faim" et sa "soif",
ces "influx de vigueur et de tendresse réelle" (Adieu), ces moments
(au moins)
d'intensité qui font que la vie mérite d'être vécue. C'est ce qu'il
appellera dans l'Adieu
d'Une Saison en enfer l'"ardente patience".
|