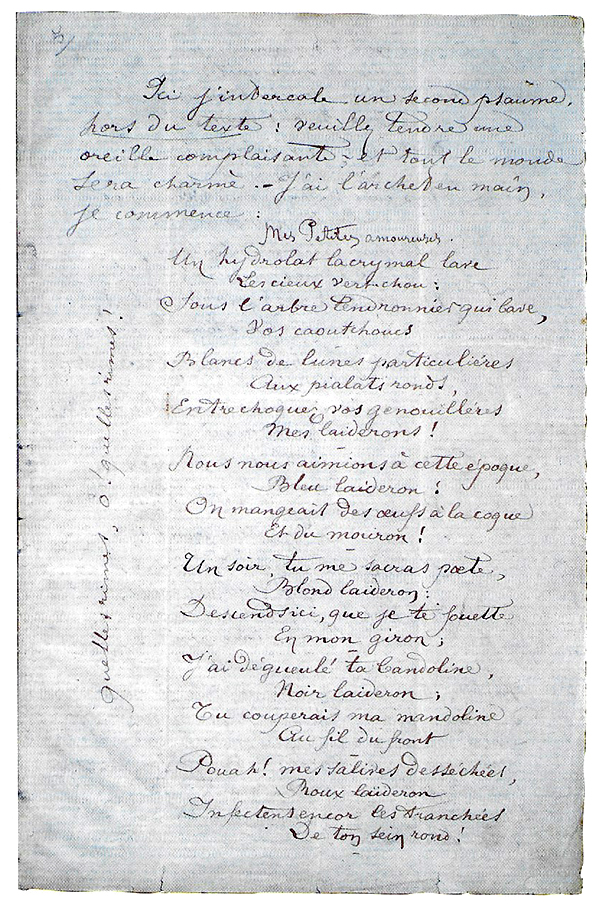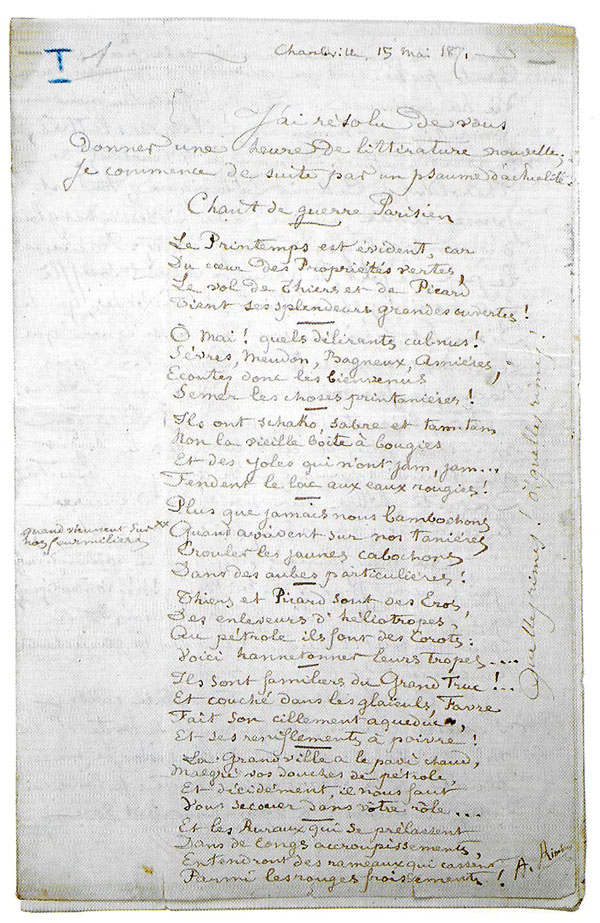|
Lettre à Paul Demeny
du 15 mai 1871 |
On trouvera en fin de page une
bibliographie et la
liste des abréviations utilisées pour désigner les références les
plus fréquentes.
La mention "op. cit." (suivie éventuellement d'une date) renvoie aux ouvrages cités
dans la bibliographie.
|
|
SUR CERTAINES PARTICULARITÉS DU MANUSCRIT
Nous essayons, dans notre
reproduction du texte, de donner une idée de la façon dont se présente le manuscrit.
Nous respectons les particularités de sa
graphie (alinéas, soulignements,
tirets) et matérialisons par un trait horizontal chaque saut d'une page à une autre.
Pour les poèmes inclus par Rimbaud dans sa lettre, nous nous contentons
de renvoyer le lecteur aux pages de ce site où l'on peut en trouver le
texte (ainsi que, dans deux cas sur trois, le commentaire). Nous ne les reproduisons pas, mais cela ne signifie pas que nous
ne les prenions pas en compte dans nos explications. On
possède aujourd'hui d'excellents fac-similés auxquels il est aisé (et
vivement conseillé) de se
reporter. Fac-similés en couleur dans le volume de
Correspondance publié par Jean-Jacques Lefrère
en 2007 chez Fayard (p.49 pour le feuillet 1 du manuscrit, puis 192 et
suivantes pour les feuillets 2 à 11). En noir et blanc dans le tome IV de
l'édition Steve Murphy des Œuvres complètes (Champion 2002)
aux pages 256 et suivantes.
Ce manuscrit est
constitué de trois feuilles de format 20,6 x 13,3 cm, pliées en deux,
soit 12 pages. La douzième portait l'adresse de Demeny. Le texte occupe onze pages. L'observation du document montre que la graphie n'est
pas la même tout le long de la lettre. Il semble que la composition ait
connu plusieurs étapes. André Guyaux pense que, dans un premier moment,
le texte (dans sa partie théorique) n'était pas destiné à la
correspondance. Les poèmes se seraient ajoutés par la suite et
Rimbaud aurait rédigé alors (en étant parfois obligé de les coincer dans
des espaces exigus, en haut et en bas de page), les quelques
phrases d'introduction, de transition ou de conclusion qui sont
directement adressées à son correspondant, de manière à donner à l'ensemble
l'aspect d'une lettre. Il constate aussi que les titres des deux
derniers poèmes ont été ajoutés en petites lettres dans les interlignes,
ce qui montre que Rimbaud avait d'abord envisagé de les insérer sans
titres. Exemples :

Page 2 (haut de page). La première ligne semble avoir été
ajoutée
après coup, dans l'espace libre, en haut de page.
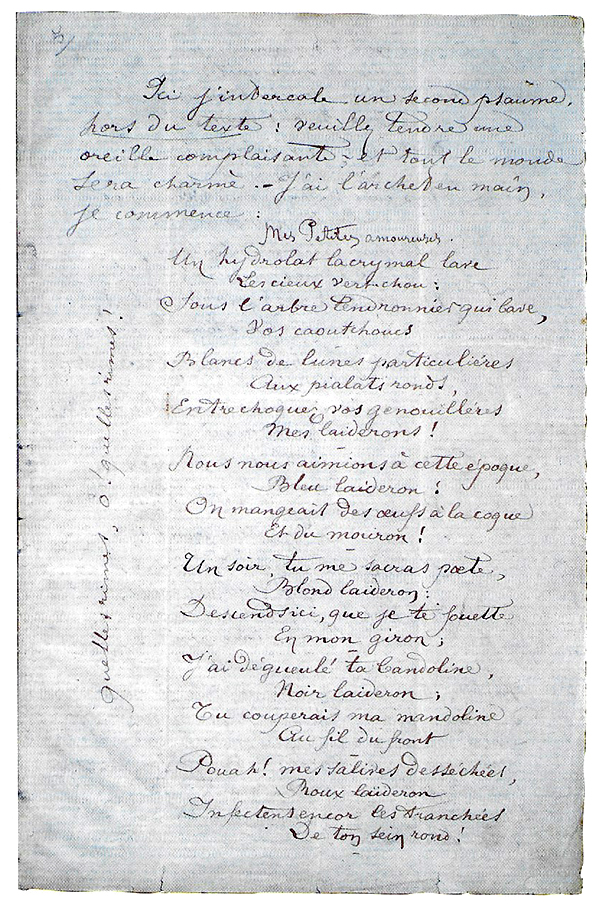
Page 5. Le titre du poème a
été ajouté après coup, en lettres plus petites,
dans l'espace libre entre les quatre lignes de transition et le poème.
La graphie de la page semble plus appliquée que celle du feuillet
2 ci-dessus.
Noter en marge la remarque : "Quelles rimes. O ! quelles rimes !"
Ces hypothèses
concernant les étapes de l'élaboration de la lettre et leur
interprétation ont fait l'objet d'un débat compliqué, que nous nous
contentons de signaler. Se reporter à Guyaux 1987 et
2009, ainsi qu'à Wetzel 2008. Les remarques de ce dernier critique sur
la première page de la lettre nous paraissent cependant devoir être
mentionnées ici, car elles engagent l'interprétation du texte et sont
tout à fait convaincantes :
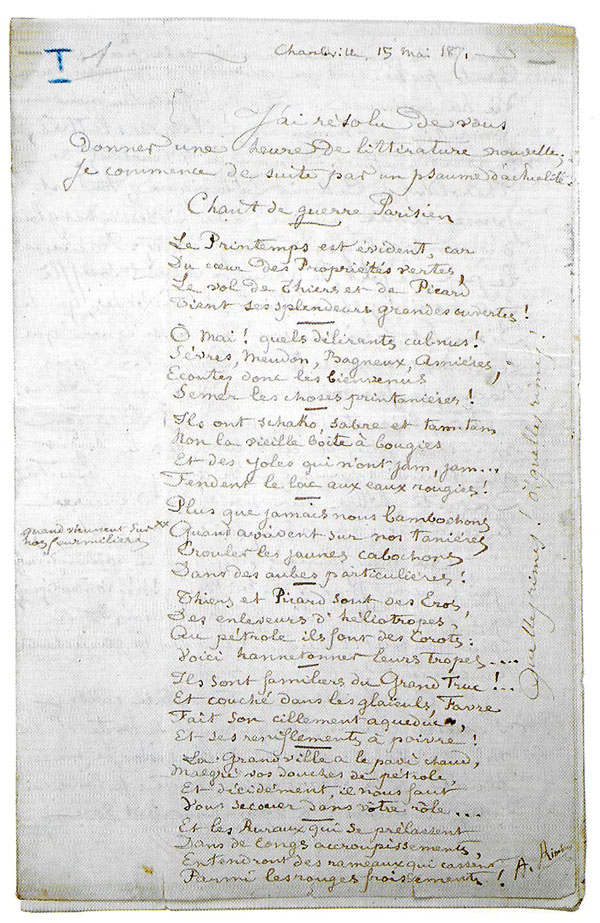
page 1. La lettre "I" au
crayon bleu et le "1" au crayon à papier sont de Darzens,
à qui Demeny vendit cet autographe en 1887 (JJL p. 66 n.1).
À en
juger par la graphie du titre, tout à fait semblable à celle du
poème lui-même, "Chant de guerre Parisien est le seul des trois poèmes
dont le titre n'est pas ajouté plus tard. Ce qui laisse penser à une
décision contemporaine à l'insertion des deux autres titres ajoutés en
interligne" (Wetzell, 2008, p.369). Cette insertion, comme nous l'avons
vu, a été tardive et postérieure à l'inscription des poèmes eux-mêmes.
Il est donc probable que ce premier poème a été copié après les deux
suivants, à un moment où les feuillets 2 à 11 étaient déjà entièrement
remplis. Comment expliquer que la première page de cette lettre ait été
la dernière à être achevée ? Comment expliquer que Rimbaud ait commencé
à recopier son discours théorique en haut de la page 2, en laissant
vierge tout ou partie de la page 1 ? C'est que
Rimbaud, nous dit Wetzell, "veut donner tout de suite un exemple de
cette poésie nouvelle" annoncée dès la première phrase de la lettre et
que "malheureusement, le poème n'est pas encore prêt" (ibid.). Le poète
réserve donc une place mais la graphie, de plus en plus serrée au fur et
à mesure qu'on avance dans le texte, montre que l'espace prévu s'avère
insuffisant et que le scripteur est obligé d'écrire de plus en plus
petit, de signer en marge et de reporter dans la marge supérieure de la
page suivante, entre tirets, la transition destinée à introduire la
dissertation théorique ("— Voici de la prose sur l'avenir de la poésie —" ).
Ce
raisonnement fondé sur la graphie converge avec l'hypothèse de datation inspirée à Steve
Murphy par un détail du poème : "[...] les « splendeurs grandes
ouvertes » de Thiers et de Picard paraissent évoquer la décision de la
Commune d'ouvrir leurs propriétés en démolissant la maison de Thiers,
prise le 11 mai [...]. Dans ce cas, le poème aura peut-être été écrit
peu de temps avant l'envoi de la lettre de la lettre à Demeny, le 15
mai." (SM-IV, p.529).
Il serait
même possible, comme Wetzell en émet l'idée, que Rimbaud ait "fait ce
poème exprès pour l'occasion" (ibid. p.370). Il aurait souhaité attaquer
son manifeste sur une évocation de la plus brûlante actualité,
introduisant "très bien au ton progressiste, « impulsif », véhément et
insolent de toute la lettre, qui règle en les parodiant leur compte à
« la poésie gratuite, au sentimentalisme, aux prouesses techniques, au
romantisme à la Musset, à l'indigence des derniers parnassiens » pour
citer André Guyaux (p.61) qui reprend des remarques de Jacques Rivière."
(ibid. p.370).
|
page 1
|
|
Charleville, 15 mai 1871
J'ai résolu de vous donner une heure de littérature nouvelle. Je
commence de suite par un psaume d'actualité.
|
|
page 2
|
|
— Voici de la prose sur l'avenir de la poésie
—
|
|
|
|
Une double prophétie
Sous l'appellation de
"littérature nouvelle", Rimbaud désigne deux réalités un peu
différentes. D'une part les trois poèmes joints à la lettre, dont le
premier est caractérisé comme un "psaume d'actualité" et qui sont autant
de choses nouvelles, en effet, dans sa
production poétique. D'autre part la poésie nouvelle qu'il appelle de
ses vœux et qu'il désigne un peu plus loin comme "l'avenir de la poésie"
("Voici de la prose sur l'avenir de la poésie"). Son destinataire, le
poète douaisien Paul Demeny, était donc induit à comprendre que ces
productions récentes d'Arthur Rimbaud constituaient autant
d'échantillons d'un nouveau type de littérature dont le programme allait
lui être exposé.
Le "psaume d'actualité" que Rimbaud place en tête de sa
lettre est tout ce qu'il y a de plus éloigné d'un chant religieux (sens
véritable du mot "psaume"). On a là un exemple parmi d'autres de cet
usage des mots de la littérature sacrée ("prière",
"dévotion", "oraison", "chant pieux") qu'affectionne Rimbaud pour désigner ses poèmes
les moins moralement ou politiquement corrects. Quoique renvoyant par
son titre et son modèle métrique et strophique au Chant de guerre
circassien de François Coppée, celui-ci est
inspiré par la situation politique de la mi-mai 1871. Paris, dont la
population est entrée en révolution le 18 mars contre le Gouvernement
officiel réfugié à Versailles, est sous les bombes des "Ruraux".
C'est-à-dire des monarchistes et des républicains conservateurs que les
"Communards" parisiens considèrent comme les élus quelque peu arriérés
de la province, ou de la campagne, plus que comme les représentants
légitimes de la République proclamée à Paris le 4 septembre 1870. Au
moment où Rimbaud envoie son poème, la Commune de Paris n'est pas encore
battue (elle le sera au cours de la "semaine sanglante" du 21 au 28
mai). Manifestement, Rimbaud est encore plein d'optimisme et, dans le
dernier quatrain du poème, déclare avec assurance que ce seront bientôt
les "Ruraux" qui se
trouveront sous les bombes des rouges, dans leur retranchement versaillais :
Et les Ruraux qui se prélassent
Dans de longs accroupissements,
Entendront des rameaux qui cassent
Parmi les rouges froissements
Le mot "accroupissements", qui sert ici
de raillerie scatologique et injurieuse à l'égard des bourgeois de
Versailles (un peu plus haut dans le poème, Rimbaud les appelle aussi
"cul-nus" semant leurs "choses printanières" sur le peuple de
Paris), fournira aussi le titre du troisième poème de la lettre. Ce texte
(Accroupissements) vise une autre des cibles favorites de la
révolte communarde, le curé ("le frère Milotus"), représenté en train de
s'accroupir en retroussant sa chemise sur son "pot blanc", au milieu des
remugles intestinaux, des hoquets, et du bruit des poils qui poussent
"dans sa peau moite".
On lit souvent que Rimbaud parle ici sur un
"ton prophétique", que le style de ce texte relève de la "prose
oraculaire". En effet ! De même que, dans Chant de guerre
Parisien,
il voit déjà les Versaillais assiégés dans leur repaire par les
Communards vainqueurs, de même, dans son discours sur la "l'avenir de la
poésie", Rimbaud ne se contente pas d'exposer un projet ou un vœu, il en
sait d'avance la réalisation. Il affirme sur un ton péremptoire, en des
formules lapidaires conjuguées au futur, que : "ces poètes seront" ; "la
Poésie ne rythmera plus l'action ; elle sera en avant" ; "le
temps d'un langage universel viendra" ; "cette
langue sera de l'âme pour l'âme" ; "l'avenir sera matérialiste" ;
"quand sera brisé l'infini servage de la femme [...] la femme trouvera
de l'inconnu !" ... et que 'la raison [lui] inspire plus de certitudes sur
le sujet que n'aurait jamais eu de colères un Jeune-France".
On peut donc dire que cette lettre constitue, dans
les domaines de la politique et de la littérature, une double prophétie.
Rimbaud ne s'y contente pas de rêver la victoire de la Commune, de conchier
en vers parnassiens curés, "petites amoureuses"
et bourgeois Versaillais, il y rêve aussi ("on n'est
pas sérieux quand on a dix-sept ans") de faire table rase de toute la
poésie du passé. On verra que même Baudelaire, qualifié comme "un vrai
Dieu" et dont les idées sont largement mises à contribution pour
cette leçon de "littérature nouvelle", s'attire une sévère rebuffade ("la forme si vantée
en lui est mesquine").
Comme Steve Murphy l'a fait remarquer dans Rimbaud
et la Commune (op.cit.) — en polémiquant avec une appréciation peu
pertinente de Marcelin Pleynet dans son Rimbaud en son temps — le
destinataire de la lettre, qui n'était pas spécialement un sympathisant
de la Commune, en a certainement fort bien perçu le caractère
provocateur et très politique. Rimbaud n'a certes pas réservé à Demeny
le style brutal de la missive adressée deux jours plus tôt à Georges
Izambard. Il semble même avoir tenté d'adoucir l'effet de ses formules
un peu trop définitives par des plaisanteries, par une emphase parfois
si appuyée qu'on ne saurait l'attribuer qu'à une humeur quelque peu
goguenarde ("badine", dit Murphy). Mais, contrairement à certains
critiques mal réveillés, on peut être assuré que Demeny, cette lettre
lue, n'aura certainement pas conclu à un manifeste purement esthétique
dépourvu de politique.
|
Toute poésie antique
aboutit à la poésie grecque ; Vie harmonieuse.
─
De la Grèce au
mouvement romantique,
− moyen-âge,
− il y a des lettrés, des
versificateurs. D'Ennius à Théroldus, de Théroldus à Casimir
Delavigne, tout est prose rimée, un jeu, avachissement et gloire
d'innombrables générations idiotes : Racine est le pur, le fort, le
grand.
− On eût soufflé sur ses rimes, brouillé ses hémistiches, que
le Divin Sot serait aujourd'hui aussi ignoré que le premier venu auteur
d'Origines.
− Après Racine, le jeu moisit. Il a duré deux mille ans !
Ni plaisanterie, ni paradoxe. La raison
m'inspire plus de certitudes sur le sujet que n'aurait jamais eu de
colères un Jeune-France. Du reste, libre aux nouveaux ! d'exécrer les
ancêtres : on est chez soi et l'on a le temps.
|
|
|
|
Le congé donné à la Tradition (antique, médiévale et classique)
La référence à la
situation de la poésie dans la Grèce antique revient à plusieurs
reprises dans le texte. Dès ce début, on lit : "Toute poésie antique
aboutit à la poésie grecque ; Vie harmonieuse."
"Dans Les Élévations (1864), nous apprend Yann
Mortelette (op. cit. p.26),
Des Essarts illustra le versant antiquisant de l'esthétique
parnassienne. Il exprima son regret de n'avoir pas vécu en Grèce antique
dans le poème La Vie harmonieuse, auquel Rimbaud fait peut-être
allusion dans la lettre du 15 mai."
|
EMANUEL DES ESSARTS
___________
LA VIE HARMONIEUSE
Jadis j’aurais vécu dans
les cités antiques,
Svelte comme un héros, plus libre qu’un vainqueur,
Et tous mes jours, pareils aux visions plastiques,
Se fussent déroulés noblement comme un chœur.
Là, j’aurais contemplé l’avenir et la vie
Sur le blanc piédestal de la sérénité,
Sans élan surhumain, sans orgueilleuse envie,
Heureux d’un idéal visible et limité.
J’eusse borné mes vœux et mesuré mon rêve
Au soleil fugitif, au mois, à la saison,
A tout ce qui se voit, à tout ce qui s’achève,
Aux contours arrêtés d’un petit horizon.
J’eusse été citoyen de quelque république
Songe de Pythagore, œuvre d’un Dorien,
Harmonieux Etat réglé par la musique,
Où la loi se conforme au rythme aérien.
Puis, dans une agora, j’aurais avec ivresse
Admiré longuement les poses et les sons
De ces beaux orateurs dont la phrase caresse
L’oreille inattentive aux rigides leçons,
Et devant la tribune, étendu sur le stade,
J’aurais senti descendre à moi, sous un ciel clair,
Le flot sonore et pur qu’épanche Alcibiade,
Et monter le murmure éloquent de la mer.
O la vie adorable, élégante et facile !
Du lierre sur le front, des myrtes dans les mains,
Les jardins embaumés où le sage s’exile,
Et l’accueil de la flûte au détour des chemins !
Ainsi, franc de
remords, étranger à la plainte,
De mon droit au bonheur fermement convaincu,
Un jour je serais mort sans regret et sans crainte.
Harmonieusement, comme j’aurais vécu !
Les Élévations (1864)
|
Le poème d'Emmanuel des
Essarts déploie cette vision un tantinet mythique de la cité antique, sorte de
république des Poètes, "Etat réglé par la musique, / Où la loi se
conforme au rythme aérien", que l'on retrouve chez Rimbaud. "En
Grèce," écrit ce dernier, "vers et lyres rythment l'Action.
Après, musique et rimes sont jeux, délassements"
(p.3 du manuscrit). Le thème
était souvent abordé par les écrivains du temps. Dans
La
Bible de l'humanité (1864), par exemple, Michelet attribue à Eschyle
la double gloire d'avoir été à la fois grand poète tragique et homme
d'action : "Entre les poètes, un seul, Eschyle, eut le bonheur d'être à
la fois le chantre et le héros, d'avoir les actes et les œuvres, la
grandeur de l'homme au complet". Mais Verlaine, dans le
Prologue de ses Poèmes
saturniens (1866), ajoute d'autres noms. Il fait remarquer
qu'Homère ("Homéros" dans l'orthographe pittoresque qu'affectionnaient
les Parnassiens pour désigner les personnages de l'Antiquité),
s'il n'a pas été un combattant, n'a cessé de chanter les
louanges des héros et que ses héros, de leur côté, Hector, Ulysse,
Achille, unissaient à "l'art d'Arès" (dieu de la guerre) celui de
taquiner les Muses :
— Et sous tes cieux dorés et
clairs, Hellas antique,
De Sparte la sévère à la rieuse Attique,
Les Aèdes, Orpheus, Akaïos, étaient
Encore des héros altiers et combattaient,
Homéros, s’il n’a pas, lui, manié le glaive,
Fait retentir, clameur immense qui s’élève,
Vos échos, jamais las, vastes postérités,
D’Hektôr, et d’Odysseus, et d’Akhilleus chantés.
Les héros à leur tour, après les luttes vastes,
Pieux, sacrifiaient aux neuf Déesses chastes,
Et non moins que de l’art d’Arès furent épris
De l’Art dont une Palme immortelle est le prix [...]
Mais,
continue Verlaine, ce temps est révolu : "Aujourd’hui l’Action et le
Rêve ont brisé / Le pacte primitif par les siècles usé" et "L’Action
qu’autrefois réglait le chant des lyres", "la force, maintenant, la
Force, c’est la Bête / Féroce bondissante et folle et toujours prête / À
tout carnage, à tout dévastement, à tout / Égorgement d’un bout du monde
à l’autre bout !"
Il n'est pas besoin de faire un long commentaire :
toute l'idée de Rimbaud est déjà là. Chantres des héros et des dieux,
les "aèdes" de l'Antiquité étaient harmonieusement intégrés à la Cité
antique dont leurs vers rythmaient les cérémonies et les fêtes. Mais
cette "vie harmonieuse" n'existe plus. Les actuelles
"générations douloureuses et prises de visions" (p.3) sont payées pour
le savoir. L'action, comme disait de son
côté Baudelaire, n'est plus "la sœur du rêve" : "Certes,
je sortirai, quant à moi, satisfait / D'un monde où l'action
n'est pas la sœur
du rêve" (Le
Reniement de Saint-Pierre).
Rimbaud balaie ensuite du revers de la main toute la la
tradition poétique d'Ennius
(poète latin) à
Théroldus
(Turoldus, auteur supposé de La Chanson
de Roland), de celui-ci à
Casimir Delavigne (auteur conformiste du
temps de l'Empire et de la Restauration). Chez ces poètes, dit-il, "tout
est prose rimée, un jeu". Dans un style plus que polémique ou
pamphlétaire, il traite les générations antérieures au Romantisme de
"générations idiotes", Racine de "divin sot".
L'oxymorique
invective semble être de l'invention de Rimbaud. Rimbaud s'offre le luxe
de railler l'auteur le plus renommé de la littérature française et
surtout cette célébration officielle qui fait de lui "le pur, le fort,
le grand", "le divin poète" (cf. Victor Hugo, dans la
préface de Cromwell : "Racine, divin poëte, est élégiaque,
lyrique, épique ; Molière est dramatique"). Ceci dit, à son époque,
Rimbaud n'est pas le seul à faire preuve de mauvais esprit. Jules
Vallès, dans
L'Enfant,
chap. XXII, se moque de son ancien professeur qui criait à
ses élèves : "À genoux ! à genoux ! devant le divin Racine !". Victor
Hugo lui-même, rappelle Antoine Adam dans une note (AA, p.1075), "range
l'auteur de Phèdre parmi les poètes « bourgeois », aux côtés de Casimir
Delavigne, Ponsard et Émile Augier. Il met les vers de Pradon au-dessus de ceux de Racine"
(d'après Paul Stapfer dans
Racine et Victor Hugo, p.5.).
Le "premier venu auteur d'Origines" divise les
commentateurs rimbaldiens. Rimbaud vise-t-il un auteur particulier,
Caton le
Censeur (selon l'hypothèse de LF, JJL, JLS) ou plutôt ses
contemporains, historiens rationalistes,
Michelet,
Renan,
Quinet,
Taine,
tous auteurs d' "Origines [...]" (SB) ou, génériquement, sans qu'il soit
nécessaire d'identifier une cible précise, les auteurs insignifiants
d'ouvrages banals (AA, AG) ?
"Après Racine, le jeu moisit" : encore une formule
joliment imagée et bien frappée. Le "jeu" est celui des rimes et des
vers. Le mot suggère un exercice vain et mécanique. "Moisit" implique
l'idée de vieux, obsolète, dépassé. Notons quand même que Racine, ici,
échappe à l'invective ! Mais tout ce qui a suivi (dix-huitième et
dix-neuvième siècle romantique inclus ?) est jeté aux oubliettes.
Le mouvement des Jeunes-France (Pétrus Borel,
Gérard de
Nerval,
Théophile Gautier...) a représenté vers 1830 la branche la plus
turbulente et anti-conformiste du Romantisme. En se comparant
implicitement aux Jeunes-France, Rimbaud, d'une certaine manière, se
reconnaît des précurseurs dans la génération précédente mais, en même
temps, il se revendique différent et supérieur. Car, dit-il, c'est "la
raison" qui inspire ses "certitudes" iconoclastes et non, comme chez ses
devanciers, cette impulsion irrationnelle et excessive qu'est la
"colère".
Mais ce qu'il y a de bien (et d'amusant) chez Rimbaud,
c'est qu'il est capable d'autodérision :
l'anticonformisme radical dont je viens de
donner l'exemple, semble-t-il dire dans la dernière phrase du
paragraphe, n'est jamais qu'une revendication d'indépendance et de
renouvellement propre à la jeunesse (propre à chaque génération : "les nouveaux"),
révolte contre "les ancêtres" d'autant plus confortable que
ceux-ci ne sont plus là pour se défendre ou n'en ont plus guère le
temps ; ils appartiennent à une autre époque tandis que nous, ... "on est chez soi et on a le temps".
|
On n'a jamais bien jugé le romantisme ; qui
l'aurait jugé ? les critiques ! ! Les romantiques, qui prouvent si bien
que la chanson est si peu souvent l'œuvre, c'est-à-dire la pensée
chantée
et comprise du chanteur ?
Car Je est un autre. Si le cuivre s'éveille clairon, il
n'y a rien de sa faute. Cela m'est évident : j'assiste à l'éclosion de
ma pensée : je la regarde, je l'écoute : je lance un coup d'archet
: la symphonie fait son |
|
page 3
|
remuement dans les profondeurs, ou
vient d'un bond sur la scène.
Si les vieux imbéciles n'avaient pas trouvé du Moi que la signification
fausse, nous n'aurions pas à balayer ces millions de squelettes qui,
depuis un temps infini !, ont accumulé les produits de leur intelligence
borgnesse, en s'en clamant les auteurs !
|
|
|
|
Critique du romantisme et de la conception fausse du Moi
Le passage,
rédigé dans un style très imagé, aphoristique, sans
enchaînement logique clair, est d'une interprétation difficile. Tentons malgré tout d'en appréhender la cohérence.
Les trois petits
paragraphes paraissent avoir une unité de sens, où insistent le mot
"pensée" (utilisé deux fois) et les notions liées entre elles d'"œuvre" et d'"auteur".
Au centre, reliées à ce qui précède par un connecteur logique ("car"),
se trouve la fameuse sentence "Je est un autre" et la presque aussi
fameuse allégorie du "cuivre" qui "s'éveille clairon".
Dans le premier paragraphe, Rimbaud résume d'une
formule sa propre définition de l'"œuvre" poétique : "la pensée chantée
et comprise du chanteur". Il oppose cette conception de la poésie à
celle des romantiques qu'il désigne du mot "chanson". À vrai dire, ce
vocabulaire imagé (emprunté au domaine musical) est un peu énigmatique.
Mais nous sommes guidés dans notre interprétation par ce que nous savons
des idées de Rimbaud sur la poésie. Dans sa
lettre à Georges Izambard du
13 mai 1871, par exemple, il reproche vivement à son ancien
professeur d'être un tenant de la "poésie subjective", c'est-à-dire
d'une esthétique fondée sur la sensibilité à la mode romantique (Musset
: "Ah ! frappe-toi le cœur, c'est-là qu'est le génie"). À travers le mot
"chanson", Rimbaud entend donc probablement disqualifier une conception
superficielle du poème, simple expression mélodieuse des mouvements de
l'âme.
En opposition avec cette conception, le texte insiste,
à travers le mot "pensée", sur la nécessaire dimension réflexive,
délibérée et consciente, du travail poétique. On remarque sur le manuscrit que,
dans le syntagme "l'œuvre, c'est-à-dire la pensée chantée
et comprise du chanteur", les mots
soulignés "et comprise" ont été ajoutés après coup dans
l'interligne. Comme s'il ne suffisait pas à Rimbaud d'avoir déjà indiqué la
nécessaire
prééminence de la pensée dans le chant, il lui faut encore
préciser le caractère obligatoirement conscient de cette pensée, la
maîtrise du sujet pensant sur le contenu de son chant. "Baudelaire,
commente ici Pierre Brunel (après Gérald Schaeffer, p.158), voulait que le poète se doublât d'un
critique. Selon Rimbaud, cette conscience critique a manqué aux
romantiques" (PB, p.242, n.1).
Le paragraphe suivant confirme cette interprétation.
Continuant à filer la métaphore musicale, Rimbaud y décrit le mécanisme
de l'inspiration poétique, tel qu'il a pu l'observer sur lui-même.
L'inspiration est décrite, de façon très classique, en partie du moins,
comme l'opération à travers laquelle un matériau brut (le "cuivre") se
transforme chez un poète en un instrument de création (le "clairon"). Le
processus est parfois rapide, spontané (la "symphonie", c'est-à-dire
l'œuvre, "vient d'un bon sur la scène"), parfois nécessite une
incubation plus lente ("la symphonie fait son remuement dans les
profondeurs"). Mais ce qui s'élabore chez Rimbaud dans le processus de
l'inspiration, ce n'est pas (comme dans la conception traditionnelle)
l'expression triste ou joyeuse d'une âme, d'une
sensibilité, c'est une "pensée" : "j'assiste à l'éclosion de ma pensée :
je la regarde, je l'écoute."
Cette dernière phrase recèle, nous semble-t-il, un
paradoxe. Comme dans la conception classique de
l'inspiration, la gestation du poème se déroule apparemment sans
participation ni contrôle du poète qui n'en est que le spectateur
passif, comme par magie ou sous la seule dictée des Muses. Mais, ainsi
que nous l'avons précédemment remarqué, la notion de "pensée" ("pensée
chantée
et comprise du chanteur") implique, de la part du poète qui veut
être "auteur", une attitude réflexive qui est tout le contraire de la
passivité.
Pour comprendre ce que Rimbaud appelle "pensée",
peut-être n'est-il pas inutile de faire un détour par Baudelaire. Dans
un essai critique sur Théophile Gautier (1859) Baudelaire s'insurge
contre la tendance contemporaine à mesurer la valeur d'un
poète à l'utilité de son œuvre pour la société, à son degré d'"honnêteté",
dit Baudelaire, c'est-à-dire de
conformité à l'ordre moral. Les romantiques, notamment, sont coutumiers
de cette "erreur d'esthétique" consistant à croire que l'on fait de la
bonne littérature avec de bons sentiments. Il poursuit :
"Pendant l’époque désordonnée du
romantisme, l’époque d’ardente effusion, on faisait souvent usage de
cette formule : La poésie du cœur ! on donnait ainsi plein droit à la
passion ; on lui attribuait une sorte d’infaillibilité. Combien de
contre-sens et de sophismes peut imposer à la langue française une
erreur d’esthétique ! Le cœur contient la passion, le cœur contient le
dévouement, le crime ; l’Imagination seule contient la poésie [...] La
sensibilité de cœur n’est pas absolument favorable au travail poétique.
Une extrême sensibilité de cœur peut
même nuire, en ce cas. La
sensibilité de l’imagination est d’une autre nature ; elle sait
choisir, juger, comparer, fuir ceci, rechercher cela, rapidement,
spontanément. C’est de cette sensibilité, qui s’appelle généralement
le Goût, que nous tirons la puissance d’éviter le mal et de chercher
le bien en matière poétique." (Baudelaire, "Théophile Gautier",
1859).
Baudelaire oppose
deux formes de sensibilité, celle du cœur (les romantiques) et celle de
l'imagination (la sienne, celle qu'il préconise). Le couple
"sensibilité du cœur" versus "sensibilité de l'imagination" de Baudelaire
correspond assez étroitement au couple "chanson" versus
"pensée chantée" de Rimbaud. La supériorité de l'imagination sur le
cœur, selon Baudelaire, c'est qu'"elle sait choisir, juger, comparer, fuir ceci, rechercher
cela". Autrement dit, elle "pense". Et elle élabore une "œuvre". Elle ne se
contente pas de chanter sous la dictée de la voix intérieure. Le poète d'imagination travaille. Il se travaille ! On verra
plus loin que le principal reproche à Musset adressé par Rimbaud (après
Baudelaire) est sa
"paresse" : "Musset est
quatorze fois exécrable pour nous, générations douloureuses et prises de
visions, — que sa paresse d'ange a insultées !"
Or ce n'est que par ce travail, travail du poème,
travail sur soi, que l'auteur parvient à atteindre ce que
Rimbaud appelle l'"autre", son "autre" ("Car Je est un autre"). L'"autre", c'est
le créateur devenu conscient de la "quantité d'inconnu" qu'il porte en
lui, de cette part de sa personnalité possiblement douloureuse et
terrible qui fait de lui un "horrible travailleur". C'est ce Moi plus
mystérieux, plus profond, si différent qu'on hésite même à l'appeler
encore "Je", si méconnaissable que l'indéfini "On" conviendrait
mieux à le désigner (" C'est faux de dire : Je pense : on devrait
dire : On me pense" écrit Rimbaud dans la
lettre à Izambard du 13 mai
1871). Cet étranger que chacun est pour lui-même (la
maxime exprime une vérité générale) on ne l'atteint (si on
l'atteint) que par ce travail de connaissance de soi dont il sera
question plus loin dans le texte ("La première étude de l'homme qui veut
être poète est sa propre connaissance, entière ; il cherche son âme, il
l'inspecte, il la tente, l'apprend.
Dès qu'il la sait, il doit la cultiver
[...]"). Un travail, donc, qui, au-delà de la
connaissance de soi, débouche sur une entreprise
de construction personnelle.
On ne devient véritablement "auteur" qu'en se construisant comme auteur.
En devenant son propre auteur. Nous y reviendrons.
D'où, peut-être, aussi, cette notion morale, inattendue, de
"faute" :
"Si le cuivre s'éveille clairon, il n'y a
rien de sa faute." Certes, l'idée première est tout simplement qu'on ne devient pas
poète : on naît poète et on n'y peut rien. Idée de prédestination toute
conventionnelle. Mais on peut y lire aussi
comme une quête de pardon pour avoir accouché d'un double si peu "honnête",
au sens que Baudelaire donnait ci-dessus à ce mot, un individu marginal
("énormité" dit Rimbaud plus loin en s'appuyant sur le sens étymologique
: é-norme = hors norme) qui, parce
qu'il s'est "reconnu poète", refuse de "rouler dans la bonne ornière"
(refuse, par exemple, de continuer ses études), se fait "cyniquement entretenir" par
d'"anciens imbéciles de collège", en compagnie desquels il "s'encrapule",
ainsi qu'il le déclare par bravade à son ancien professeur dans la
lettre du 13 mai
1871,
et travaille à devenir, en tant que
"voyant", "le grand
malade, le grand criminel, le grand maudit". Voir, ici même, plus
loin. Mais n'anticipons pas
davantage sur la suite du texte.
On peut résumer tout ce qui précède d'une phrase,
empruntée à Dominique Combe (Poésies. Une saison en enfer.
Illuminations d'Arthur Rimbaud, Foliothèque n°118, 2004, p.19) :
"Rimbaud, dans ces phrases si souvent citées, ne fait que prolonger le
topos romantique de l'inspiration, à ceci près qu'il ne s'agit pas de
la voix mais de la « pensée » de l'Autre". C'est cet "à
ceci près", cette différence, que nous avons essayé surtout
d'interpréter.
|
Cigne allemand : feu G_rare : "Je suis l'autre"

Découvrant
en 1947 dans "un ouvrage récemment paru" le portrait de
Nerval reproduit ci-dessus, André Breton écrit (c'est à la
toute fin d'Ajours, texte édité à la suite d'Arcane
17) :
"Je doute que les
familiers de l'œuvre de Rimbaud découvrent sans frémissement
les mots « Je suis l'autre » précédés d'un point
d'interrogation et comme signés d'un hexagramme à point
central."
Le document ne semble avoir été
rendu public qu'en 1887, dans
L'Âge du romantisme de Maurice Tourneux, ce qui rend
invraisemblable que Rimbaud ait pu en avoir connaissance. Mais la
coïncidence, indice d'un "air du temps", est intéressante à analyser.
Les inscriptions
que l'on peut lire autour de ce portrait de Nerval (Cigne allemand : feu G_rare :
"Je suis
l'autre") sont autographes. Gérard les a tracées en
juin 1854, au moment où il prenait connaissance de sa
biographie
par Eugène de Mirecourt, qui venait de paraître. Le volume était
illustré, en frontispice, d'une gravure d'Eugène Gervais d'après un
daguerréotype d’Adolphe Legros. Le
poète, apprend-on dans une note de l'édition de la pléiade
(Nerval, Œuvres, I, Poésie, 1974, p.1578) "s'est fait
représenter par Gervais dans la pose de la
statue de Laurent
de Médicis sur le tombeau de Florence (dû au ciseau de
Michel-Ange)". Les signes
cabalistiques, le petit dessin en haut à droite représentant
un oiseau en cage, ont fait couler beaucoup d'encre. Mais
certains aspects du document se passent fort bien pour être
compris de références compliquées aux traditions
occultistes (comme celles alléguées par O. Encrenaz et J.
Richer dans Vivante étoile : Michel-Ange, Gérard de Nerval, André
Breton, Archives des lettres modernes, n°127, 1971). Il suffit pour cela de parcourir la
correspondance de Nerval correspondant à cet épisode.
Dans une lettre à George Bell du 31 mai 1854, adressée
de Strasbourg où il se trouve, revenant d'une longue
pérégrination à travers l'Allemagne, Nerval écrit :
"La maladie m'avait
rendu si laid, — la mélancolie si négligent. Dites donc, je
tremble ici de rencontrer aux étalages un certain portrait
pour lequel on m'a fait poser lorsque j'étais malade, sous
prétexte de biographie nécrologique" (ibid. p.1143).
Nerval est en effet souvent
malade et en proie à des crises de folie de plus en plus
rapprochées (nous sommes
quelques mois à peine avant son suicide, le 26 janvier 1855). Et il se plaint volontiers dans
ces années-là de voir paraître sur son compte, émanant de
ses meilleurs amis (Dumas,
notamment), des portraits littéraires élogieux,
certes, mais ayant tendance à parler de lui au passé. D'où
l'ironie sur le caractère "nécrologique" de l'ouvrage que
vient de lui consacrer Mirecourt, trait d'humour noir que
véhicule également la formule "feu G_rare" inscrite au
dessus de la gravure (feu = défunt, le défunt Gérard).
Nerval craint l'image
défavorable que pourrait donner de lui la gravure de Gervais.
En même temps, il sait très bien qu'en réalité "on" ne l'a
pas fait poser, que c'est lui qui a posé et choisi la
pose, que Gervais, par ailleurs, comme il le dit un peu plus
loin dans la lettre, "est un talent, plus sérieux que Nadar"
mais qui, comme ce dernier, "fait trop vrai !" (ibid.). En
bref, il craint un portrait trop ressemblant. Il exprime la
même appréhension en ce qui concerne le texte de Mirecourt : "Et
cette biographie elle-même, comment est-elle ? Suis-je
éreinté ? suis-je flatté ?" (ibid.). Nerval aurait dû par
conséquent être satisfait quand il put se rendre compte que
Mirecourt, comme Gervais, l'avaient "peint en beau" (ibid.
p.1145). Pas si simple ! Pas si simple !
"Remerciez bien
Mirecourt, écrit Nerval à son ami Sartorius le 30 juin 1854
[...]. Le portrait n'est pas mal ; remerciez M. Gervais qui
est un charmant homme. J'avais l'agrément à Strasbourg
d'être connu de tout le monde — en voilà un signalement "
(ibid. p. 1164).
Nerval a donc eu le plaisir (l'
"agrément") de constater que, grâce à son portrait,
il bénéficiait auprès des Strasbourgeois d'un
"signalement" flatteur. Rien ne pouvait lui plaire
autant que ce signalement en "cigne allemand" .
Autrement dit : en poète romantique. La faute d'orthographe
intentionnelle du mot "cigne" souligne l'équivoque entre
l'idée de "signe" (= signalement) et celle de "cygne"
(hiéroglyphe traditionnel du Poète. Cf. "le Cygne de
Saint-Point", surnom de Lamartine). Mais ce "G_rare"
est-il le vrai Gérard ? N'est-il pas un Gérard par trop
"rare" ? : "cette chose peut me faire beaucoup d'ennemis, il y
a de quoi me faire blaguer aussi plus que de raison" (ibid.
p.1664). Remarque qui explique peut-être le commentaire
en forme d'aveu :
"Je suis l'autre". "Dites partout que c'est mon
portrait ressemblant mais posthume, écrit-il encore, de
façon amusante, à George Bell, — ou bien encore que Mercure
avait pris les traits des Sosie et posé à ma place" (ibid.
p. 1143). Ce n'est donc pas Gérard que nous voyons dans ce
portrait mais un dieu de l'Olympe prenant la pose d'un
prince florentin. Ou plutôt, c'est une image de lui
poétiquement transfigurée, comme le sont, ailleurs, dans son
œuvre, ses autres identités d'élection comme "le prince
d'Aquitaine à la tour abolie" de son poème
El Desdichado.
Une lettre envoyée au docteur Labrunie (son père) le 12 juin 1854 offre une
autre exégèse de cette anecdote :
"Il a paru depuis
mon départ une biographie dont on t'aura parlé peut-être. Je
l'ai vue à Strasbourg, on m'y traite de héros de roman et
c'est plein d'exagérations bienveillantes sans doute et
d'inexactitudes qui m'importent fort peu du reste, puisqu'il
s'agit d'un personnage conventionnel... On ne peut empêcher
les gens de parler, et c'est ainsi que s'écrit l'histoire,
ce qui prouve que j'ai bien fait de mettre à part ma vie
poétique et ma vie réelle." (ibid. p.1151).
Nerval eut-il véritablement ce pouvoir de "mettre à part [sa] vie
poétique et [sa] vie réelle", comme il essaie d'en rassurer
son géniteur ? Il est plutôt célèbre pour avoir pratiqué ce
qu'il appelle dans Aurélia "l'épanchement du songe dans
la vie réelle" (ibid. p.163). Mais on voit bien que dans sa
correspondance privée, de façon rationaliste, au risque de dépouiller le thème de l'altérité de
cette aura de mystère qui inspire coutumièrement à la critique
de vertigineuses interprétations,
il
réduit la dissociation du moi à l'idée plus classique du "personnage",
de l'avatar poétique ou romanesque, du portrait "peint en beau" pour la postérité. Il présente l'Autre comme une identité seconde destinée au
public, voire confectionnée par ce public lui-même ("On ne peut
empêcher les gens de parler"). Le vrai moi est ailleurs que dans
ce "personnage conventionnel". Mais la chose est-elle
si claire dans son esprit ? Lequel est
le plus vrai du prince d'Aquitaine ou de Gérard Labrunie ?
Rimbaud, quand à lui, semble inverser la démarche. Le vrai moi, pour
Rimbaud, c'est l'Autre : celui qui
"remue[...] dans les profondeurs, ou vient d'un bond sur la
scène [du poème]". Du moins pour le Rimbaud du 15 mai 1871.
Celui d'Une
saison en enfer, par contre, semblera davantage prêt à déposer toutes
ses défroques, celle du "mage" et de l'"ange" comme celle de
"l'Époux infernal", celle du voyant comme celle du voyou, et à
les dénoncer comme autant de "mensonges".
À consulter en ligne :
Jean-Nicolas Illouz,
« Nerval et Baudelaire devant Nadar »
|
Quant à la
formule elle-même "Je est un autre", sa nouveauté (qui a
contribué, sans doute, à sa notoriété) vient du télescopage entre la première
personne du pronom sujet et la troisième personne du verbe, qui fait
sentir par la syntaxe l'idée de fracture contenue dans les mots. Mais l'idée, par
elle-même, n'est pas neuve. On trouve chez Nerval l'expression "Je suis
l'autre" (inscription autographe sous un portrait), chez Hugo, dans
L'homme qui rit (II-5) , une phrase comme :
"C'était bien à lui-même qu'on parlait, mais lui-même était autre" (on
verra d'ailleurs plus loin que Gwynplaine, le héros mutilé de ce roman,
sert d'exemple à Rimbaud pour figurer le devenir-monstre que
signifie pour lui "se faire voyant"). Rimbaud, qui fréquentait
à l'époque le professeur de philosophie de Charleville Léon Deverrière, pourrait aussi l'avoir rencontrée, nous apprend Dominique Combe (ibid. p.19-20),
dans une note de l'ouvrage
récent d'Hyppolite Taine, De l'intelligence (1870), intitulée : "Sur les
éléments et la formation de l'idée du Moi".
|
NOTE SUR LES
ÉLÉMENTS
ET LA FORMATION DE L’IDÉE DU MOI
La "note" (en fait
une sorte d'annexe en fin de volume)
commence par la phrase suivante : "Sous le nom de névropathie cérébro-cardiaque, le docteur Krishaber décrit une maladie dans
laquelle on voit très-bien comment se fait et se défait l’idée
du moi." Quelques paragraphes plus loin, le texte évoque le cas
d'un patient qui a perdu le souvenir de son ancien moi. Pour
figurer la scission du moi intervenue chez cet individu, Taine
utilise une comparaison avec la métamorphose de la chenille en
papillon qui n'est pas sans rappeler la fable rimbaldienne du
cuivre et du clairon :
"On ne peut
mieux comparer l’état du patient qu’à celui d’une chenille qui,
gardant toutes ses idées et tous ses souvenirs de chenille,
deviendrait tout d’un coup papillon avec les sens et les
sensations d’un papillon. Entre l’état ancien et l’état nouveau,
entre le premier moi, celui de la chenille, et le second moi,
celui du papillon, il y a scission profonde, rupture complète.
Les sensations nouvelles ne trouvent plus de série antérieure où
elles puissent s’emboîter ; le malade ne peut plus les
interpréter, s’en servir ; il ne les reconnaît plus, elles sont
pour lui des inconnues. De là deux conclusions étranges, la
première, qui consiste à dire : Je ne suis pas ; la seconde, un
peu ultérieure, qui consiste à dire : Je suis un autre."
Hyppolite Taine, De
l'intelligence, tome II, p.465-466.
En ligne sur
Gallica et sur
Wikisource.
|
Les "vieux imbéciles",
poursuit Rimbaud dans le troisième paragraphe, n'ayant
"trouvé du Moi que la signification fausse"
des "millions de squelettes" encombrent l'histoire de la littérature.
"Depuis un temps infini" (ici, apparemment, les poètes romantiques ne
sont pas les seuls visés) ils "ont accumulé les produits de leur
intelligence borgnesse, en s'en clamant les auteurs !" La critique
semble double : borgnes, ils n'ont vu les choses qu'à moitié, ils
n'ont trouvé que des demi-vérités ;
inconscients, ils se proclament les auteurs de produits intellectuels
qui en fait ne leur appartiennent pas en propre, sont le fruit de
l'imitation consciente ou inconsciente, du conformisme, de la
reproduction à l'infini des mêmes erreurs et des mêmes idées reçues.
Quelle est donc cette "signification fausse du Moi" ?
"Celle qui repose sur le principe d'identité" glose Pierre Brunel (PB
p.242, n.3) : le Moi est un, il est invariable et il est transparent à
lui-même. Arcboutés sur ce principe faussement évident, de superficiels
poètes ignoreront toujours la part mystérieuse de leur être et du monde.
Ils se proclameront "auteurs" alors qu'ils ne font que "ramasser", poursuit Rimbaud dans le paragraphe suivant, les idées "jetées" par
"l'intelligence universelle". Rimbaud flétrit ces "fonctionnaires" de la littérature qui se
contentent de "renouveler" des "antiquités", de s'approprier les
"fruits" d'autres "cerveaux" que le leur, et affirme (on
n'est pas très modeste quand on a dix-sept ans) que jusqu'ici (jusqu'à lui ?), un véritable "auteur,
créateur, poète, cet homme n'a jamais existé !"
Mais il semble qu'à cette hauteur du texte, Rimbaud ait
décidé d'abandonner provisoirement sa cible romantique. Poursuivant
cette sorte d'histoire de la poésie qui sert de fil directeur et de
soubassement à son discours théorique, il administre au passage un
coup de griffe aux poètes parnassiens.
|
En Grèce, ai-je dit, vers et lyres rhythment
l'Action. Après, musique et rimes sont jeux, délassements. L'étude de ce
passé charme les curieux : plusieurs s'éjouissent à renouveler ces antiquités :
− c'est pour eux.
L'intelligence universelle a toujours jeté ses idées, naturellement ;
les hommes ramassaient une partie de ces fruits du cerveau : on agissait
par, on en écrivait des livres : telle allait la marche, l'homme ne se
travaillant pas, n'étant pas encore éveillé, ou pas encore dans la plénitude
du grand songe. Des fonctionnaires, des écrivains : auteur, créateur, poète,
cet homme n'a jamais existé !
|
|
|
|
Critique
des Parnassiens
Après les
romantiques, les Parnassiens. L'évocation de la poétique parnassienne
dans la lettre du 15 mai 1871 est toujours sur le mode du "oui ...
mais...". La célébration de l'harmonie entre le Rêve et l'Action,
l'artiste et la cité, aux origines grecques de la poésie, était,
nous l'avons vu, un poncif du Parnasse (cf. le "Prologue" des Poèmes
saturniens de Verlaine, qui devait d'ailleurs beaucoup, sur ce point,
à la
Préface des
Poèmes Antiques de Leconte de Lisle). Rimbaud
commence ici par rappeler cet âge d'or. Mais c'est pour tout de suite
ajouter que, si "plusieurs s'éjouissent à renouveler ces antiquités :
−
c'est pour eux." Autrement dit, il leur abandonne (dédaigneusement)
cette variété suspecte d'inspiration poétique. Il ne partage pas, quant à lui, ce goût
de l'Antiquité et surtout ce plaisir vain pris à ressusciter le passé.
Le même rejet sera répété plus loin lorsque Rimbaud
abordera le bilan nominatif de ce qu'il appelle les "seconds
romantiques" : "Les seconds romantiques sont très voyants, Th. Gautier, Lec. de Lisle, Th. de Banville.
Mais inspecter l'invisible et entendre l'inouï étant
autre chose que reprendre l'esprit des choses mortes, Baudelaire est le
premier voyant, roi des poètes, un vrai Dieu."
Banville et
Leconte
de Lisle qui sont, parmi les auteurs de la liste, ceux qui ont le plus
passionnément cultivé l'inspiration mythologique et le goût de
l'Antiquité, sont certes cités comme des auteurs "très voyants" mais ils
sont implicitement accusés de "reprendre l'esprit des choses mortes" et
d'être très inférieurs en cela à Baudelaire. Un peu plus loin aussi,
dans le texte, la formule
"Cette langue sera de l'âme pour l'âme" peut être prise pour une pointe
contre la doctrine de "l'Art pour l'Art", donc contre
Théophile Gautier.
Les "cent hexamètres mythologiques" de
Credo in unam (l'expression est de Rimbaud lui-même dans la
lettre à Banville du 15 août 1871), sont apparemment bien oubliés ! Ou
bien seraient-ils reniés ? Rimbaud a-t-il lu entre temps le pamphlet de
Baudelaire contre "l'école païenne" ? Ce n'est pas impossible :
"Qui nous délivrera des Grecs et des Romains ? [...] Au point de vue
purement littéraire, ce n'est pas autre chose qu'un pastiche inutile et
dégoûtant [...] Le goût immodéré de la forme pousse à des désordres
monstrueux et inconnus [...] Absorbées par la passion féroce du beau, du
drôle, du joli, du pittoresque, car il y a des degrés, les notions du
juste et du vrai disparaissent. La passion frénétique de l'art est un
chancre qui dévore le reste." (Baudelaire, "L'école païenne", 1853)
Nous ne revenons pas sur la fin du
paragraphe, qui a été commentée plus haut. |
La première étude
de l'homme qui veut être poète est sa propre connaissance, entière ; il
cherche son âme, il l'inspecte, il la tente, l'apprend. Dès qu'il la
sait, il doit la cultiver ; Cela semble simple : en
tout cerveau s'accomplit un développement naturel ; tant d'égoïstes se |
|
page 4
|
proclament auteurs ; il en
est bien d'autres qui s'attribuent leur progrès intellectuel !
— Mais il s'agit de faire l'âme monstrueuse : à
l'instar des comprachicos, quoi ! Imaginez un homme s'implantant et se
cultivant des verrues sur le visage.
Je dis qu'il faut être voyant, se faire
voyant.
Le Poète se fait voyant par un long,
immense et raisonné dérèglement de tous les sens. Toutes les formes
d'amour, de souffrance, de folie ; il cherche lui-même, il épuise en lui
tous les poisons, pour n'en garder que les quintessences. Ineffable
torture où il a besoin de toute la foi, de toute la force surhumaine, où
il devient entre tous le grand malade, le grand criminel, le grand
maudit,
— et le suprême Savant !
— Car il
arrive à l'inconnu ! Puisqu'il a cultivé son âme, déjà riche, plus
qu'aucun ! Il arrive à l'inconnu, et quand, affolé, il finirait par
perdre l'intelligence de ses visions, il les a vues ! Qu'il crève dans
son bondissement par les choses inouïes et
innommables : viendront d'autres horribles travailleurs ; ils
commenceront par les horizons où l'autre s'est affaissé !
— la suite à six minutes
— |
|
|
|
Le poète voyant,
du mythe littéraire au projet
personnel.
Avec ces trois paragraphes (qui achèvent la
première partie du texte, avant la coupure de Mes petites amoureuses)
on arrive au noyau principal du discours, l'exposé de l'entreprise
du voyant. Ce n'est pas un hasard si la postérité a baptisé cette
lettre "lettre du voyant". Le mot revient neuf fois dans le
texte, notamment dans
la phrase qui lui sert de conclusion :
"Voilà.
— Ainsi je travaille à me rendre
voyant.
—"
Le second des paragraphes concernés est une simple
phrase, soigneusement isolée et mise en valeur par le dispositif
typographique : elle contient deux fois le mot clé et résume assez bien
les deux aspects de la question : Être / Se faire.
- "Je dis qu'il faut être voyant, [...]" : "être voyant" ?
qu'est-ce à dire ? appelons cela : le mythe romantique du voyant,
- "[...] se faire voyant" : c'est l'idée que ce qu'une tradition
spiritualiste décrit volontiers comme un don est en réalité le
résultat d'un "faire" et d'un "se faire", l'enjeu d'un travail, le fruit
d'une méthode, que l'auteur a décidé d'adopter comme projet personnel.
Le "voyant" de Rimbaud doit beaucoup à l'imagerie
romantique. Il fait montre d'une "force surhumaine". Par son ascèse de
pensée, "il arrive à l'inconnu", terme qui, au moins chez Hugo, est doté
d'une évidente signification religieuse :
Oh ! vous êtes les seuls pontifes,
Penseurs, lutteurs des grands espoirs,
Dompteurs des fauves hippogriffes,
Cavaliers des pégases noirs !
Âmes devant Dieu toutes nues,
Voyant des choses inconnues,
Vous savez la religion !
(Les
Mages, dans Les Contemplations)
"Le voyant" parvient à "la plénitude du grand songe"
ce qu'on peut comprendre sur un mode mystique comme une sorte d'extase
contemplative ou sur un mode plus politique, à la Hugo, comme le "grand
espoir" d'une société plus juste, d'une humanité libérée de ses
servitudes et réconciliée. Il pénètre par les "correspondances" les
secrets de la nature ("parfums, sons,
couleurs"). Il est le "suprême
savant" parce qu'il sait interpréter les symboles "que seul le voyant
peut saisir". L'expression vient du portrait de Baudelaire par
Théophile Gautier qui sert de préface à l'édition
de 1868 des Fleurs du mal :
"Baudelaire, bien qu’on l’ait souvent
accusé de matérialisme, reproche que la sottise ne manque pas de
jeter au talent, est, au contraire, doué à un degré éminent du don
de spiritualité, comme dirait Swedenborg. Il possède aussi le don de
correspondance, pour employer le même idiome mystique, c’est-à-dire
qu’il sait découvrir par une intuition secrète des rapports
invisibles à d’autres et rapprocher ainsi, par des analogies
inattendues que seul le voyant peut saisir, les objets les plus
éloignés et les plus opposés en apparence. Tout vrai poëte est doué de cette qualité plus ou moins
développée, qui est l’essence même de son art."
On verra dans la page suivante (après la
coupure de Mes petites amoureuses) que Rimbaud, contrairement à
Gautier, ne considère pas le qualificatif "matérialiste" comme une
injure : "Cet avenir sera matérialiste, vous le voyez". Cependant sa
conception du poète, penseur, prophète et mage laïque, "chargé de
l'humanité, des animaux même", doit beaucoup à l'image du "voyant"
diffusée par le spiritualisme romantique.
Un autre héritage manifeste du romantisme réside dans
l'assimilation de la vocation poétique à une révolte métaphysique,
prométhéenne ou luciférienne. Mais Rimbaud articule cette mythologie
apprise avec cette sorte de discours de la méthode qui semble lui être
beaucoup plus personnel : le développement des facultés créatrices
par l'approfondissement de la connaissance de soi : "La
première étude de l'homme qui veut être poète est sa propre
connaissance, entière ; il cherche son âme, il l'inspecte, il la tente,
l'apprend. Dès qu'il la sait, il doit la cultiver [...]". Le verbe
"tenter" est particulièrement intéressant. Il rappelle la notion morale
de "tentation". Le grand tentateur, on le sait, c'est Satan, "le plus
savant et le plus beau des Anges", selon Baudelaire (Les
Litanies de Satan). Le poète, donc, cherchant son âme, n'hésite
pas à la pousser dans ses derniers retranchements (comme le fait
Méphistophélès avec le docteur Faust : encore un mythe à la mode chez
les romantiques) et il doit être prêt à la connaître "entière"
c'est-à-dire jusque dans ses replis les plus sombres, et à la
reconnaître, à l'avouer, souvent même, chez Rimbaud, à la revendiquer
dans ce qu'elle a de plus démoniaque (cf., entre autres, le prologue
sans titre d'Une saison en enfer ou le chapitre L'Époux
infernal).
Pour imager sa théorie, Rimbaud puise dans le roman de
Victor Hugo L'Homme qui rit l'exemple des "comprachicos".
Gwynplaine, le héros de ce roman, a été enlevé tout jeune par les "comprachicos"
(les voleurs d'enfants) qui lui ont fendu la bouche de manière à
afficher sur son visage un éternel sourire (voir
son portrait en II-2-1). Ainsi balafré, il est
produit dans les foires comme un monstre et devient une sorte de symbole
du clown tragique, représentation traditionnelle de l'artiste maudit.
Mais, allant sur ce point plus loin que Hugo dans le symbole, Rimbaud
suggère au poète de s'infliger volontairement, lui-même, au plan moral, la
défiguration infligée par les comprachicos à Gwynplaine : "il s'agit de
faire l'âme monstrueuse : à l'instar des comprachicos, quoi !" Et
il ajoute, pour le cas où son destinataire n'aurait pas suffisamment
senti l'horreur de la suggestion : "Imaginez un homme s'implantant et se
cultivant des verrues sur le visage."
Gérald Schaeffer, qui a consacré une étude très détaillée aux lettres
"du voyant" en 1975 explique ce qu'il y a de profondément transgressif
d'un point de vue chrétien dans un tel développement en citant ce
jugement de Hugo sur les comprachicos : "Les vivisecteurs de ces
temps-là réussissaient très bien à effacer de la face humaine l'effigie
divine" (GS p.162). Rappelons-nous aussi à ce propos cette parole de
l'Époux infernal dans Une saison en enfer : "Un homme qui veut se
mutiler est bien damné, n'est-ce pas ?"
Toute la méthode qu'envisage Rimbaud pour accéder à une
connaissance complète de son "âme" et parvenir à débusquer "l'autre"
qu'il a en lui est marquée par ce jeu dangereux avec la transgression
des codes de la morale et des limites humaines : "Dérèglement -
souffrance - folie - poison, écrit Schaeffer : le vocabulaire s'oriente
visiblement vers l'excès (et le mot amour prend lui aussi une coloration
nocturne) propre à faire sortir l'individu des normes, pour lui donner
accès à l'univers secret des visions. Le prix à payer est la maladie, la
folie, la mort — spirituelle ou physique" (GS p.164-165) : "Qu'il
crève dans son bondissement par les choses inouïes et innommables : viendront d'autres horribles travailleurs ; ils
commenceront par les horizons où l'autre s'est affaissé !"
On ignore ce que Rimbaud avait lu de Baudelaire.
N'aurait-il connu que Les Fleurs du Mal qu'il y eût déjà
probablement trouvé un matériau suffisant pour élaborer son "immense et
raisonné dérèglement de tous les sens". Les excitants qu'énumère le poème
Le Poison (le vin, l'opium et l'amour) ont la propriété de
générer des visions fantastiques (le vin fait surgir "plus d'un portique
fabuleux / Dans l'or de sa vapeur rouge, / Comme un soleil couchant dans
un ciel nébuleux), de dérégler les notions normales de l'espace et du
temps ("L'opium agrandit ce qui n'a pas de bornes, / Allonge
l'illimité, / Approfondit le temps, creuse la volupté"). Mais "Tout cela
ne vaut pas le poison qui découle" des "yeux verts" de l'aimée.
Il est
cependant assez probable que, malgré ses à peine seize ans et demi en
mai 1871, Rimbaud avait lu tout ou partie des nombreux essais consacrés
par le "vrai Dieu" aux "paradis artificiels" (Le Vin, Le Hachisch,
Le Poème du Hachisch, Le Mangeur d'opium). Baudelaire y analyse, avec
force détails, "l'hallucination ou plutôt la méprise des sens dans
l'état mental occasionné par le hachisch". Il y montre que dans cette
expérience, l'hallucination est "presque volontaire et ne devient
parfaite que par l'action de l'imagination". Autrement dit,
l'augmentation prodigieuse des facultés perceptives que permet l'usage
des stupéfiants, voie d'accès à l'Inconnu, ne donne son plein résultat
que si l'individu possède par lui-même une "âme déjà riche" et "a
cultivé" la puissance imaginative dont son "cerveau" est naturellement
doué (ce qui est le cas depuis longtemps en ce qui concerne Rimbaud :
rappelons-nous comment il se décrit enfant : "Gisant
au pied d'un mur, enterré dans la marne /
Et pour des visions écrasant son œil darne", dans Les Poètes de sept
ans). Par ailleurs, qui dit processus "volontaire" signifie
dérèglement "raisonné". C'est bien d'une méthode qu'il s'agit. "Nous
t'affirmons, méthode !" clament les Assassins (Hachischins) de
Matinée d'ivresse (dans Les Illuminations). Cette idée de
l'ivresse comme adjuvant à la fécondité littéraire, Rimbaud aurait pu la
trouver aussi, dans l'essai de Baudelaire sur
Edgar Poe, sa
vie, ses œuvres (1856) :
"Il existe dans l'ivresse
non seulement des enchaînements de rêves, mais des séries de
raisonnements qui ont besoin, pour se reproduire, du milieu qui leur
a donné naissance (...). Je crois que, dans beaucoup de cas, (...)
l'ivrognerie de Poe était un moyen mnémonique, une méthode de
travail, méthode énergique et mortelle, mais appropriée à sa nature
passionnée. Le poète a appris à boire, comme un littérateur soigneux
s'exerce à faire des cahiers de notes." (Charles Baudelaire, Edgar Poe, sa
vie, ses œuvres, III).
Le "long, immense et raisonné
dérèglement de tous les sens" de Rimbaud a beaucoup à voir,
convenons-en, avec la "méthode énergique et mortelle" mentionnée dans
l'extrait ci-dessus. Comme, en outre, cette méthode est "mortelle" — on
peut en "crever" dit plus crument Rimbaud, en devenir fou
("affolé") aussi — il convient d'en "raisonner" au maximum la pratique
(autre sens possible du mot) et, en tout cas, quand on tente d'"épuiser"
les vertus des poisons, de ne pas s'y abandonner aveuglément, de "n'en
garder que les quintessences", c'est-à-dire ce qui est utile à la
création poétique.
Remarquons pour terminer que Rimbaud n'emploie pas ici
le mot "hallucination", ni le mot "rêve". C'est, semble-t-il,
ultérieurement, qu'il élargira la palette des méthodes possibles pour
parvenir de façon artificielle au dérèglement des perceptions
sensorielles. Le petit traité de l'hallucination volontaire contenu dans Alchimie du verbe (l'"hallucination
simple" prolongée par l'"hallucination des mots") ne fait guère mention des "poisons" (même si les
"sommeils de plusieurs jours" mentionnés par le récit y font penser).
Par contre, il y est question de rêves continués, et d'une pratique de
l'illusion visuelle (habituelle, dit Rimbaud : "Je
m'habituai à l'hallucination simple")
qui semble relever davantage de l'exercice lucide que de l'absorption
d'alcools ou de la prise de stupéfiants. Dans sa poésie, c'est surtout à
partir de 1872, avec des pièces comme Larme, Michel et
Christine, Mémoire ou les proses des Déserts de l'amour que Rimbaud commencera à mettre en scène
la transformation à vue de certains paysages à la faveur
d'épisodes oniriques ou hallucinatoires qui préfigurent les exemples ultérieurement
donnés dans Alchimie du verbe (et, bien sûr, plus
systématiquement encore, dans Les Illuminations). Mais l'idée de
l'expérience visionnaire guidée par une pratique raisonnée était déjà
présente sur un plan théorique dans la lettre du 15 mai 1871. Quel rôle
réel ont pu jouer ces différentes sortes de "méthodes"
dans le travail créateur de Rimbaud, c'est difficile à savoir. La part
respective de l'expérience réellement vécue et de l'affabulation littéraire, en ces
matières, est impossible à évaluer.
|
pages 5 et 6
|
|
Ici, j'intercale un second psaume, hors du texte : veuillez tendre une
oreille complaisante,
— et tout le monde sera charmé.
— J'ai l'archet en
main, je commence :
Voilà. Et remarquez bien que, si je ne
craignais de vous faire débourser plus de 60 c. de port,
—
moi pauvre effaré qui, depuis sept mois, n'ai
pas tenu un seul rond de bronze !
— je vous livrerais encore mes
Amants de Paris, cent hexamètres, Monsieur, et ma Mort de Paris, deux cents hexamètres
!
— Je reprends :
|
|
|
|
Intermède ?Au moment d'"intercaler" son second
"psaume", Rimbaud prend soin de souligner que ce nouvel échantillon de
sa production récente est offert au lecteur "hors du texte".
André Guyaux a vu dans cette indication une confirmation de ce que les
poèmes inclus dans la lettre "sont bien, non pas l'illustration des
idées exposées, mais des intermèdes, qui tendent à divertir le lecteur,
à lui offrir une récréation poétique destinée à la distraire de l'aride
continuité de la longue dissertation. Décalés par rapport à la théorie
du voyant, ils relèvent d'une autre esthétique, qui semble même
anachronique. Composant sa lettre à partir d'un texte déjà rédigé,
Rimbaud en a sacrifié la continuité pour introduire la principale de ces
insertions [...]". En effet, l'observation de la graphie de ces poèmes
et de certaines caractéristiques des feuillets qui les contiennent
tend à montrer qu'ils ont été ajoutés après coup. Ainsi, la phrase "Donc le poète est vraiment voleur de feu", située en tête du feuillet 7 du
manuscrit, sans retrait par rapport à la marge, après les feuillets 5 et 6 consacrés à Mes Petites
amoureuses, était sans doute primitivement la suite immédiate et
directe de la phrase qui termine le feuillet 4 :
"ils commenceront par les horizons ou l'autre s'est affaissé !" Cf. André Guyaux, op. cit. 2001, p.63-64 et Pléiade 2009, p.991.
Sans contester cette seconde partie du raisonnement, on
peut légitimement contester la première. Contre Rimbaud lui-même et ses
précautions oratoires ("j'intercale un second psaume, hors du texte")
il est possible de se demander si les poèmes du texte ne sont pas au
contraire un excellent exemple de ce devenir voyant fondé sur l'encrapulement
dont Rimbaud parle à Georges Izambard, de cet "autre" qu'il découvre en
lui en cette année 1871, ce Rimbaud-Mister Hyde prêt à "casser les
hanches" de ses petites amoureuses pour les punir de les avoir
aimées. C'est l'hypothèse que défend notamment Jean-Luc Steinmetz, en
attribuant cette métamorphose du poète à l'amère expérience contée par,
ou transposée dans, Le Cœur supplicié. On peut ne pas être
entièrement d'accord avec son analyse de ce dernier texte mais on enregistre avec intérêt et
"reconnaissance" son aveu d'une évolution personnelle sur cette question
:
"Le Cœur du pitre et les trois poèmes de l'autre « lettre du
voyant » illustrent, en fin de compte, ce programme évidemment motivé
par la circonstance. Je ne les avais pas compris comme tels, tout
d'abord, et je les considérai surtout comme distincts de la voyance.
Vraisemblablement la voyance de Rimbaud (le mot — faut-il le
rappeler — n'apparaît pas sous sa plume) n'est pas embellissante. Elle
suivrait plutôt le chemin d'un certain Baudelaire. De là, ce travail de
dérision systématique perceptible dans Mes petites amoureuses et
Accroupissements : le retournement, l'inversion des grandes amoureuses
et de la prière qui élève. Le principe de l'encrapulement, parallèlement
à des actes contestant le bon ordre et la bonne pensée, s'introduit dans
le texte et programme une mise à bas méditée (travaillée) du milieu
social, de l'image qui en est donnée, plus encore que du poète lui-même"
(op. cit. 2008).
L'invitation
rimbaldienne à lire Mes petites amoureuses "hors du texte"
est donc finalement assez suspecte. Maurice Hénaud (op.cit. 2016)
l'analyse comme un exemple de cette sorte de dénégation valant pour un
aveu inconscient qu'observe Sigmund Freud chez ses
patients, dans
La Négation (1925). Rimbaud, d'ailleurs, ne
trahit-il pas sa véritable pensée quand il décide de lancer son poème
par le même "coup d'archet" qui, ci-dessus, a permis à "Je" de prendre
conscience qu'il est "un autre" : "je
lance un coup d'archet : la symphonie fait son remuement dans les profondeurs, ou
vient d'un bond sur la scène"? N'est-ce pas, en effet, un "autre" de
Rimbaud, le double sadique (ou sadien) du charmant poète de Roman,
Rêvé pou l'hiver ou Ma Bohême, qui saute tout à trac sur
le théâtre du Moi, à l'appel du violon, en entonnant Mes petites
amoureuses ?
Avant de sonner la fin de l'entracte par un "Je
reprends", Rimbaud informe son correspondant (et nous, lecteurs, par la même
occasion, car ce sont des textes dont on a perdu toute trace) qu'il a
composé d'autres longs poèmes autour du sujet de Paris, la ville qui l'attire comme un
aimant ("mes Amants de Paris, cent hexamètres, Monsieur, et ma
Mort de Paris, deux cents hexamètres !), poèmes qu'il ne lui envoie pas afin qu'il n'ait pas à acquitter
d'excessifs frais de port (car Rimbaud n'affranchissait jamais son
courrier et laissait le soin à ses correspondants de payer la surtaxe). |
page 7
|
Donc le poète est vraiment voleur de feu. Il est chargé de l'humanité, des
animaux même ; il devra faire sentir,
palper, écouter ses inventions ; si ce qu'il rapporte de là-bas a forme,
il donne forme : si c'est informe, il donne de l'informe. Trouver une
langue ;
— Du reste, toute parole étant idée, le temps d'un langage universel
viendra ! Il faut être académicien,
— plus mort qu'un fossile, — pour
parfaire un dictionnaire, de quelque langue que ce soit. Des faibles se
mettraient à penser sur la première lettre de l'alphabet, qui pourraient
vite ruer dans la folie !
—
Cette langue sera de l'âme pour l'âme, résumant tout, parfums, sons,
couleurs, de la pensée accrochant la pensée et tirant. Le poète définirait
la quantité d'inconnu s'éveillant en son temps dans l'âme universelle :
il donnerait plus
— que la formule de sa pensée, que la notation
de sa
marche au Progrès ! Énormité devenant norme, absorbée par tous, il
serait vraiment un multiplicateur de progrès !
Cet avenir sera matérialiste, vous le voyez
— Toujours pleins du Nombre
et de l'Harmonie, ces poèmes seront faits pour rester.
— Au fond, ce
serait encore un peu la Poésie grecque. L'art éternel aurait ses
fonctions ; comme les poètes sont citoyens. La Poésie ne rythmera plus
l'action ; elle sera en avant. |
|
|
|
Du "langage universel" et de la fonction du Poète
C'est la question de la communication qui donne son
unité à la partie du texte que nous abordons maintenant.
"Donc le poète est vraiment voleur de feu. Il est chargé de l'humanité, des
animaux même [...]". Le "voleur de feu", dans la
mythologie antique, c'est le titan Prométhée. Comme nous y engage Gérald Schaeffer dans son commentaire, il
faut prendre au sérieux la référence à ce mythe (Izambard,
rapporte Schaeffer, a dit avoir longuement étudié le
Prométhée enchaîné d'Eschyle avec
Rimbaud, GS. p.168, n.38). Le poète étant parvenu à l'Inconnu n'en est
encore qu'à mi-chemin de son travail car il lui reste à trouver le moyen
de communiquer aux hommes, à l'humanité entière, ce qu'il a trouvé
"là-bas". En cela, il est comparable à Prométhée, car c'est pour les
hommes que Prométhée a dérobé le feu aux dieux et c'est "pour avoir
trop aimé les hommes" qu'il a été puni par eux. D'où aussi, la dimension
politique et sociale que prend la réflexion sur la langue, on le verra,
dans ce passage. On limite trop souvent la référence prométhéenne à son
versant métaphysique, parmi les commentateurs de Rimbaud.
|
LE MYTHE DE PROMÉTHÉE
CHEZ ESCHYLE
"Le Prométhée d'Eschyle
a donné le feu aux hommes, c'est-à-dire le langage, l'art et la
technique :
« J'inventai aussi pour eux la plus belle de toutes les
sciences, celle du nombre, et l'assemblage des lettres, qui
conserve le souvenir de toutes choses et favorise la culture
et les arts. Le premier aussi j'accouplai les animaux et les
asservis au joug et au bât. »
Ces inventions lui ont
valu le châtiment qui justifie sa révolte :
« À parler franc, je hais tous les dieux, qui, obligés par
moi, m'en payent par un traitement inique.
Hermès — J'entends : tu délires et tu es gravement
malade.
— Malade ! oui, si c'est être malade, que de haïr ses
ennemis. »"
(GS, p.168)
|
Le poète voleur de feu, dit Rimbaud, est "chargé de
l'humanité, des animaux même " : "à la manière encore de Prométhée,
commente Schaeffer, à la façon aussi du poète selon Hugo, prophète d'un
animisme universel" (GS. p.170). D'où le problème de la communication :
"il devra faire sentir, palper, écouter ses inventions ; si ce qu'il
rapporte de là-bas a forme, il donne forme : si c'est informe, il
donne de l'informe." L'idée semble être la suivante : de ses incursions
dans l'"Inconnu" ("là-bas"), ou dans son propre "Inconnu" (son
"autre"), le poète
ramène des "inventions" (des trouvailles : "inventer" au sens de "trouver",
mais ce sont aussi ses inventions de poète, bien sûr) qu'il doit pouvoir
communiquer dans un langage qui parle aux sens du lecteur ("palper"
et "écouter" ne sont en fait que des variétés du "sentir") et en restant
au plus près de sa pensée : si elle est désordonnée, incohérente
("informe"), tant pis. L'important est que l'expression colle à
l'expérience visionnaire vécue.
La phrase suivante, si on observe bien la ponctuation
utilisée par Rimbaud, va en fait de "Trouver une langue ; [...]" jusqu'à
"[...] de la pensée accrochant la pensée et tirant." En effet, Rimbaud a
placé un simple point-virgule après "langue" et tout ce qui suit, placé
entre deux tirets, n'est qu'une longue incidente : une parenthèse
savante. Nous proposons donc de lire d'abord la
phrase de base :
"Trouver une langue ; [...]
Cette langue sera de l'âme pour l'âme, résumant tout, parfums, sons,
couleurs, de la pensée accrochant la pensée et tirant."
Dans quelle langue notre nouveau
Prométhée transmettra-t-il à l'humanité les secrets qu'il a volés aux
dieux ? Rimbaud reprend en la précisant l'idée de la phrase
précédente selon laquelle la mission fixée au poète était
de "faire sentir". De transmettre, donc, cette "pensée chantée
et comprise
du chanteur" évoquée plus haut dans le texte, qui n'est ni seulement
sensations, ni seulement idées, mais les unes et les autres étroitement
mêlées, car idée et sensation ne sont qu'une seule et même chose. D'où les formules
binaires suggérant une communication directe entre auteur et lecteur,
"directe" c'est-à-dire sans l'intermédiaire sinon des mots du
moins du pauvre langage ordinaire : "de l'âme
pour l'âme", "de la pensée accrochant la pensée". D'où aussi, le dessein
d'une langue poétique apte à faire la synthèse des sensations ("résumant
tout, parfums, sons couleurs") qui n'est pas sans rappeler les "correspondances"
baudelairiennes.
|
LES CORRESPONDANCES
CHEZ BAUDELAIRE
Correspondances est un célèbre sonnet de Baudelaire. Le
poème montre comment, dans la nature, "les parfums, les
couleurs et les sons se répondent". Les vers 9-10 donnent
l'exemple de correspondances entre "parfums" et sensations
tactiles (« frais comme des chairs d’enfant »), auditives (« doux comme les hautbois ») et visuelles (« verts comme les
prairies »). Ces liens secrets suggèrent l'unité profonde du
cosmos, que Baudelaire dote d'une vie propre et assimile à un
regard divin posé sur l'humanité : "La Nature est un temple
où de vivants piliers / Laissent parfois sortir de confuses
paroles ; / L’homme y passe à travers des forêts de
symboles / Qui l’observent avec des regards familiers." La
tradition critique, pour désigner ces deux sortes de
correspondances, parle volontiers de correspondances
horizontales (sensorielles) et verticales (métaphysiques).
Ci-dessous, deux extraits des œuvres en prose de Baudelaire
où le poète définit de façon plus théorique que dans le
sonnet ces diverses sortes de correspondance :
Extrait de
Richard Wagner et Tannhäuser à Paris,
1861 :
"Ce qui serait vraiment surprenant c'est que le son ne
pût pas suggérer la couleur, que les couleurs ne pussent pas donner l'idée
d'une mélodie, et que le son et la couleur fussent impropres à traduire
les idées ; les choses s'étant toujours exprimées par une analogie
réciproque, depuis le jour où Dieu a proféré le monde comme une complexe et indivisible totalité."
Extrait des
Notes
nouvelles sur Edgar Poe, 1857 :
"C'est cet admirable, cet immortel instinct du Beau qui nous fait
considérer la Terre et ses spectacles comme un aperçu, comme une
correspondance du ciel. La soif insatiable de tout ce qui est au-delà,
et que révèle la vie, est la preuve la plus évidente de notre
immortalité. C'est à la fois par la poésie et à travers la poésie, par
et à travers la musique que l'âme entrevoit les splendeurs situées
derrière le tombeau."
|
Attelons-nous maintenant à la parenthèse philosophique
insérée par Rimbaud au milieu de la phrase précédente :
"
— Du reste, toute parole étant idée, le temps d'un langage universel
viendra ! Il faut être académicien,
— plus mort qu'un fossile, — pour
parfaire un dictionnaire, de quelque langue que ce soit. Des faibles se
mettraient à penser sur la première lettre de l'alphabet, qui pourraient
vite se ruer dans la folie !
— "
L'affirmation initiale
est assez comique dans sa désinvolture. Elle est tout à fait dans le
registre péremptoirement prophétique qui est celui de toute la lettre.
Rimbaud a l'air de dire que "du reste", d'ailleurs, trouver cette langue
ne sera pas bien difficile puisque, d'une façon ou d'une autre, on peut
être certain qu'elle adviendra.
Olivier Bivort
(op.cit. 2004 et 2005) a signalé que le premier membre de phrase :
"toute parole étant idée" (toute parole étant d'abord idée)
pouvait passer pour un bon condensé de la théorie des "grammaires
générales" (dites aussi "idéologiques") posant que le langage n'est que
l'expression de la pensée et que tout discours, quelque assemblage de
sons dont il puisse être composé, en quelque langue particulière qu'il
ait été proféré, peut être réduit à l'enchaînement des idées
présentes dans l'esprit de celui qui a parlé. D'où la notion d'une
"grammaire générale", c'est-à-dire, selon L'Encyclopédie de
Diderot (article
"Grammaire", 1757), d'"une science raisonnée des principes immuables et
généraux de la parole prononcée ou écrite dans toutes les langues". La
fameuse
Grammaire nationale des frères Bescherelle que possédait
la famille Rimbaud et sur laquelle on a retrouvé diverses inscriptions du
capitaine et de son fils, s'inscrivait encore, nous apprend Olivier Bivort,
dans cette tradition. C'est sur le tronc rationaliste des frères
Bescherelle que Rimbaud ente le greffon farfelu de son discours
utopique. Non sans logique : de
cet en-deçà des mots que sont les
idées, sorte de grammaire commune à toute l'espèce humaine, il
n'était pas absurde d'imaginer que sortirait un jour un "langage
universel".
Il ne serait pas étonnant que Rimbaud ait connu aussi,
sur ce sujet, les théories des Saint-Simoniens.
Rimbaud, certes, n'a pas pu lire le
Livre nouveau des Saint-Simoniens, ouvrage réunissant les
productions doctrinales et littéraires de la communauté de Ménilmontant
pendant les années 1832-1833. Destinées à constituer une sorte de
bible nouvelle, elles n'ont pu être éditées de leur temps et se sont
conservées jusqu'à nos jours à l'état de manuscrits, sauf quelques rares
exceptions. Mais il est possible que Rimbaud ait eu accès à cette
tradition utopique par un biais ou par un autre, à travers les multiples
articles et brochures que disciples et sous-disciples multiplièrent tout
au long du XIXe siècle.
Dans son article "Le
problème du langage dans Le Livre Nouveau des Saint-simoniens",
Jean-Michel Gouvard montre la place éminente accordée au projet d'une
langue universelle destinée à surmonter la dispersion des langues
humaines (la malédiction de Babel). Dans le texte de la "Deuxième
séance" rédigé par
Prosper Enfantin, on peut lire : "Au-dessus de ces langues
spéciales dominera la langue générale, accord de la voix du monde et de
la voix de l’humanité, poésie des poésies ; telle sera la langue
SACERDOTALE, RELIGIEUSE, DIVINE." Cette idée d'une langue "générale"
n'est pas nouvelle, explique Gouvard. C'est "une
projection de l’archilangue postulée par les grammairiens, héritiers du
mouvement amorcé par Arnauld et Lancelot en plein cœur du 17e siècle".
Pour les Saint-simoniens comme pour ces grammairiens "la langue la plus
proche
de cet
idéal était le français". Mais
: "Alors que les
grammairiens construisaient une archilangue de la pensée qui aurait
préexisté aux langues humaines, les pensionnaires de Ménilmontant ont
rêvé d’une archilangue qui succéderait aux langues humaines, et c’est
sans doute dans ce rêve que leur théorie du langage acquiert
définitivement sa singularité".
D'où, naturellement, chez Rimbaud, le mépris pour les faiseurs de
dictionnaires "de quelque langue que ce soit". Appliqués à inventorier
une langue particulière, ils consacrent leur énergie à un outil dépassé.
Appliqués à fixer l'usage de la langue, ils se font les gendarmes de ce
genre de dérèglements linguistiques auquel le voyant a recours, pour
mieux être fidèle à tout ce qu'il peut y avoir d"informe" dans ce qu'il ramène de
"là-bas" ("les sauts d'harmonie inouïs", "les trouvailles et les termes
non soupçonnés", évoqués dans le
poème des Illuminations titré Solde).
Mépris aussi pour ceux qui rêvent sur les lettres de
l'alphabet : "Des faibles se mettraient à penser sur la première lettre
de l'alphabet, qui pourraient vite ruer dans la folie !" Étonnant de la
part du futur auteur de Voyelles ? Non ! Tout au contraire !
Sans doute faut-il comprendre
que, conformément aux leçons de la "Grammaire générale", les assemblages
de sons (ou, à l'écrit, de lettres) qui composent les langues
particulières sont arbitraires et, pour cette raison (tout autant que
les mots et les règles des dictionnaires) indignes de l'attention du
voyant. Sauf, naturellement, si c'est pour "invent[er] la couleur des
voyelles" et "régl[er] la forme et le mouvement de chaque consonne" (Alchimie du verbe), opérations qui contribuent à doter
les lettres de l'alphabet d'un lien direct avec leur signification et à
annuler leur caractère arbitraire, conformément à l'utopie de
Cratyle dans le dialogue de Platon. Le
cratylisme,
explique la rubrique ad hoc de Wikipedia, "établit un rapport constant
et absolu entre un son et une signification, postulant la possibilité
d'une langue universelle, donnée une fois pour toutes". Rimbaud songerait
donc à la
possibilité de créer par la poésie dans l'avenir une langue dont les
lettres et les mots auraient un rapport de nécessité avec les sensations
(et avec la "pensée" avec lesquelles, sans doute, dans son
esprit, elles ne font qu'un).
Le propos est-il tout à fait sérieux ? Rimbaud y
croit-il vraiment ? Le plus vraisemblable, c'est qu'il
y croit sans y croire comme un qui se situe très consciemment sur le
terrain du mythe. Le mythe transpose la réalité (pour l'expliquer), il ne lui tourne pas le
dos. Prise comme mythe, la théorie d'un langage universel "résumant
tout, parfums, sons, couleurs" dit la vérité :
elle dit que le poète parle autrement que tout le monde, qu'il use
différemment des moyens syntaxiques et du matériel sémantique pour
susciter métaphores et synesthésies, qu'il joue avec les mots et
leurs sonorités (qu'il "dérègle" les sens des mots aussi bien que ceux
des organes sensoriels), qu'il nomme le monde de façon neuve dans une langue
s'écartant radicalement de "l'universel reportage" (expression par
laquelle Mallarmé désigne la langue outil de communication). Mais, pris
à la lettre, le mythe paraît mensonge, le mythe devient
mystification.
Ce renversement, Rimbaud l'opère
d'ailleurs lui-même, contre lui-même, en 1873, dans Une saison en
enfer. Situant dans le
passé ce qu'il mettait au futur dans la lettre à Demeny, troquant la
posture prométhéenne des lettres de 1871 pour celle d'un Icare "rendu au
sol" (Adieu), délaissant le rôle du voyant pour celui du poète vaincu et
désenchanté, il écrit dans Alchimie du verbe :
"je me flattai d'inventer un
verbe poétique accessible, un jour ou l'autre, à tous les sens. Je
réservais la traduction."
Il se
remémore le projet présomptueux ("je me flattai") énoncé dans la lettre, en le reformulant de façon
satirique : l'indication temporelle des plus vagues "un jour ou
l'autre" laisse à penser que, pour le prophète lui-même, la réalisation
de sa prophétie était loin d'être assurée. Finalement, c'est la
possibilité même d'un langage universel qui se trouve niée. Car le but,
on s'en souvient, était de "trouver une langue" qui soit "de l'âme pour
l'âme, [...] de la pensée accrochant la pensée et tirant", une forme de
langage assurant moins une communication qu'une communion immédiate et
universelle, au-delà de l'arbitraire des mots et de la particularité des
langues, sans qu'on ait besoin de dictionnaires ... et encore moins de
"traductions".
S'agissant d'une langue qui se flatte de s'adresser aux sens
mais dont on ne sait pas très bien quand elle leur sera "accessible", il
serait pourtant souhaitable, en attendant, que le poète offre une
traduction. Mais il préfère la "réserver". Nous ne croyons pas,
comme Hermann H. Wetzel (op.cit. 2015, p.54), que Rimbaud veuille dire
ici qu'il "économise" la traduction, cette langue "universelle" ne
nécessitant pas d'être traduite. Nous pensons plutôt que le simple fait
d'évoquer une traduction possible (bien qu'on la tienne en réserve
et qu'on se garde bien de la donner) au sujet d'une langue supposée être
universelle, ne peut être qu'une moquerie. Le Rimbaud d'Alchimie du
verbe n'est plus le même que celui de la lettre à Demeny, ou du moins
sa perspective, sa posture, n'est plus la même.
"L'âme pour l'âme" est une probable allusion parodique
au slogan de "l'art pour l'art". "L'art pour l'art" est
le principe opposé par Théophile Gautier à celui de "l'art pour le
progrès", étendard du romantisme social, dans la préface de Mademoiselle de Maupin
(1834). Les Parnassiens se réclamaient généralement de "l'art pour
l'art". Rimbaud, sur ce point, recueillerait plutôt l'héritage de
Victor Hugo. Il n'est peut-être pas impossible d'interpréter dans le
même sens l'énigmatique formule : "la pensée accrochant la pensée et
tirant". La pensée, suggère Rimbaud, n'est pas indépendante de
l'acte de langage, ni véritablement antérieure à lui. Ce sont les mots
qui "accrochent" la pensée et la "tirent". Pour Rimbaud, comme pour
Mallarmé dans
Divagations, "la disparition élocutoire du poëte [...] cède l'initiative
aux mots, par leur inégalité mobilisés". Le langage
poétique étant destiné à être "de l'âme pour l'âme", il aurait le
pouvoir
d'"accrocher la pensée", celle du poète lui-même en premier
lieu, celle de son lecteur ensuite, et de la "tirer" (de l'accoucher, de
l'exprimer). Le voyant "tire" à lui celui qui l'écoute, il
l'attire à ses propres convictions (c'est une des façons possibles
d'interpréter le participe présent "et tirant") : il l'entraîne, le fait
progresser, le tire "en avant". Rien de plus conforme à sa vocation
prométhéenne. Une telle conception fait du "voyant" le type même du mage progressiste à
la Victor Hugo.
|
VICTOR HUGO
______
FONCTION DU POÈTE (EXTRAIT)
Dieu le veut, dans les temps contraires,
Chacun travaille et chacun sert.
Malheur à qui dit à ses frères :
Je retourne dans le désert !
Malheur à qui prend ses sandales
Quand les haines et les scandales
Tourmentent le peuple agité !
Honte au penseur qui se mutile
Et s’en va, chanteur inutile,
Par la porte de la cité !
Le poëte en des jours
impies
Vient préparer des jours meilleurs.
Il est l’homme des utopies,
Les pieds ici, les yeux ailleurs.
C’est lui qui sur toutes les têtes,
En tout temps, pareil aux prophètes,
Dans sa main, où tout peut tenir,
Doit, qu’on l’insulte ou qu’on le loue,
Comme une torche qu’il secoue,
Faire flamboyer l’avenir !
Victor Hugo,
Fonction du poëte,
Les Rayons et les Ombres
|
Dans la lettre du 15 mai 1871, Rimbaud offre de l'Inconnu une définition ouvertement
collective et sociale. Les deux points qui relient "Le poète
définirait la quantité d'inconnu s'éveillant en son temps dans l'âme
universelle" à "il donnerait plus — que la formule de sa pensée, que la notation
de sa
marche au Progrès !" font incontestablement de la deuxième partie de
la phrase le développement de la première. L'"éveil" en question est
donc essentiellement celui des idées nouvelles apparaissant dans les
domaines de la science, de la technique, des mœurs et de la politique. Tout ce qu'il
était convenu, à l'époque de Rimbaud, d'appeler la "marche au Progrès".
Mais Rimbaud ne confond pas le poète avec un militant. Le poète donne "plus
— que la [simple] notation de sa marche au Progrès". En tant qu'artiste,
il apporte une dimension supplémentaire. "Énormité devant norme" dès
lors que sa pensée est "absorbée par tous", son engagement génère un effet
"multiplicateur" (souligné). On peut voir dans ces mots
la revendication par Rimbaud d'une fonction spécifique du poète dans le
combat politique (voir l'encadré ci-dessous). Il reste que, dans une société somnolente
qui, contrairement à la cité grecque de l'antiquité (l'auteur revient
ici sur cette thématique déjà traitée en début de texte), a rompu l'harmonie
entre le rythme et l'action (c'est-à-dire entre la poésie et la
politique), le poète, le maître du rythme, se doit d'être "en avant". Il est amusant de noter
que, sur le manuscrit — dans la phrase "Le poète définirait la quantité
d'inconnu s'éveillant en son temps dans l'âme universelle" —
"s'éveillant" surcharge "dormant", biffé. Rimbaud a sans doute jugé plus
honnête de reconnaître que quelque chose s'était tout de même "éveillé" dans la France de la Commune, sans attendre "la poésie de
l'avenir".
|
UN DIALOGUE AVEC
VERMERSCH ET PROUDHON ?
Maciej Zurowski a déniché dans Le Père Duchêne (n°31 du
16 avril 1871) un article où
Eugène Vermersch, à l'occasion de "la nomination du citoyen
Courbet comme inspecteur des Musées et organisateur des
Beaux-Arts", polémique contre Proudhon au sujet de la place de
l'artiste dans la révolution. Nous sommes, faut-il le rappeler,
au zénith du mouvement communaliste, au moment où Mac-Mahon
bombarde puis occupe les forts, bien avant la semaine sanglante.
Un moment où Rimbaud aurait pu, éventuellement, effectuer un
bref séjour à Paris et lire ce numéro du Père Duchêne. Mais
cette "troisième fugue parisienne" n'est pas du tout prouvée et
il n'est pas impossible que ce soit à Charleville que
Rimbaud ait pris connaissance de l'article de Vermersch.
Après s'être félicité que la Commune s'occupe des
musées, Vermersch réclame la totale liberté en art et, pour
l'artiste, la possibilité pratique de "se produire" :
"Seulement — il y a un « seulement » — pour que tout marche
bien, pour qu'on voie juste, pour qu'on voie vrai, il faut
que chacun puisse se produire ;
Que les artistes donnent la formule de leur pensée, la notation de
leurs aspirations vers le progrès !
Toute œuvre d'art, par cela même qu'elle est une œuvre d'art, est
morale, et le bon bougre Proudhon s'est absolument foutu
dedans quand il a dit : que l'art devait avoir pour but de
moraliser les patriotes !
Ce n'est pas vrai !
Si vous voulez faire un traité de morale, ne faites pas un tableau,
mais une déclaration des droits de l'homme.
Une œuvre d'art est morale quand elle est bien faite ;
Car si elle est bien faite, elle sert la morale, soit par
l'horreur, soit par la sympathie qu'elle excite,
Et il n'y a pas d'autre chose à faire !"
op. cit. p.138
La lettre du voyant utilise des formules bien proches de celles
de Vermersch ("Que les artistes donnent la formule de leur
pensée, la notation de leurs aspirations vers le progrès !").
Rimbaud, apparemment, a lu ce texte, applaudit à la philippique
de Vermersch contre Proudhon et renchérit, même, sur Vermersch :
le poète, à son point de vue, "donnerait
plus — que la formule de sa pensée, que la notation
de sa
marche au Progrès !" Rimbaud souligne "marche". Sans
doute parce que c'est le mot qu'il ajoute aux formulations de
Vermersch. C'est pourtant un bien banal cliché dont il se
moquera bientôt dans l'Album zutique ("L'humanité
chaussait le vaste enfant progrès"), mais il a dû penser que le
terme apportait un "plus", une allure plus dynamique, à la
phrase de Vermersch.
|
À partir de la question de la langue Rimbaud
réintroduit donc ici la dimension politique de la critique de la "poésie
subjective", du lyrisme personnel, qui s'exprimait peut-être de façon
plus claire dans la lettre à Izambard du 13 mai 1871, à travers le concept de "poésie
objective". Ce principe d'objectivité, si on le comprend comme
l'injonction faite à la "poésie de l'avenir" d'assumer la réalité
objective, la réalité extérieure, est peut-être remplacée ici
par le mot "matérialiste" : "Cet
avenir sera matérialiste, vous le voyez."
|
page 8
|
Ces poètes seront ! Quand sera brisé
l'infini servage de la femme, quand elle vivra pour elle et par elle,
l'homme, jusqu'ici abominable,
— lui
ayant donné son renvoi, elle sera poète, elle aussi ! La femme trouvera
de l'inconnu ! Ses mondes d'idées différeront-ils des nôtres ?
— Elle
trouvera des choses étranges, insondables, repoussantes, délicieuses ;
nous les prendrons, nous les comprendrons.
|
|
|
|
Le "féminisme" ambigu de Rimbaud
Liant la
question de "l'avenir de la poésie" à celle du progrès social, Rimbaud se devait d'aborder
le thème de la femme et des rapports entre les sexes. Le
développement qu'il y consacre dans la lettre "du voyant" est
des plus brefs, mais sa radicalité quasi-féministe et sa proximité paradoxale
avec l'un de ses plus violents pamphlets anti-féminins, Mes petites
amoureuses, ont fait couler beaucoup d'encre.
Dans son article de la revue Europe intitulé
"Les poètes et la femme dans la lettre du voyant", Christine Planté
fait ressortir "la dénonciation sans ambiguïté de l'asservissement de la
femme" et la hardiesse de "l'affirmation qu'elle vivra pour elle (ce qui
implique que sa vie ne trouve son sens ni sa fin dans l'amour et le
dévouement à la famille), et par elle (ce qui suppose son indépendance
économique et juridique." Rimbaud, ajoute-t-elle, "rompt là non
seulement avec la morale dominante et l'ordre instauré par le code
napoléonien qui fait de la femme, selon l'expression consacrée, une
éternelle mineure, mais avec la plupart des argumentations féministes de
son temps qui justifient par la fonction maternelle et le rôle familial
toute demande de droits nouveaux pour la femme" (op.cit. 2009, p.65).
"Quand sera brisé l'infini servage de la femme, dit
encore Rimbaud, [...] elle sera poète, elle aussi. La femme trouvera de
l'inconnu". Et, suprême éloge dans sa bouche, "elle trouvera
des choses [...] repoussantes, délicieuses". Rien qui séduise
davantage l'auteur d'Accroupissements, remarque Gérald Schaeffer
(p.180), que cette
dialectique du "délicieux" et du "repoussant", du trivial et du traditionnel
(voir notamment le dernier
couplet de ce troisième poème de la lettre). S'interrogeant sur les
sources possibles de telles idées, Schaeffer cite Michelet, dans
son introduction de La Sorcière : "La
femme s'ingénie, imagine : elle enfante des songes et des dieux. Elle
est voyante à certains jours ; elle a l'aide infinie du désir et du
rêve" (ibid. p.180). Autre possible réminiscence,
celle du passage de
La Femme (1860) où Michelet attire l'attention sur "une chose,
trop peu observée, et qui rend la communion des idées délicieuse
avec la femme. C'est qu'elle les reçoit par des sens qui ne sont pas du
tout les nôtres, et nous les envoie sous des formes très charmantes et
très émouvantes que nous n'aurions pas attendues ? » (cité par
Christine Planté, p.66-67).
Rimbaud, qui se souvient certainement de cette remarque de Michelet, se
pose la question : "Ses
mondes d'idées diffèreront-ils des nôtres ?".
Mais il reste quelque chose de fort ambigu
dans le "féminisme" rimbaldien, c'est que tout cet éloge de la femme est
situé dans un futur indéterminé. Pour ce qui est du présent, la
soumission avilie dans laquelle se trouvent les femmes par rapport aux
hommes, notamment dans l'institution du mariage, semble rendre cette
"aveugle irréveillée" (Les Première Communions) impropre même à
se révolter. "On est frappé de l'absence de tout nom de femme poète dans
cette lettre qui abonde en noms propres" écrit Christine Planté (p.69).
"Du travail du poète multiplicateur de progrès qui permet à ce futur
d'advenir, la femme est exclue" (ibid. p.64). C'est que pour
Rimbaud, comme pour Michelet, "elles subissent leur sort, sont esclaves,
— esclaves grasses et florissantes", "la femme ne vit pas sans l'homme",
"elle veut s'associer et dépendre" (citations de La Femme par
Chrisitine Planté, ibid.). C'est exactement le sens de l'insulte que
Rimbaud adresse à ses "petites amoureuses" : "— Vous crèverez en Dieu,
bâtées / D'ignobles soins !"
D'où l'idée paradoxale du nécessaire "renvoi" de la femme :
"l'homme, — jusqu'ici abominable, — lui ayant donné son renvoi, elle
sera poète". Idée paradoxale au sein d'un manifeste féministe mais compréhensible, dans l'optique
éminemment ambiguë (sinon
phallocentrique) qui est celle de Rimbaud. Jugeant la femme incapable d'être sujet de sa propre
émancipation, il prescrit à l'homme de l'émanciper malgré elle, car
c'est seulement en la "renvoyant" qu'il cessera d'être "abominable".
Le poème Mes petites amoureuses illustre-t-il la façon dont
le jeune poète entend appliquer dans sa propre vie les rigueurs de cette
théorie ? "Renvoi" plus clair, en tout cas, on trouvera difficilement.
|
LA
QUESTION DES FEMMES
CHEZ LES SOCIALISTES UTOPIQUES DU PREMIER XIXe SIÈCLE
Les idées sur les femmes
exposées par Rimbaud dans sa lettre du 15 mai 1871 ne sont pas
originales dans son siècle. Un théoricien pré-socialiste comme
Fourier, par exemple, dénonçait l'institution du mariage dans
des termes voisins de ceux qu'emploie Rimbaud dans Mes
petites amoureuses, Vierge folle ou Conte.
"Oui, la prostitution plus ou
moins gazée [...] voilà le sort auquel réduit [les femmes]
l’esclavage conjugal de la civilisation"
Exactement comme Rimbaud, Fourier
prophétise une future émancipation glorieuse de la Femme :
"je suis fondé à dire que la femme, en état de liberté,
surpassera l'homme dans toutes les fonctions d'esprit ou de
corps qui ne sont pas l'attribut de la force physique"
Et il fait de la condition des femmes
le critère par excellence du niveau de développement atteint par
une société :
"les
progrès sociaux et changements de période s’opèrent en
raison du progrès des femmes vers la liberté
[...]"
Citations tirées de la Théorie
des quatre mouvements. cf. in Google Books,
édition de 1846, respectivement 150, 149 et 132. Le dernier
de ces passages servira d'épigraphe à
L'émancipation de la femme ou Le Testament de la Paria,
de Flora Tristan (1846).
L'ambiguïté que nous
avons cru pouvoir relever dans le "féminisme" de la lettre dite
"du voyant" consonne elle-même étrangement avec le très
contradictoire culte de la Femme théorisé en leur temps par les
Saint-Simoniens. Cette autre branche de l'utopisme des années
1830 plaçait au centre de sa doctrine l'attente de la
Femme-Messie, dont la venue était nécessaire pour régénérer et
pacifier la société déchirée par la guerre et le conflit des
classes sociales. Mais, curieusement, au moment même où le
groupe des Saint-Simoniens proclamait ce culte et s'installait
pour vivre en communauté dans une grande maison de Ménilmontant,
son "Père" spirituel, Prosper Enfantin, érigeait en principe le
célibat des hommes et excluait de la secte ("renvoyait" pour le
dire comme Rimbaud) toutes les femmes qui jusque-là y avaient
participé. Officiellement, les personnes de sexe féminin étaient
considérées comme trop aliénées, trop opprimées et infantilisées
par la société, pour pouvoir participer à la grande aventure
(plus prosaïquement, leur présence, au milieu des quarante mâles
de la retraite de Ménilmontant, risquait d'être trop
perturbatrice).
Sur cet intéressant
arrière-plan historique, lire dans
Le Livre Nouveau des Saint-Simoniens
(Du Lérot, 1991), le chapitre de l'introduction de Philippe
Régnier intitulé "Le roman de la Famille et la mystique de la
Femme" (p.32-43).
|
|
En attendant, demandons aux
poètes du
nouveau,
— idées et formes. Tous
les habiles croiraient bientôt avoir satisfait à cette demande.
— Ce
n'est pas cela !
Les premiers romantiques ont été
voyants sans trop bien s'en rendre compte : la culture de leurs âmes s'est
commencée aux accidents : locomotives abandonnées, mais brûlantes, que
prennent quelque temps les rails.
— Lamartine est quelquefois voyant, mais étranglé par la forme
vieille.
— Hugo, trop cabochard, a bien du Vu dans les derniers volumes :
Les Misérables sont un vrai poème. J'ai Les Châtiments sous la main ;
Stella donne à peu près la mesure de la vue de Hugo. Trop de Belmontet
et de Lamennais, de Jéhovahs et de colonnes, vieilles énormités crevées. |
|
page 9
|
Musset est quatorze fois exécrable pour
nous, générations douloureuses et prises de visions,
— que sa paresse d'ange a insultées ! O ! les
contes et les proverbes fadasses ! O les nuits ! O Rolla, ô Namouna, ô
la Coupe ! Tout est français, c'est-à-dire haïssable au suprême degré
; français, pas parisien ! Encore une œuvre de cet odieux génie qui a
inspiré Rabelais, Voltaire, Jean lafontaine ! commenté par M. Taine !
Printanier, l'esprit
Musset ! Charmant, son amour ! En voilà, de la peinture à l'émail, de
la poésie solide ! On savourera longtemps la poésie française, mais en
France. Tout garçon épicier est en mesure de débobiner une apostrophe Rollaque, tout séminariste en porte les cinq cents rimes dans le secret
d'un carnet. A quinze ans, ces élans de passion mettent les jeunes en rut
; à seize ans, ils se contentent déjà de les réciter avec cœur ; à
dix-huit ans, à dix-sept même, tout collégien qui a le moyen, fait le Rolla, écrit un Rolla ! Quelques-uns en meurent peut-être encore. Musset
n'a rien su
faire : il avait des visions derrière la gaze des rideaux : il a fermé
les yeux. Français, panadif, traîné de l'estaminet au pupitre de collège,
le beau mort est mort, et, désormais, ne nous donnons même plus la peine
de le réveiller par nos abominations !
|
|
|
|
Bilan nominatif des "premiers romantiques"
Le petit paragraphe
qui sert de transition ne manque pas d'un humour peut-être involontaire
: "En attendant, écrit Rimbaud, demandons aux poètes du nouveau [...]".
Cet "en attedant" paraît avouer que la réalisation des prophéties qui précèdent
(l'émancipation des femmes, l'émergence d'un langage universel...) n'est
pas pour demain et qu'on aura plus tôt fait de renouveler les "idées" et
les "formes" dans le domaine de la poésie. Cependant, il ajoute
immédiatement qu'il ne demande pas ce genre de renouvellement que
proposent "les habiles". Et les critiques qu'il adresse
ensuite aux plus grands poètes romantiques tendent à les ranger dans
cette catégories des "habiles".
Il se permet ainsi de blâmer
Lamartine ("étranglé par la forme vieille"), Hugo ("trop de
Belmontet et de
Lamennais, de Jéhovahs et de
colonnes", autrement dit des idées politiques et religieuses
surannées), Baudelaire même : "la forme si vantée en lui est
mesquine". Et il conclut son jugement sur Baudelaire par ce coup
de griffe qui est spécialement destiné à l'auteur du Voyage : "les inventions d'inconnu
réclament des formes nouvelles". Cette critique de la "forme vieille"
est constante dans la lettre. Plus loin, il la reproche aussi à "la
nouvelle école, dite parnassienne" : "rompue aux formes vieilles". Si on en juge par ce que Rimbaud écrivait à l'époque, ce
n'est pas tant ce que nous appelons "les formes poétiques"
qu'il conteste (les divers modes d'organisation en
strophes, les formes fixes) que les règles encore appliquées par les
romantiques et par Baudelaire dans l'organisation interne du vers, la
césure, la rime (voir les inscriptions en marge de ses propres poèmes de
la lettre : "quelles rimes, o ! quelles rimes !") et, plus encore, les
normes de "correction" dans le registre et le niveau de langue.
En ce domaine, voir les libertés inédites que s'accorde Rimbaud dans ces
mêmes poèmes. Voir les emprunts ludiques aux vocabulaires techniques
("hydrolat lacrymal"), trivial ("culs-nus", "vous crèverez en Dieu") ou
prosaïques ("bandoline"). Les suggestions scatologiques
("accroupissements" divers et variés) et répugnantes ("bave", "j'ai
dégueulé", "salives desséchées", "haillons de crasse", "sales ventres",
"peau moite", "Aux contours du cul des bavures de lumière" ...). Les
formes laides ou qui devraient l'être comme l'audacieux
lambdacisme
(Gradus, p. 101) en "la-la-la (-al)" du premier vers de Mes petites
amoureuses, et autres fantaisies verbales (jeux paronymiques :
"héros/Eros", "tropes/troupes" ; étymologiques : "cillement aqueduc") ... le chef d'œuvre du
genre étant probablement le poème que Rimbaud adressera bientôt à
Banville (le 15 août 1871) : Ce qu'on dit au poète à propos de
fleurs.
Rimbaud reconnaît
malgré tout que les premiers romantiques "ont été voyants sans trop bien s'en rendre compte". On retrouve
là l'exigence déjà exprimée plus haut (et analysée par nous) de la "pensée
chantée et comprise du chanteur". Mais Rimbaud précise un peu
davantage : "la culture de leurs âmes s'est commencée aux accidents".
Sans doute pense-t-il aux accidents de la vie : il crédite ces poètes
d'avoir atteint quelque profondeur dans la plongée
en eux-mêmes quand les accidents de la vie les a bousculés (il ne donne
pas d'exemples mais on pense aux déboires politiques de Hugo et à son
choix de l'exil, aux deuils : la mort d'un proche chez Lamartine ou chez
Hugo, etc.). D'où la métaphore des locomotives "que prennent quelque
temps les rails" : ces poètes n'avancent que quand les circonstances de
la vie les "prennent", les conduisent. Sinon, ils stagnent dans la
rhétorique, ce ne sont que des "écrivains", comme il disait plus haut,
des "fonctionnaires" de l'écriture. Bien qu'il apprécie chez
Victor
Hugo la vigueur de la polémique et le prophétisme progressiste ("j'ai
les Châtiments sous main") il ne semble admirer
Stella que dans une certaine "mesure" ("Stella donne à peu près
la mesure de la vue de Hugo") : trop de religiosité et de références
bibliques mêlées au messianisme populiste, probablement. Cependant, Les
Misérables, le grand roman social, lui semble "un vrai poème" où Hugo
"a bien du vu".
|
TROP DE ... COLONNES
"Trop
de
Belmontet
et de
Lammenais, de Jéhovahs et de colonnes, vieilles énormités crevées".
Trop de "colonnes", c'est-à-dire, sans doute,
trop de poèmes consacrés par Victor Hugo à la
Colonne Vendôme. Il s'agit là, comme on va le voir, d'un
thème d'actualité, le 15 mai 1871.
Dans le recueil des Odes et Ballades, figure une poème
publié en 1827 intitulé
À la Colonne de la Place Vendôme. Ce poème marque une
date dans l'évolution politique de Victor Hugo. Essentiellement
monarchiste dans ses premières œuvres, il laisse percer de plus
en plus ouvertement une nostalgie patriotique de la gloire
napoléonienne. Cette évolution se perçoit très bien dans l'Ode
à la Colonne que l'opinion royaliste contemporaine vécut
comme une désertion. Fils d'un général de Napoléon, Hugo y réagit vivement à l'affront
infligé à
quatre maréchaux d'Empire au cours d'une réception à l'Ambassade
d'Autriche. Dans son poème, il déclare sa vénération pour la
Colonne, monument érigé (Place Vendôme, à Paris)
sur le modèle de la Colonne Trajan (à Rome) pour commémorer les victoires de Bonaparte. S'adressant au monument
comme à une personne, il avoue :
Que de fois, tu le
sais, quand la nuit sous ses voiles
Fait fuir la blanche lune ou trembler les étoiles,
Je viens, triste, évoquer tes fastes devant moi ;
Et d’un œil enflammé dévorant ton histoire,
Prendre, convive obscur, ma part de tant de gloire,
Comme un pâtre au banquet d’un Roi !
Et il menace les
"étrangers" d'un sursaut patriotique qui verrait le peuple
français, surmontant ses divisions historiques, venger comme il
convient l'humiliation qui vient de lui être faite :
Prenez garde ! — La
France, où grandit un autre Âge,
N’est pas si morte encor qu’elle souffre un outrage !
Les partis pour un temps voileront leur tableau.
Contre une injure, ici, tout s’unit, tout se lève,
Tout s’arme, et la Vendée aiguisera son glaive
Sur la pierre de Waterloo.
En octobre 1830,
Victor Hugo dédie une seconde ode
À la Colonne, qui sera insérée dans Les Chants du
crépuscule (1835). Il entend protester contre le
refus de transférer les cendres de Napoléon sous la Colonne
Vendôme, de la part de la Chambre issue de la
révolution des Trois glorieuses (sous le régime de la Monarchie de
Juillet). S'adressant aux mânes de l'Empereur, il prophétise
qu'un jour viendra où le peuple, libéré, réparera ce nouvel
outrage :
Oh ! va, nous te ferons de
belles funérailles !
Nous aurons bien aussi peut-être nos batailles ;
Nous en ombragerons ton cercueil respecté !
Nous y convierons tout, Europe, Afrique, Asie !
Et nous t’amènerons la jeune Poésie
Chantant la jeune Liberté !
Tu sera bien chez nous ! —
couché sous ta colonne,
Dans ce puissant Paris qui fermente et bouillonne,
Sous ce ciel, tant de fois d’orages obscurci,
Sous ces pavés vivants qui grondent et s’amassent,
Où roulent les canons, où les lésions passent ; —
Le peuple est une mer aussi.
Hugo ne peut donc que s'indigner une troisième fois quand, le 14 avril
1871, sur proposition du peintre Gustave Courbet, l'assemblée de
la Commune de Paris décrète la destruction de la Colonne
Vendôme :
« La Commune de Paris,
considérant que la colonne impériale de la place Vendôme est
un monument de barbarie, un symbole de force brute et de
fausse gloire, une affirmation du militarisme, une négation
du droit international, une insulte permanente des
vainqueurs aux vaincus, un attentat perpétuel à l’un des
trois grands principes de la République française, la
fraternité, décrète : article unique - La colonne Vendôme
sera démolie. »
Le 7
mai 1871, la revue Le Rappel, éditée par des proches de
Hugo, publie le poème
Les deux trophées (qui sera ultérieurement repris dans le
recueil L'Année terrible). Hugo y flétrit en les
renvoyant dos à dos ceux qui détruisent l'Arc de Triomphe en
bombardant Paris (les Versaillais) et ceux qui veulent mettre à
bas la Colonne Vendôme :
O fratricide ! Ici toute la
frénésie
Des canons, des mortiers, des mitrailles ; et là
Le vandalisme ; ici Charybde, et là Scylla.
Peuple, ils sont deux. Broyant tes splendeurs étouffées,
Chacun ôte à ta gloire un de tes deux trophées ;
Nous vivons dans des temps sinistres et nouveaux,
Et de ces deux pouvoirs étrangement rivaux
Par qui le marteau frappe et l’obus tourbillonne,
L’un prend l’Arc de Triomphe et l’autre la Colonne !
[...]
Respect à nos soldats, rien
n’égalait leurs tailles ;
La Révolution gronde en leurs cent batailles ;
La Marseillaise, effroi du vieux monde obscurci,
S’est faite pierre là, s’est faite bronze ici ;
De ces deux monuments sort un cri : Délivrance !
Dans sa lettre du 15 mai, Rimbaud qui a peut-être lu
le poème de Hugo et qui, en tout cas, suit de très près
l'actualité parisienne, ne partage visiblement pas les scrupules
patriotiques de l'auteur des Châtiments devant les
menaces qui pèsent sur la Colonne. Le monument sera
effectivement mis à bas le 16 mai, au lendemain de l'envoi de la
lettre.
|
Le morceau de bravoure de ce chapitre sur les "premiers
romantiques" est la volée de bois vert administrée à Musset. Elle occupe
toute la page 9 du manuscrit. Il lui reproche d'abord "sa paresse
d'ange", ce qui semble viser sa réputation de bohème et de poète
dilettante. Les parnassiens considéraient Musset comme un versificateur
laxiste, dont la poésie souvent narrative n'était que de la prose
pauvrement rimée. La "paresse" est exactement aussi ce que lui
reproche Baudelaire : "Alfred de Musset, féminin et sans
doctrine, aurait pu exister dans tous les temps et n’eût jamais été
qu’un paresseux à effusions gracieuses" (Baudelaire, "Théophile
Gautier", 1859).
Rimbaud ne nie pas que l'auteur de
Rolla ait été "voyant".
Musset, dit-il, "avait des visions derrière la gaze des rideaux : il a
fermé les yeux". Comme les romantiques précédents, donc, il aurait pu
mais n'a pas voulu aller jusqu'au bout. Les rideaux légers, les rideaux
tremblants, abondent dans le poème de Rolla. Ce jeune et bel aristocrate, débauché et ruiné, a décidé
de dépenser ses derniers sous à l'achat d'une nuit passée avec Marion,
jeune prostituée de son goût, puis de se tuer. Au petit matin,
contemplant vaguement la silhouette endormie de Marion "derrière la gaze
des rideaux" qui entourent le lit, sa rêverie lui fait apparaître,
derrière la prostituée, l'enfant naïve et pure qu'elle a été à quinze
ans, et c'est sa propre innocence perdue qui, naturellement, devient
l'objet de sa mélancolie :
"Est-ce sur de la neige, ou sur une statue,
Que cette lampe d’or, dans l’ombre suspendue,
Fait onduler l’azur de ce rideau tremblant ?
Non, la neige est plus pâle, et le marbre est moins blanc.
C’est un enfant qui dort. etc."
Rimbaud, qui a dû
adorer ça à quinze ans (comme tous les "garçons épiciers" et
"séminaristes" dont il se moque) et qui a lui aussi largement "fait son
Rolla" dans ses poèmes de 1870 (comme certains des "seconds romantiques"
cités par la suite), trouve désormais cette poésie "fadasse" (c'est
aussi le qualificatif qu'il utilise à l'encontre de la "poésie
subjective" de son ancien professeur Georges Izambard. cf. la lettre du
13 mai à ce dernier). Il la compare à "de la peinture à l'émail". "La
peinture à l'émail, pratiquée sous le Second Empire, notamment par
Michel Bouquet, donnait lieu à des représentations mièvres et dépourvues
de la moindre originalité" (JLS 2015). "L'adjectif « charmant », écrit
Schaeffer, revient sous la plume de Sainte-Beuve (comme sous celle de
Gautier) avec une fréquence extraordinaire" (GS p.183) quand ils
évoquent Musset. Mais précisément, pour Rimbaud, Musset est trop
charmant : "Printanier, l'esprit Musset ! Charmant, son amour !"
Il n'apprécie pas davantage, semble-t-il l'"apostrophe
rollaque" (l'épithète a été forgé par Rimbaud). Jacques Rolla, dans le poème de Musset, lance à Voltaire une
apostrophe célèbre : "Dors-tu content, Voltaire ? etc."
(toute la partie IV du poème).
Voltaire
(François-Marie Arouet de son vrai nom) est aux
yeux de Rolla le représentant par excellence du Siècle des Lumières,
auquel il impute la mort de Dieu. Voltaire a ruiné par ses sarcasmes le monde ancien dont
il est nostalgique, la spiritualité et le rêve, la vertu et l'amour, la
foi et l'espérance, l'idéal sous toutes ses
formes.
|
L' APOSTROPHE ROLLAQUE (EXTRAITS)
Dors-tu content, Voltaire, et
ton hideux sourire
Voltige-t-il encor sur tes os décharnés ?
Ton siècle était, dit-on, trop jeune pour te lire ;
Le nôtre doit te plaire, et tes hommes sont nés.
Il est tombé sur nous, cet édifice immense
Que de tes larges mains tu sapais nuit et jour.
La Mort devait t’attendre avec impatience,
Pendant quatre-vingts ans que tu lui fis ta cour ;
Vous devez vous aimer d’un infernal amour.
[...]Vois tu,
vieil Arouet ? cet homme plein de vie,
Qui de baisers ardents couvre ce sein si beau,
Sera couché demain dans un étroit tombeau.
Jetterais-tu sur lui quelques regards d’envie ?
Sois tranquille, il t’a lu. Rien ne peut lui donner
Ni consolation ni lueur d’espérance.
Si l’incrédulité devient une science,
On parlera de Jacque, et, sans la profaner,
Dans ta tombe, ce soir, tu pourrais l’emmener.
Penses-tu cependant que si quelque croyance,
Si le plus léger fil le retenait encor,
Il viendrait sur ce lit prostituer sa mort !
Sa mort ! — Ah ! laisse-lui la plus faible pensée
Qu’elle n’est qu’un passage à quelque lieu d’horreur,
Au plus affreux, qu’importe ? il n’en aura pas peur ;
Il la relèvera, la jeune fiancée,
Il la regardera dans l’espace élancée,
Porter au Dieu vivant la clef d’or de son cœur !
Voilà pourtant ton œuvre, Arouet, voilà l’homme
Tel que tu l’as voulu. — C’est dans ce siècle-ci,
C’est d’hier seulement qu’on peut mourir ainsi.
Quand Brutus s’écria sur les débris de Rome :
— Vertu, tu n’es qu’un nom ! — il ne blasphéma pas.
Il avait tout perdu, sa gloire et sa patrie,
Son beau rêve adoré, sa liberté chérie,
Sa Portia, son Cassius, son sang et ses soldats ;
Il ne voulait plus croire aux choses de la terre.
Mais, quand il se vit seul, assis sur une pierre,
En songeant à la mort, il
regarda les cieux.
Il n’avait rien perdu dans cet espace immense ;
Son cœur y respirait un air plein d’espérance ;
Il lui restait encor son épée et ses dieux.
Et que nous reste-t-il, à nous, les déicides ?
Pour qui travailliez-vous, démolisseurs stupides,
Lorsque vous disséquiez le Christ sur son autel ?
Que vouliez-vous semer sur sa céleste tombe,
Quand vous jetiez au vent la sanglante colombe
Qui tombe en tournoyant dans l’abîme éternel ?
Vous vouliez pétrir l’homme à votre fantaisie ;
Vous vouliez faire un monde. — Eh bien, vous l’avez
fait.
Votre monde est superbe, et votre homme est parfait !
Les monts sont nivelés, la plaine est éclaircie ;
Vous avez sagement taillé l’arbre de vie ;
Tout est bien balayé sur vos chemins de fer ;
Tout est grand, tout est beau, — mais on meurt dans
votre air.
Vous y faites vibrer de sublimes paroles ;
Elles flottent au loin dans des vents empestés.
Elles ont ébranlé de terribles idoles ;
Mais les oiseaux du ciel en sont épouvantés.
L’hypocrisie est morte, on ne croit plus aux prêtres ;
Mais la vertu se meurt, on ne croit plus à Dieu.
Le noble n’est plus fier du sang de ses ancêtres ;
Mais il le prostitue au fond d’un mauvais lieu.
On ne mutile plus la pensée et la scène,
On a mis au plein vent l’intelligence humaine ;
Mais le peuple voudra des combats de taureau.
Quand on est pauvre et fier, quand on est riche et
triste,
On n’est plus assez fou pour se faire trappiste ;
Mais on fait comme Escousse, on allume un réchaud.
|
Enfin, Musset est trop "français, pas parisien !" La
formule est limpide. Paris, pour Rimbaud, en 1871, est synonyme de
"révolution" et de "Peuple". C'est ce qu'il aime. Musset, à l'inverse,
incarne l'esprit mondain et aristocratique, une mélancolie élégante et
distancée, un mélange de légèreté, de sentimentalisme et d'humour spirituel, ce qu'on
appelle "l'esprit français".
Rimbaud lui reproche apparemment, enfin, son romanesque
facile, sa complaisance au
mélodrame, son goût pour les héros dans la "panade". Il conclut :
'Français, panadif, traîné de l'estaminet au pupitre de collège, le beau
mort est mort, et, désormais, ne nous donnons même plus la peine de le
réveiller par nos abominations !"
|
Les seconds romantiques
sont très voyants, Th. Gautier, Lec. de Lisle, Th. de Banville.
Mais |
|
page 10 et 11
|
|
inspecter l'invisible et entendre l'inouï étant
autre chose que reprendre l'esprit des choses mortes, Baudelaire est le
premier voyant, roi des poètes, un vrai Dieu. Encore a-t-il vécu dans un
milieu trop artiste ; et la forme si vantée en lui est mesquine : les
inventions d'inconnu réclament des formes nouvelles.
Rompue aux formes vieilles, parmi les innocents, A. Renaud,
— a fait son Rolla,
— L. Grandet
— a fait son Rolla ;
− les gaulois et les Musset, G.
Lafenestre, Coran, Cl. Popelin, Soulary,
L. Salles ; les écoliers, Marc, Aicard, Theuriet ; les morts et les imbéciles, Autran, Barbier, L. Pichat, Lemoyne, les Deschamps, les Desessarts ; les
journalistes, L. Cladel, Robert Luzarches, X. de Ricard ; les
fantaisistes, C. Mendès ; les bohèmes ;
les femmes ; les talents, Léon Dierx, Sully-Prudhomme, Coppée,
— la
nouvelle école, dite parnassienne, a deux voyants, Albert Mérat et Paul
Verlaine, un vrai poète. Voilà.
— Ainsi je travaille à me rendre
voyant.
—
Et finissons par un chant pieux.
Vous seriez exécrable de ne pas répondre ; vite car dans huit jours je
serai à Paris, peut-être.
Au revoir.
A. RIMBAUD.
|
|
|
|
Bilan nominatif des "seconds romantiques" et de "la
nouvelle école, dite parnassienne"
Si on comprend bien la nomenclature proposée par
Rimbaud (et sa syntaxe) dans les deux derniers paragraphes de la lettre,
il faut distinguer : premier paragraphe, "les seconds romantiques"
(Gautier, Leconte de Lisle, Banville et Baudelaire) et, second
paragraphe, "rompue aux formes vieilles [...] la nouvelle école
parnassienne". Les premiers sont "très voyants". La seconde, malgré le
nombre des noms cités, "a deux voyants" seulement : "Albert Mérat et
Paul Verlaine, un vrai poète". Rimbaud ne donne pas ses raisons.
Dans son article "La lettre du 15 mai et les « seconds
romantique »", Yann Mortelette projette un éclairage décapant sur la
"méthode" qui a présidé à la confection de la liste indigeste du second
paragraphe. Selon lui, il est peu probable que Rimbaud, bien que grand
lecteur de poésie, ait lu tous les auteurs dont il cite le nom. Certains
n'avaient quasiment rien publié encore en 1871 et Rimbaud, d'après
Mortelette, s'est essentiellement fondé sur la quatrième de couverture
de la cinquième livraison du
Parnasse contemporain (janvier 1870)
qui dressait la liste des collaborateurs, par livraisons, en annonçant
les futurs numéros.
 |
Le Parnasse
contemporain
Directeurs : Catulle Mendès et Louis-Xavier de Ricard
Paris, Lemerre, 1866
25 x 16,5 cmSource :
Centre Pompidou
|
Les dénominations utilisées par Rimbaud pour classer
tous ces poètes : "les innocents", "les gaulois et les Musset", les
"écoliers", les "journalistes", les "fantaisistes", les "bohèmes", les
"talents", les "femmes" ... sont assez disparates.
Selon Mortelette, Rimbaud répartit ceux qu'il
considère comme des parnassiens dans des catégories qui "ne sont pas
celles que l'histoire littéraire a retenues". Il mêle romantiques
d'avant 1830 (les frères
Deschamps) et romantiques d'après 1830 (Alfred
des Essarts et
Charles Coran), des partisans de l'art pour le progrès ou
poètes engagés (Armand Renaud,
Louis-Xavier de Ricard,
Léon Laurent-Pichat,
Robert Luzarche) et des compagnons de route du Parnasse contemporain
(André Theuriet,
André Lemoyne,
Emmanuel des Essarts), des néo-romantiques qu'il qualifie d'émules de Musset ayant fait leur Rolla
avec d'avérés parnassiens comme
Léon Dierx,
François Coppée ou
Sully Prudhomme...
Toujours d'après le même critique, si l'on excepte les
maîtres du Parnasse classés par Rimbaud dans les "seconds romantiques"
(Gautier, Leconte de Lisle, Banville et Baudelaire) et si l'on définit
rigoureusement le mouvement parnassien comme le groupe des poètes ayant
adopté "la théorie de l'art pour l'art formulée par Théophile Gautier à
l'époque de la bohème du
Doyenné", prônant "la perfection de la forme,
le retour à l'Antiquité, la promotion du lyrisme impersonnel, la volonté
d'impassibilité, l'érudition scientifique et l'intérêt porté à la
réalité extérieure plutôt qu'au moi intérieur", seuls sept des trente et
un noms cités dans le paragraphe peuvent être considérés comme
Parnassiens : Coppée, Dierx,
Lafenestre,
Mendès,
Mérat, Ricard et Sully
Prudhomme. (op. cit. p.32).
Comme nous l'avons précédemment observé, cette
dernière liste de poètes, parnassiens ou pas, se termine par la mise en
relief de deux noms : "Albert Mérat et Paul Verlaine". Celui de Paul
Verlaine n'étonne pas. Mais Yves Reboul met en garde à juste titre dans
une note de son article "Mérat le voyant" contre "l'illusion
d'optique" qui pourrait être la nôtre : "Il faut remarquer qu'en mai
1871, date de la lettre à Demeny, Verlaine n'est encore que l'auteur des
Poèmes saturniens et des Fêtes galantes (La Bonne
Chanson elle-même ne sera mise en vente qu'en 1872)". C'est donc
avec une remarquable lucidité critique que Rimbaud distingue Verlaine de
ses contemporains et de Mérat lui-même, d'ailleurs : "Rimbaud a bien perçu,
dès cette époque, une différence de qualité : c'est de Verlaine seul
qu'il écrit que c'est « un vrai poète »" (op. cit. 2015, p.88, n.1).
Néanmoins, il qualifie Mérat également de "voyant".
Comment comprendre cet enthousiasme rimbaldien pour un
poète aujourd'hui presque complètement oublié ? Ce n'est possible,
explique Reboul dans l'article que nous venons de mentionner, que si on
dégage la notion de "voyant" des connotations mystiques que la critique
a coutume de lui attacher et si on admet que, dans la lettre du 15
mai notamment, elle s'inscrit le plus souvent dans une perspective tout
autre, "historique au fond — celle du poète définissant « la quantité
d'inconnu s'éveillant en son temps dans l'âme universelle »" (ibid.,
p.89). Or, dans
Les Chimères (1866), au-delà d'une écriture typiquement
parnassienne et qui frôle, bien des fois, "le pur exercice de style" en
quête de la seule "beauté plastique", Rimbaud a pu être sensible à
"l'affirmation matérialiste, diffuse dans le recueil" qui "peut revêtir
cette forme quasiment prophétique dont le romantisme avait tendu à faire
un trait distinctif de la parole du voyant", comme dans le sonnet
intitulé À G.F. dont Yves Reboul cite les deux quatrains (ibid. p.79).

De même, il
est possible qu'il ait apprécié chez l'auteur de
L'Idole (1869) sa "volonté de dire la
vérité sur l'amour, au-delà des stéréotypes" (ibid. p.81), "la force
irrépressible du désir et de la jouissance" (ibid. p.82), "la
présence — et la puissance — du sexe" (ibid. p.83). Et de conclure : "Mérat
n'était pas un poète entièrement négligeable [...]. Sans doute, en mai
1871, Rimbaud lui a-t-il taillé des habits un peu trop grands pour lui,
mais non totalement illégitimes. Dans le projet rimbaldien de se faire
voyant, il aura eu sa part qui ne fut pas insignifiante." (ibid. p.90).
Empruntons enfin à Hermann H. Wetzell, pour commenter la fin de la
lettre et l'insertion d'Accroupissements, cette perspicace
hypothèse psychologique : "En relisant sa lettre, Rimbaud est saisi du
même doute qui le tourmente sur son poème Le Coeur supplicié
inséré dans la lettre du 13 mai à Georges Izambard. Est-ce que Demeny va
comprendre ce que signifie ce poème, qu'il ne « veut pas rien dire » ?
De même, nous lisons comme introduction à Accroupissements : « —
Voilà. — Ainsi je travaille à me rendre Voyant ». Du même coup
Accroupissements représente dans la perspective de Rimbaud,
contre toute apparence, une étape sur le chemin de la voyance. Il se
moque de la conception métaphysique traditionnelle de la voyance pour
chercher ses sujets dans la plus basse matérialité [...]. Le « raisonné
dérèglement de tous les sens » est d'abord un dérèglement de la
sensibilité et de ses formes d'expression traditionnelle [...]. En ce
moment précis, la parodie et la caricature sont pour Rimbaud une étape
nécessaire de la voyance." (Wetzell, 2008, p.371-372).
14 février 2018
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
Bibliographie
Christian Moncel, Baudelaire, les poisons et l'Inconnu, Roanne,
1972, Rimbaud et les formes monstrueuses de l'amour, Riorges,
1980, et, du même auteur apparemment, les innombrables articles sur
Baudelaire et Rimbaud de ses hétéronymes. Notamment :
Alain Dumaine, Rimbaud ou l'avenir de la poésie, La Petite Revue
de l'Indiscipline, avril 1997.
Maurice Hénaud, Le délire de Rimbaud, de la lettre du "voyant" à
Une saison en enfer, La Petite Revue de l'Indiscipline, décembre 2016.
Gérald Schaeffer, Lettres du voyant (13
et 15 mai 1871), édition et commentaires de G.S., précédé de "La voyance
avant Rimbaud" par Marc Eigeldinger, Droz, 1975.
Maciej Zurowski, "Le poète comme
multiplicateur de progrès", in L'Esprit nouveau dans tous ses états.
Mélanges Michel Décaudin, Minard, 1986, p.137-143.
André Guyaux, "Trente répliques à « Je est
un autre », petite phrase", in Rimbaud à neuf, Revue des Sciences
humaines, n°193, 1987, p.40-42.
Jean-François Massol, "De l'artiste au
voyant. Le Poète selon Rimbaud.", in Romantisme. Revue du
Dix-Neuvième Siècle, n°67, 1990, p.77-86.
En ligne :
http://www.persee.fr/doc/roman_0048-8593_1990_num_20_67_5652
Daniel Leuwers, Les lettres du voyant,
Ellipses, 1998.
André Guyaux, "Le texte de la lettre "du
voyant"", in L'esthétique dans les correspondances d'écrivains et de
musiciens (XIXe-XXe siècles). Actes du colloque de la Sorbonne des 29 et
30 mars 1996, organisé par Arlette Michel et Loïc Chotard. Presses de l'Université de la Sorbonne, 2001, p.57-76.
En ligne (pages manquantes).
https://books.google.fr/books?id=NNHqVQbV4UoC&pg=PA135&lpg=PA135&dq#v=onepage&q&f=false
Holly Haahr, "Les Lettres dites du voyant.
Art poétique ou parodie?", in Parade sauvage
n°17-18, 2001, p.10-30.
Olivier Bivort, "Rimbaud, la parole et
l’idée (sur un passage de la lettre à Paul Demeny du 15 mai 1871)"
in Maria Emanuela Raffi, Les Pas d’Orphée, scritti in onore
di Mario Richter, Padova, Unipress, 2005, p. 203-217.
Olivier Bivort, "La « grammaire » de
Rimbaud", in Parade sauvage, colloque n°5, 16-19 septembre 2004,
Charleville-Mézières 2005, p.17-37.
Yann Mortelette, "La lettre du 15 mai et
les seconds romantiques", in
Cahiers de littérature française, dir. André Guyaux, L'Harmattan,
octobre 2005, p.19-32.
Steve Murphy, "Accroupissements ou
la physiologie d'un obscurantisme voyant", in Rimbaud et les sauts
d'harmonie inouïs. Actes du colloque international de Zurich – 24-26
février 2005, 2007, p.225-276.
Jean-Luc Steinmetz, "Deux méthodes de
« voyance »", Reconnaissances. Nerval, Baudelaire, Lautréamont,
Rimbaud, Mallarmé. Éditions Cécile Defaut, Nantes, 2008, p. 241-249.
Hermann H. Wetzel, "La Lettre du voyant
et ses poèmes", in Parade sauvage, Numéro spécial : Hommage à
Steve Murphy, octobre 2008, p.365-373.
Christine Planté, "Les poètes et la femme
dans les lettres du Voyant", Europe, 2009, n°966, p. 63-81.
Steve Murphy, "Le 15 mai 1871 : politiques
du voyant" in Rimbaud et la Commune, Classiques Garnier, 2009,
p.191-2016.
Sergio Cigada, "Rimbaud" de la Lettre du Voyant au Bateau ivre
in Sergio Cigada, Études sur le symbolisme, Milan 2011. En
ligne :
https://mla.hcommons.org/deposits/objects/mla:94/datastreams/CONTENT/content
Sergio Cigada, "Trouver une langue. Sur
les caractères de la nouvelle langue prophétisée par Rimbaud", in La
Littérature symboliste et la Langue, dir. Olivier Bivort. Actes du
colloque organisé à Aoste les 8 et 9 mai 2009. Classiques
Garnier. Collection "Rencontres", 2012, p. 63-73.
Dominique Combe, "Rimbaud poéticien ?" in
Rimbaud poéticien, colloque de Venise (28-29 novembre 2013),
Classiques Garnier, 2015, p.15-27.
Henri Scepi, "Rimbaud, poésie objective",
in Rimbaud poéticien, colloque de Venise (28-29 novembre 2013),
Classiques Garnier, 2015, p.29-45.
Hermann H. Wetzel, "La poétique de Rimbaud
est-elle à la hauteur de ses poèmes ?", in
Rimbaud poéticien, colloque de Venise (28-29 novembre 2013),
Classiques Garnier, 2015, p.47-58.
Yves Reboul, "Mérat le voyant", in
Rimbaud poéticien, colloque de Venise (28-29 novembre 2013),
Classiques Garnier, 2015, p.73-90
Jean-Luc Steinmetz, "Rimbaud et l'hallucination", in
Rimbaud poéticien, colloque de Venise (28-29 novembre 2013),
Classiques Garnier, 2015, p.151-159.
Adrien Cavallaro, "Pour une poétique de la
formule rimbaldienne au XXe siècle", in
Rimbaud poéticien, colloque de Venise (28-29 novembre 2013),
Classiques Garnier, 2015, p.189-231.
Audio-Vidéo
Jacques Guimet dit un extrait de la
lettre du 15 mai 1871, Le Fond et la Forme, 30 septembre 1969
(03 min 55 s) :
http://www.ina.fr/video/CPF10005623
Jesper Svenbro, "De la Muse à La lettre du
voyant", cours du Collège de France, 22/03/2013, France Culture (55
min) :
https://www.franceculture.fr/emissions/leloge-du-savoir/de-la-muse-la-lettre-du-voyant
Abréviations utilisées
GS : Les Lettres du Voyant,
Droz, par Gérald Schaeffer
AA : Pléiade 1972 Antoine Adam
AG : Pléiade 2015 André Guyaux
SG : Œuvres, Garnier, 1960, par Suzanne Bernard
PB : Œuvres Complètes, Pochothèque, 1999, par Pierre Brunel
SM-IV : Œuvres Complètes, tome IV, Champion, 2002, par Steve Murphy.
JJL : Correspondance, Fayard, 2007, par Jean-Jacques Lefrère
JLS : Correspondance, GF, 2015, par Jean-Luc Steinmetz
 |