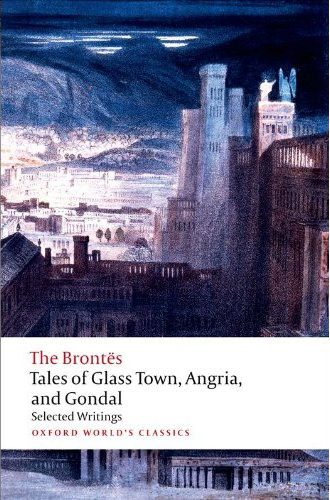|
|
||||
|
||||
|
||||
|
l. 1-2 / L'acropole officielle outre les conceptions de la barbarie moderne les plus colossales. "Acropole" est à l'origine un mot grec signifiant "ville haute". Mais les Grecs de l'Antiquité ne sont pas les seuls dans l'histoire qui aient édifié leurs villes au pied d'une hauteur susceptible de servir de refuge (citadelle, "haut quartier" fortifié) ou de symboliser les valeurs suprêmes de la Cité (organes du pouvoir, édifices religieux, palais de justice, etc.). L'utilisation, ici, du mot "acropole" pour désigner une réalisation architecturale "moderne" n'est donc ni indifférente, ni proprement originale. Nous aurions pu l'observer tout aussi bien dans un discours d'architecte ou la notice d'un guide touristique. Mais elle manifeste aussi, d'emblée, une certaine façon de mêler dans la description des mots (des termes architecturaux notamment) empruntés aux époques et aux latitudes les plus diverses, en un composite spatio-temporel qui est une caractéristique du poème. Cet éclectisme n'est d'ailleurs que le reflet de celui qui triomphe dans l'architecture monumentale du XIXe siècle. De cette première phrase du texte, disons d'abord qu'elle inscrit un énonciateur. Le texte ne se contente pas de décrire ou de construire une architecture urbaine, il note des jugements et des ressentis. Comme l'indique Antoine Raybaud, il développe un "double discours [...] sous les espèces d'un répertoire verbal et formulaire qui est celui de l'ingénieur-architecte, et d'un autre qui est celui du promeneur scrutateur, tel que Poe et Baudelaire l'ont mis en scène" (op. cit. p.92). Le critique fait allusion au Baudelaire du Peintre de la vie moderne, des Tableaux parisiens et du Spleen de Paris, au Poe de L'Homme des foules. D'abord révélée par les appréciations de type subjectif portées par le texte sur l'architecture de la ville, cette présence se matérialisera, à partir de la ligne 7, dans l'apparition de la première personne. En première lecture, tout au moins,
les appréciations sont négatives. Le verbe "outrer", signifiant exagérer,
porter les choses au-delà de la mesure, dit Littré (cité par
Albert Py, op. cit. p.143), plus encore le mot "barbarie"
(antonyme de civilisation, raffinement, équilibre), impliquent un
rejet du goût moderne pour le colossal. Rimbaud
fait allusion, sans aucun doute, aux grands travaux d'architecture
et d'urbanisme que facilitent l'utilisation de nouveaux matériaux
(l'acier, le verre) et les innovations technologiques, tels qu'on
les voit proliférer à son époque dans les capitales européennes. Le "haut
quartier" qu'il dresse devant nos yeux surpasse donc, dans la
démesure, les conceptions elles-mêmes démesurées de l'architecture
moderne. Nous convie-t-il à un rêve (ou à un cauchemar) représentant
la ville de l'avenir, vision inspirée par les projets d'urbanisme utopiques qui fleurissent
aussi à son époque (cf. la multiplication des ouvrages plus ou
moins scientifiques, plus ou moins romancés autour du "Paris
futur" : Gautier, Fournel, Moilin). Telle est l'hypothèse avancée par Pierre Brunel
(entre autres) : "Il faut comprendre surtout qu'une acropole
imaginaire, ressortissant encore à l'utopie, comme dans Villes,
en rajoute encore, et oh combien ! sur les acropoles classiques et
les créations urbaines de la barbarie moderne." (op. cit. p.362).
Ou, au contraire, Rimbaud pense-t-il aux réalisations architecturales qu'il a pu observer en
voyageant, jugées monumentales par comparaison avec le goût plus classique prévalant en
France ? Telle est l'idée proposée par Albert Py : "Il y a
bien des chances que l'expression barbarie moderne ne soit
pas péjorative. Les Barbares sont des étrangers qui ont, beaucoup
plus que les Français, le sens du moderne, du colossal." (op. cit.
p.143). La suite du texte, comme nous le verrons, rend difficile
toute opinion tranchée, tant le point de vue oscille d'une phrase à l'autre,
exprimant tour à tour l'enthousiasme et l'étonnement angoissé de cet "étranger
de notre temps" (l.33) devant une ville sans identité
historique ni géographique clairement définie.
l.2-5 / Impossible d'exprimer le jour mat produit par le ciel immuablement gris, l'éclat impérial des bâtisses, et la neige éternelle du sol. Cette seconde phrase complète le tableau d'une ville sinistre : l'absence de lumière (jour mat, ciel gris) y est immuable, la neige, éternelle. On se demande, dans ces conditions, si le mot "éclat" correspond à une notion de luminosité (luminosité éclatante) ou seulement à l'idée d'un luxe décoratif tentant vainement de compenser sur les façades la morosité du climat. Marie-Joséphine Whitaker voit dans ces lignes une critique de l'architecture haussmannienne : "la ville décrite évoque le Paris de Haussmann, du Second Empire, le faux classicisme du style Empire avec ce qu'il a de prétentieux ou d' « impérial »" (op. cit. p.37). Quelques commentateurs se contentent de mentionner le caractère "nordique", voire "britannique", de ces notations climatiques déprimantes. D'autres, soulignant l'irréalisme de détails comme "la neige éternelle du sol" et l'état de sidération hyperboliquement mentionné ("impossible d'exprimer..."), penchent pour une interprétation plus fantastique : une ville artificielle, inhumaine, démoniaque. Cette phrase et quelques autres du même ton comme celle des lignes 18-21 ("un bras de mer, sans bateaux, roule sa nappe de grésil bleu entre des quais chargés de candélabres géants") sont à l'origine de la réception dominante du texte comme dystopie urbaine. Villes ("L'acropole officielle") se voit généralement opposer, sous ce rapport, à l'autre Villes ("Ce sont des villes"), qui constituerait son pendant utopique. L'article de Marie-Claire Banquart, pour qui la ville du poème est une "anti-Jérusalem", illustre bien ce type d'interprétation :
l.5-7 / On a reproduit dans un goût d'énormité singulier toutes les merveilles classiques de l'architecture. Selon Vernon Philip Underwood, l'expression acropole officielle "peut très bien désigner le Crystal Palace". L'auteur de Rimbaud et l'Angleterre (voir mon compte rendu dans ce site) explique que le Crystal Palace, vaste palais en verre et à armature d'acier conçu pour la première Exposition Universelle de Londres en 1851, s'élevait du temps de Rimbaud "sur une éminence boisée et visible de très loin [où] il faisait grande impression." La description que donne le poète de son "acropole officielle" n'est pas sans évoquer le style monumental ayant présidé à l'édification de ce haut lieu de la civilisation victorienne. Ainsi la phrase : On a reproduit dans un goût d'énormité singulier toutes les merveilles classiques de l'architecture. Il y a là, selon Underwood, une "allusion probable aux différents 'Courts' qui, dans ces galeries, reproduisaient les constructions assyriennes, égyptiennes, romaines, pompéiennes, byzantines, gothiques médiévales. Il y avait un 'Alhambra Court', des reproductions du Parthénon athénien, des colosses d'Abou Simbel (20m de haut)" (op. cit. 1976, p.71-72). La chose est difficilement démontrable mais les éditeurs admettent généralement que, malgré le caractère de "poésie cosmopolite" du texte, les "références londoniennes" y sont particulièrement "nombreuses" (Jean-Luc Steinmetz, 1989, p.159) et qu'il est possible de voir dans le sujet qui s'y exprime "un touriste fasciné par le gigantisme moderne, celui du Crystal Palace par exemple" (André Guyaux, op. cit. p.965). Remarquons malgré tout que Théophile Gautier, lorsqu'il imagine Paris futur (1851), suit les mêmes principes d'énormité et de cosmopolitisme que Rimbaud dans son "acropole officielle" :
Rimbaud n'avait donc pas besoin d'avoir visité le Crystal Palace pour être capable d'"imaginer" de telles conceptions architecturales.
l.7-9 / J'assiste à des expositions de peinture dans des locaux vingt fois plus vastes qu'Hampton-Court. Quelle peinture ! Vernon Philip Underwood (cité par Albert Py) écrit : "Hampton-Court : Résidence royale des XVIe et XVIIe siècles, à 20 km de Londres, sur la Tamise [...] n'est pas spécialement un musée de peintures, bien que ses grands appartements en contiennent beaucoup ; son parc en tout cas, comme celui du Crystal-Palace, représente la nature primitive travaillée par un art superbe." (op. cit. 1953, p.51). Le syntagme exclamatif final ("Quelle peinture !") laisse le sens remarquablement indéterminé ! Ce pourrait être un cri d'admiration, mais l'aspect exclusivement quantitatif des éloges décernés à la ville dans les phrases qui précèdent laissent penser que notre cicérone a surtout vu des peintures "énormes" ou grandioses, ce qui n'est pas nécessairement bon signe, sur le plan de la qualité.
l.10-14 / Un Nabuchodonosor norwégien a fait construire les escaliers des ministères ; les subalternes que j'ai pu voir sont déjà plus fiers que des Brahmas et j'ai tremblé à l'aspect de colosses des gardiens et officiers de constructions. Concernant la leçon "j'ai tremblé à l'aspect des gardiens de colosses", qui est celle du manuscrit et de la plupart des éditions, voir à la page : Manuscrit. Pour "Brahmas", Pierre Brunel (op. cit. 2004, p.360) pense que Rimbaud fait allusion "à certaines représentations du dieu indien Brahma, à quatre têtes". Pour "officiers de construction", le même critique fait sien le commentaire de Vernon Philip Underwood selon qui cette formule calquerait l'expression anglaise : "building officers" (agents de sécurité ?). L'expression "un Nabuchodonosor norwégien" (c'est l'orthographe d'époque) constitue une antonomase (nom propre employé comme nom commun pour signifier une qualité essentielle attribuée au personnage mentionné : le roi Nabuchodonosor fut un grand constructeur). Une telle "antonomase" pourrait figurer sans surprise dans n'importe quel guide touristique si la ville décrite était située en Norwège et/ou si son architecte était un "norwégien". Mais comme ce n'est pas le cas (cette ville, quoique fort enneigée, est une ville de nulle part), l'antonomase s'augmente ici d'un effet d'oxymore : on a l'impression d'une alliance de mots goguenarde, s'inscrivant dans l'éclectisme historico-géographique recherché par le texte. La tradition présente Nabuchodonosor, roi de Babylone, comme le type des grands bâtisseurs (cf. le récit biblique de la Tour de Babel, inspiré par la ziggurat de Babylone édifiée par Nabuchodonosor premier ; son successeur Nabuchodonosor II fit construire les célèbres "jardins suspendus" décrits par plusieurs auteurs de langue grecque et latine). Coupable d'avoir déporté et mis en esclavage le peuple juif, Babylone est, dans la Bible, le symbole de la cité gigantesque et corrompue, "la grande prostituée", vouée au culte des faux dieux, dont la destruction est régulièrement annoncée par les prophètes comme punition de Dieu pour son orgueil. Dans l'Apocalypse, Rome est appelée "la grande Babylone" et, dans la tradition socialiste des temps modernes, la même appellation a souvent servi pour désigner péjorativement les grandes métropoles impérialistes. Les caractéristiques monumentales de la ville rimbaldienne, telles qu'elles étaient énumérées depuis le début du texte, rendaient prévisible l'intervention de cette référence babylonnienne (le nom de Nabuchodonosor) :
D'où l'effet produit sur le promeneur : "J'ai tremblé". Par l'adjectif "norwégien", Rimbaud confirme le caractère nordique de la ville, déjà suggéré par la référence à "la neige éternelle du sol" (cf. note ci-dessus). Le grand Nord, le Pôle, est plusieurs fois associé par Rimbaud, dans les Illuminations, à l'idée de l'Inconnu et, par voie de conséquence, à celle de la conquête. Dans Métropolitain, par exemple, c'est "parmi les éclats de neige, les lèvres vertes, les glaces, les drapeaux noirs et les rayons bleus, et les parfums pourpres du soleil des pôles" que se déroule le grand combat avec "Elle" (la Ville ?). Dans Après le Déluge, le poète imagine la conquête des régions polaires par le tourisme de luxe, indice parmi d'autres de l'expansion impérialiste : "Les caravanes partirent. Et le Splendide Hôtel fut bâti dans le chaos de glaces et de nuit du pôle."
On trouve parfois chez les commentateurs une interprétation contre-utopique de cette phrase. Pierre Brunel, par exemple, écrit : "Le lecteur lui-même risque de se sentir étouffé par cette architecture urbaine à la fois proliférante et compacte : comme l'habitant d'une telle ville, il peut craindre d'être prisonnier du « groupement des bâtiments en squares, cours et terrasses fermées », asphyxié peut-être [...]" (op. cit. 2004, p.362). Je ne vois là, personnellement, qu'un poncif d'urbanisme moderniste : qu'y a-t-il de plus favorable à l'hygiène et souhaitable pour l'habitant des villes que de parvenir à évincer les cochers ? Ici encore, citons le Paris futur de Gautier :
La lecture contre-utopique du fragment ne paraît donc pas s'imposer. Certes, les phrases précédentes comportaient une tonalité satirique ou dysphorique, mais on est bien obligé de constater une solution de continuité à cet endroit du texte. Il y a dans l'écriture de Rimbaud un aspect de collage. Composé de phrases brèves, à l'enchaînement rapide, elliptique, le texte juxtapose des idées parfois disparates plus qu'il n'organise un discours suivi, ce qui n'est pas sans rapport avec son charme mystérieux. Il suffit de comparer au bricolage rimbaldien la rhétorique bien huilée d'un Gautier pour constater l'attractivité supérieure du premier sur le second, alors que le second doit apparemment beaucoup au premier : on s'ennuie parfois à trop bien comprendre un auteur qui pense à notre place. Là où cependant, l'interprétation contre-utopique finit par convaincre, même pour des passages comme celui-ci, c'est qu'à ce côté meccano que nous observons dans le mode de fabrication du texte de Rimbaud, correspond une vision de la ville elle-même comme assemblage arbitraire, absurde, incompréhensible et par là anxiogène (cf. tout le début du second paragraphe). Sur ce plan, tout oppose la ville de Rimbaud à celle de Gautier et, de façon générale, à celle des utopistes, que leurs auteurs proposent volontiers à notre admiration comme un haut témoignage de la Raison humaine, preuve, elle-même, du Dieu unique comme source de toutes choses. Reproduisons à titre d'exemple la fin du paragraphe de Gautier dont le début a été cité plus haut :
16-18 / Les parcs représentent la nature primitive travaillée par un art superbe. Même remarque que pour la phrase précédente : c'est le style de l'urbaniste ou du guide touristique. Yves Vadé (op. cit. p.954) note que la reconstitution d'espaces naturels, ou plutôt d'espaces "représentant" la nature, comme dit Rimbaud, au beau milieu de la ville, est une caractéristique des années 1860, tant à Paris (avec les divers "Bois", le Parc Montsouris, les Buttes-Chaumont) qu'à Londres (avec ses nombreux parcs et jardins). Ces espaces artificiels, hybrides (parsemés de jets d'eau, statues, monuments divers, lieux de loisir, d'expositions, de théâtre ou de concerts), éveillent simultanément l'admiration, l'imagination et l'ironie des contemporains. La valeur péjorative donnée par Marie-Claire Banquart à l'adjectif "superbe" (voir ci-dessus) paraît une interprétation quelque peu forcée. Elle est toutefois reprise par Bruno Claisse, qui perçoit dans le texte une critique générale de l'artificialité : "[...] en reniant la nature, l'art de Villes ["L'acropole officielle"] tourne nécessairement le dos à l'homme et à l'art lui-même [...]. Si le Beau n'est pas copie ni discordance, il ne saurait davantage s'associer avec la « superbe » des « parcs » et des « colosses » ni avec l'ostentation des « diligences de diamants » ou des « expositions de peinture » [...]" (op. cit. p.75).
18-21 / Le haut quartier a des parties inexplicables : un bras de mer, sans bateaux, roule sa nappe de grésil bleu entre des quais chargés de candélabres géants. Avec l'adjectif "inexplicable", commence le réseau des formules qui insistent sur le caractère incompréhensible de la ville pour "l'étranger de notre temps" (l.32) : "j'ai cru pouvoir juger" (l.28), "prodige dont je n'ai pu me rendre compte" (l.30), "la reconnaissance est impossible" (l.34), "je renonce à me faire une idée" (l.45). Ces notations concourent à l'instauration d'une atmosphère fantastique qui s'affirme dans les lignes 26-33 et se développera tout au long du second paragraphe. Cette "partie inexplicable" du poème de Rimbaud (quoiqu'il fasse beaucoup moins appel que le poème de Baudelaire au merveilleux et à l'onirique) n'est pas sans rappeler Rêve parisien : "Des nappes d'eau s'épanchaient, bleues, / Entre des quais roses et verts [...]". Rêve parisien est évidemment à compter parmi les sources vraisemblables des Villes rimbaldiennes. La ville rêvée par Baudelaire est aussi une "Babel d'escaliers et d'arcades". Le poète y savoure "L'enivrante monotonie / Du métal, du marbre et de l'eau". Comme dans Villes, Ce sont des villes, où Rimbaud voit une mer à la place du ciel, Baudelaire métamorphose le ciel en élément liquide : "Insouciants et taciturnes, / Des Ganges, dans le firmament, / Versaient le trésor de leurs urnes / Dans des gouffres de diamant." Notons en passant le recours au pittoresque indien et au merveilleux des diamants, deux ingrédients que nous retrouvons dans le poème de Rimbaud. Un autre point commun entre les deux villes de Rêve parisien et de notre poème : leur aspect désertique et l'absence de soleil (voir les deux derniers quatrains du poème de Baudelaire). Bruno Claisse attire notre attention sur l'effet d'inversion produit par cette phrase avec celle qui, dans Villes ("Ce sont des villes"), superpose au spectacle du ciel le paysage de la mer :
Villes ("L'acropole officielle"), explique ce critique, "renverse complètement" la perspective symbolique de son homologue :
l.21-25 / Un pont court conduit à une poterne immédiatement sous le dôme de la Sainte-Chapelle. Ce dôme est une armature d'acier artistique de quinze mille pieds de diamètre environ. C'est-à-dire 4.615 mètres. Cette Sainte-Chapelle (qui n'a que le nom de commun avec celle de Paris, par plaisanterie évidemment) est donc plus grande encore que l'église unique de Théophile Gautier qui rayonne à partir du Panthéon sur toute la "montagne latine" (la montagne Sainte-Geneviève). Cette dimension hyperbolique fait sourire. Ce fantastique du nombre est une caractéristique du style héroïcomique, de la parodie. Bruno Claisse voit dans cette "Sainte-Chapelle" l'un des meilleurs exemples du caractère hétéroclite de la ville imaginée par Rimbaud. Elle "rappelle un monument gothique par son nom, féodal par sa « poterne », renaissant par son « dôme », moderne par son « armature »" (op. cit. p.75). Le même critique montre comment la fragmentation de la description concourt à l'étrangeté du spectacle : "un pont court", mais quel est ce pont ? Puis, dans la phrase suivante, toujours aussi indéterminés, "des passerelles de cuivre, des plateformes, des escaliers...".
2e paragraphe
Le poème de Rimbaud ne se présente pas clairement comme une vision futuriste. Ici, pourtant, les "passerelles de cuivre" mais, surtout, la formule "étranger de notre temps" employée pour désigner le flâneur de cette ville surdimensionnée font irrésistiblement penser au genre du récit d'anticipation. Pierre Brunel glose d'ailleurs à juste titre :
Le décor de passerelles, plateformes et escaliers contournant des piliers évoque les gravures labyrinthiques de Piranèse et l'exploitation métaphysique qui en a été faite chez les romantiques français (voir sur ce sujet, entre autres, l'article de Georges Poulet : "Piranèse et les poètes romantiques français" dans Trois essais de mythologie romantique, Corti, 1971). Dans ces textes "piranésiens" de De Quincey, Musset, Nodier, Gautier, Hugo, Baudelaire, la multiplication sans fin des niveaux dans l'étagement de l'espace (quartiers d'une ville, escaliers) métaphorise l'angoisse devant l'infini (gouffre d'en haut, gouffre d'en bas). On retrouve tout à fait ce thème dans l'interrogation : "C'est le prodige dont je n'ai pu me rendre compte : quels sont les niveaux des autres quartiers sur ou sous l'acropole ?" À titre d'exemple, voici un passage souvent cité du Club des Hachichins de Théophile Gautier (1846)
l.33-34 / Le quartier commerçant est un circus d'un seul style, avec galeries à arcades. Pierre Brunel indique : "circus : rond-point en anglais. On pense immédiatement au plus célèbre de tous, à Londres, Picadilly Circus, avec ses musées, ses théâtres et ses arcades bordées de boutiques (voir Underwood)" (op. cit. 2004, p.360). Vernon Philip Underwood (cité par Albert Py) écrit : "circus : Cette description convient à Picadilly Circus, avec la Burlington Arcade et celles de Regent Street" (op. cit. p.30). Aucune raison, selon moi, de considérer l'unité de style mentionnée ici comme une notation péjorative d'uniformité, interprétation avancée par certains commentateurs.
l.34-38 / On ne voit pas de boutiques. Mais la neige de la chaussée est écrasée ; quelques nababs aussi rares que les promeneurs d'un matin de dimanche à Londres, se dirigent vers une diligence de diamants. Littré (cité par Albert Py) donne de "nabab" la définition suivante : "Titre de princes de l'Inde musulmane. Famil. Se dit des Anglais qui ont rempli de grands emplois ou fait le commerce dans l'Inde, et qui en sont revenus avec des richesses considérables." La "diligence de diamants", dit Cecil A. Hackett, "s'inspire — peut-être — d'une chose que Rimbaud aurait pu voir : un carrosse, a state coach, dans une procession royale, ou au cortège du Lord Maire" (op. cit. p.195). Pierre Brunel trouve "inquiétantes" ces boutiques que l'on ne voit pas (op. cit. 1999, p.479, n.4). Je me demande s'il ne serait pas possible de les considérer, tout simplement, comme une allusion au goût romantique pour les couverts (rappelons nous la fascination de Walter Benjamin pour les "passages" parisiens). Observée dans sa profondeur depuis les passerelles qui la surplombent, la ville basse dissimule ses boutiques sous la protection des "halles" (l.27) et des "galeries à arcades" (l.34). Théophile Gautier (toujours lui) rêve d'étendre à la ville entière ce principe de "comfort", dans son Paris futur :
l.38-41 / Quelques divans de velours rouge : on sert des boissons polaires dont le prix varie de huit cents à huit mille roupies. La phrase semble concerner les cabarets ("divans de velours rouge") ou autres lieux de plaisir. Elle est typique du ton facétieux qui se manifeste par endroits dans le texte. Les "boissons polaires", qui ne sont peut-être que des boissons glacées, clignent de l'œil vers la thématique nordique du poème tandis que les "roupies" s'inscrivent dans la série évoquant l'Inde (nababs-brahmas-roupies). Nous avons déjà commenté cette recherche d'éclectisme dont la première fonction est de bloquer toute possibilité d'identifier dans la ville du texte une ville réellement existante. Mais il y a aussi l'intention d'amuser, qu'on retrouve encore dans l'éventail largement ouvert du prix des boissons, allusion satirique qui n'est pas sans rapport avec la pratique effective des bistrotiers du monde entier.
l.41-46 / A l'idée de chercher des théâtres sur ce circus, je me réponds que les boutiques doivent contenir des drames assez sombres. Je pense qu'il y a une police, mais la loi doit être tellement étrange, que je renonce à me faire une idée des aventuriers d'ici. On retrouve là une idée constante de Rimbaud sur la ville comme théâtre (cf. par exemple, Bruxelles, "Platebandes d'amaranthes"), et notamment comme théâtre tragique. Cf. la fin de Ville :
3e paragraphe
Le poème s'achève sur l'évocation de la zone résidentielle où les classes sociales favorisées tentent d'échapper un peu à la ville. C'était aussi le cas dans Ville ("mon cottage qui est ma patrie et tout mon cœur") et Métropolitain ("Des routes bordées de grilles et de murs, contenant à peine leurs bosquets, et les atroces fleurs qu'on appellerait cœurs et sœurs, Damas damnant de longueur, — possessions de féeriques aristocraties ultra-Rhénanes, Japonaises, Guaranies [...]"). La comparaison "aussi élégant qu'une belle rue de Paris" ne laisse aucun doute sur le genre de "faubourg" dont il s'agit ici. Le mot "favorisé" va dans le même sens, mais on notera l'ironie qui se cache probablement dans le syntagme "un air de lumière". On ne peut guère le comprendre que comme "une apparence de lumière". Cette lecture est confortée par la clausule du poème : cette campagne n'est éclairée que par une "lumière qu'on a créée", une lumière artificielle. Même les riches n'échappent pas au ciel immuablement gris qui règne sur la ville, même les riches n'échappent pas à la ville. Le sens de la formule "l'élément démocratique" n'est pas aisé à définir avec précision. Faut-il comprendre "l'élément démocratique" par opposition à "l'élément aristocratique" (représenté plus loin par les "gentilshommes sauvages") et en déduire que si cet "élément démocratique" est si réduit, c'est parce le "faubourg" n'est guère habité que par des aristocrates ? Ou bien faut-il n'y voir qu'un synonyme de population. L'expression désignerait alors la fraction du Démos (du Peuple) qui habite cette banlieue. Le sens général, en tout cas, n'est pas douteux : la caractéristique sociale des populations qui vivent dans cette périphérie de la ville explique leur petit nombre : quelques centaines d'âmes. André Guyaux paraît forcer le texte quand il explique que Rimbaud "situ[e] sa vision dans un futur où l'espèce humaine se raréfie" (op. cit. 2009, p.965).
l.49-55 / Là encore les maisons ne se suivent pas ; le faubourg se perd bizarrement dans la campagne, le "Comté" qui remplit l'occident éternel des forêts et des plantations prodigieuses où les gentilshommes sauvages chassent leurs chroniques sous la lumière qu'on a créée. L'habitat du faubourg est dispersé, par définition. Rien de "bizarre", donc. Mais il n'y a peut-être dans cet adverbe "bizarrement" aucune idée d'étonnement : sans doute ne convient-il d'y voir qu'une allusion à l'implantation capricieuse ("bizarre") des maisons dans "le faubourg" (par opposition avec l'alignement régulier qui prévaut dans les rues d'une ville), et plus encore quand "le faubourg" insensiblement devient "la campagne", c'est-à-dire "le Comté", avant d'élargir encore ses dimensions à "l'occident" tout entier. On se perd en conjectures sur le sens du syntagme "là encore". La critique comprend généralement "là encore" comme "là aussi" (valeur de réitération ou de renforcement de l'adverbe) : Là aussi, comme dans une belle rue de Paris, les maisons ne se suivent pas ... Telle est la lecture de Pierre Brunel : "J'interprète « là encore », écrit ce commentateur, non pas « comme dans la ville (ou les villes) précédemment décrites » mais « comme dans une belle rue de Paris »". (op. cit. p.366, n.3). Autre solution que j'envisagerais, la valeur temporelle d'"encore" : "là encore" ne voudrait pas dire "là aussi" mais "là" (dans le faubourg) "encore" (tant qu'on y est encore, tant qu'on est encore à l'extérieur de la ville, ou même : tant que la ville n'a pas encore absorbé le faubourg). Vernon Philip Underwood (cité par Albert Py) écrit : "Le « Comté », auquel l'auteur donne une majuscule et des guillemets, semble transposer l'anglais County, désignant, en général ironiquement, l'aristocratie terrienne, surtout hippomane et adonnée à la chasse... " (op. cit. p.28). J'avoue n'avoir aucune explication satisfaisante pour l'épithète "éternel" dans le syntagme "occident éternel" et n'en avoir trouvé aucune au cours de mes lectures. Pierre Brunel semble penser à la Bretagne, terre de forêts, il est vrai, et patrie des vieux romans de chevalerie :
À propos de "chassent leurs chroniques", Vernon Philip Underwood se demande si Rimbaud, par hasard, ne ferait pas allusion aux nombreuses chroniques d'Angleterre enluminées du British Museum, parmi lesquelles "le livre de chasse de Gaston Phébus, acquisition récente, était exposé en belle place au temps du séjour de Rimbaud à Londres." (ibid. p.25). Pour aussi "bizarre" que soit cette exégèse, je constate que la plupart des commentateurs la reprennent. C'est sans doute qu'ils n'en trouvent pas d'autre et il faut dire que cette interversion "chroniques de chasse" / "chassent leurs chroniques" est une idée si drôle qu'il serait bien dommage d'en découvrir une meilleure un jour prochain. Rimbaud est bien capable d'avoir voulu clore son texte sur pareil calembour pour railler les vaines tentatives d'échapper à la civilisation urbaine par les parties de campagne, l'hygiène sportive en général et de la chasse en particulier. Le mot "chronique" connote les hauts faits historiques, les historiographies royales et aristocratiques. En pratiquant la chasse, les "gentilshommes" chasseraient cette gloire dont on fait les chroniques. Ils tenteraient vainement de préserver la "sauvagerie" de leurs origines, leur ancien statut de guerriers, leur droit aux aventures et à l'héroïsme. Les nostalgies pour l'univers rural du petit-bourgeois londonien de Ville (" — notre ombre des bois, notre nuit d'été !— "), tentant de se soustraire aux "Erynnies nouvelles" en se réfugiant dans son "cottage", avaient droit à des railleries du même ordre.
|
||||
|
|