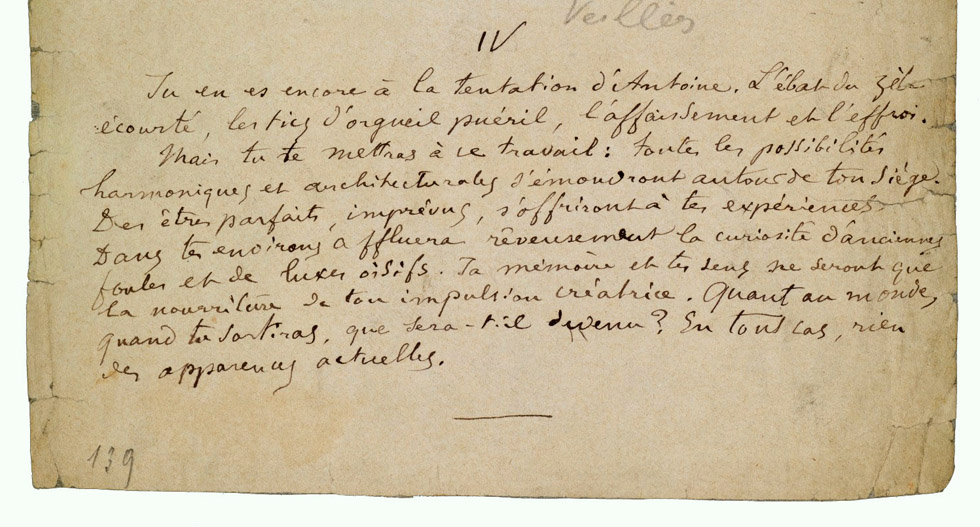| |
L'interprétation
traditionnelle de ce texte important mérite d'être interrogée. Sur
deux points essentiellement :
1) Que se reproche exactement Rimbaud au début du texte en se
comparant à saint Antoine ? Une réponse habituelle et peu
convaincante consiste à expliquer qu'il rejette par là ses anciennes
et destructrices addictions visionnaires, dont le personnage de
Flaubert serait la pathétique illustration.
2) De quelle nature est le « travail » nouveau dans lequel Rimbaud
veut s'engager pour échapper à la « tentation d'Antoine » ?
Une réponse habituelle et peu convaincante voit dans ce nouveau
projet poétique une ambition démiurgique, visant à substituer au
monde connu un monde refait à neuf.
La tentation
d'Antoine
La Tentation de saint Antoine de Flaubert a été mise en vente en
avril 1874 (cf.
la caricature de Hadol dans L'Éclipse du 12 avril 1874).
Des pages d'une version antérieure avaient été publiées de décembre
1856 à février 1857, dans L'Artiste, sous l'égide de
Théophile Gautier. Il n'est pas
impossible que Rimbaud en ait eu connaissance. En tout cas, il
connaissait Flaubert. C'est précisément dans une lettre du 18 avril
1874, donc contemporaine des Illuminations, qu'il annonce à Jules Andrieu son intention d'écrire un recueil
de poèmes en prose, à caractère historique, imitant
l'« archéologie ultrà-romanesque » pratiquée
par Flaubert dans Salammbô. Et
je le soupçonne fort d'avoir lu Bouvard et Pécuchet pour une
raison que j'explique
ici. Mario Matucci, dans son article « Rimbaud et la tentation
d'Antoine », a cité plusieurs extraits des quatre passages publiés
dans L'Artiste en montrant que leur atmosphère, leurs images
et les soliloques saccadés de saint Antoine, ne sont pas sans
évoquer tels poèmes (comme Bonne pensée du matin, Villes
[I]) ou tels passages d'Une saison en enfer.
Au début du roman de Flaubert,
Antoine est seul, dans son désert de Thébaïde, « en prière sur la
terrasse, — comme les bêtes pacifiques paissent jusqu’à la mer de
Palestine. » (Enfance IV) Mais sa méditation est interrompue par des
réminiscences de sa vie antérieure. Il évoque les ambitions et les
désirs de son jeune âge que son vœu de solitude, de rupture avec le
monde, lui interdisent à tout jamais d’espérer assouvir.
Il énumère les fonctions auxquelles il aurait pu commodément accéder
dans la société : prêtre, grammairien, philosophe, soldat,
publicain... Insensiblement, il cède aux tentations que présentent à son
esprit ces images de son passé.
Des rêves de richesse
(épisode de Nabuchodonosor) et de plaisir charnel (épisode de la Reine de
Saba), de puissance et de gloire, ne cessent de le visiter. Et
chaque fois, passé le moment de délire,
c'est « l'affaissement et l'effroi ». Il s'écrie :
Une fois de plus je me suis
trompé ! Pourquoi ces choses ? Elles viennent des
soulèvements de la chair. Ah ! misérable !
Il s'élance dans
sa cabane, y prend un paquet de cordes, terminé par des
ongles métalliques, se dénude jusqu'à la ceinture, et
levant la tête vers le ciel : « Accepte
ma pénitence, ô mon Dieu ! ne la dédaigne pas pour sa
faiblesse. Rends-la aiguë, prolongée, excessive ! Il est
temps ! à l'œuvre !
Le motif qui pousse Rimbaud
à se comparer à saint Antoine est assez facile à comprendre.
Rimbaud n'y met aucun mystère. Comme l'indique fort
bien André Guyaux (1985), ce sont les mots suivants qui
l'expliquent :
Les quatre groupes
nominaux, qui suivent le prénom dans un ordre de volumes
décroissants, illustrent la comparaison exprimée dans la
première phrase, la situation existentielle indiquée par
référence. Le zèle écourté trouvera un écho compensatoire dans le
travail, au paragraphe suivant. (p.114).
Comme
Antoine de son inconstance dans le zèle religieux, Rimbaud s'accuse
de sa chronique insatisfaction, de son tempérament velléitaire. Il se reproche son interminable quête d'identité
(sera-t-il « le saint », « le savant au fauteuil sombre », etc., ou
l'éternel « enfant abandonné » ?), ses tergiversations face au choix
d'une vie parmi toutes celles qui lui semblent dues, ses
atermoiements d'éternel adolescent face à la nécessité, à vingt ans
révolus, de choisir un état. Enfin, sans doute se
repent-il aussi de cette habitude que nous lui connaissons, nous, ses lecteurs, de ne jamais mener les choses jusqu'au
bout. Bref, il constate en lui-même cet « ébat du zèle écourté » qu'il
reconnaît dans le personnage de Flaubert.
Aussi me paraît-il tout à fait insolite qu'on réduise si souvent
les affinités de Rimbaud avec saint Antoine à leur commune addiction visionnaire.
La critique fait constamment du personnage de Flaubert l'analogue
du Voyant, tel que Rimbaud l'a défini dans sa lettre à Demeny de mai
1871, en assortissant la comparaison d'un argument des plus convenus
sur la nature supposément démiurgique du projet des Illuminations. La glose de Pierre Brunel
(2004) est parfaitement
représentative de cette tendance
:
[R. se] reproche de
n'avoir ni évolué, ni progressé : il en est encore à
la tentation d'Antoine, de saint Antoine si l'on veut. Il aspire
à être envahi de visions. De là le pas en arrière est facile à
franchir vers l'état de voyant tel que l'avait défini Rimbaud en mai
1871. Cette expérience ancienne, à laquelle il semblait avoir mis
fin en 1873, revient parfois comme une tentation, et cela suffirait
à expliquer qu'elle ait encore laissé des traces dans les
Illuminations. Rimbaud en est conscient et ce n'est pas sans une
certaine sévérité que, sur le mode du tu, il commence par
faire son autocritique (p. 599).
Le commentaire de Steinmetz dans son
édition de 1989 est plus sibyllin mais la même lecture s'y devine,
en arrière-plan :
La « tentation d'Antoine » apparaît alors
pour ce qu'elle est : un ensemble de fausses magies.
Rimbaud, décidé à tenter une nouvelle étude, se place sous
l'enseigne d'un orgueil souverain (et non plus puéril).
Assuré d'éveiller par sa seule voix un monde extraordinaire,
il veut se retirer du nôtre, comme dans Vies III et surtout
Enfance V où il se mettait au tombeau
pour affiner son rêve. (p.173).
Selon
eux, donc, en s'accusant de la même tentation que saint Antoine, Rimbaud
se reprocherait son goût persistant pour les visions, les « fausses
magies ». C'était déjà la thèse soutenue par Suzanne Bernard en
1961. La référence dépréciative aux tentations d'Antoine
équivaudrait à une critique de l'entreprise du voyant et annoncerait
l'adoption d'une nouvelle orientation poétique fondée sur le travail
créateur :
[...] il s'agit d'utiliser toutes les
possibilités harmoniques et architecturales pour faire
œuvre de création à partir des données offertes par la
mémoire et par les sens. Non pas tant, donc,
recherche de visions, d'hallucinations, que volonté
démiurgique de créer, par la magie de la poésie, un univers
neuf : et l'expression d'impulsion créatrice est
significative. Rimbaud passe, ici, du plan passif de la
Voyance au plan actif de la Poésie ; et
ποιεῖν, c'est « faire ».
Tout n'est sans doute pas faux là-dedans. Mais les visions de saint Antoine n'ont rien de
commun avec ce que Rimbaud appelle, selon les moments, des « inventions
d'inconnu », des « élans mystiques » ou des « voyages
métaphysiques ». Leur substance, tout au contraire, ce sont les
biens matériels dont ce fils de famille aisée (d'après son biographe
Athanase d'Alexandrie) s'est privé en se faisant
anachorète. Par ailleurs, Antoine n'aspire nullement « à être envahi de visions »
(Brunel), il les rejette au contraire avec
violence. Ses tentations ne sont pas identifiables à des «
recherches de visions » (Suzanne Bernard).
D'une part, donc, ces commentateurs comprennent bizarrement le personnage de
Flaubert, d'autre part, ils prêtent à l'autocritique de Rimbaud
dans ce début de Jeunesse IV une visée métapoétique, alors
qu'elle est de nature essentiellement psychologique. Elle renvoie,
comme l'écrit Guyaux, à sa « situation existentielle ». La dimension métapoétique du poème, évidente par ailleurs, viendra dans les
phrases suivantes.
Gustave Flaubert, La Tentation
de saint Antoine. Un
extrait du chapitre II.
Et bientôt se découvre sous les ténèbres une salle
immense, éclairée par des candélabres d'or.
Des colonnes, à demi perdues dans l'ombre tant elles sont hautes,
vont s'alignant à la file en dehors des tables qui se prolongent
jusqu'à l'horizon, — où apparaissent dans une vapeur lumineuse des
superpositions d'escaliers, des suites d'arcades, des colosses, des
tours, et par derrière une vague bordure de palais que dépassent des
cèdres, faisant des masses plus noires sur l'obscurité.
Les convives, couronnés de voilettes, s'appuient du coude contre
des lits très-bas. Le long de ces deux rangs des amphores qu'on
incline versent du vin ; — et tout au fond, seul, coiffé de la
tiare et couvert d'escarboucles, mange et boit le roi
Nabuchodonosor. […]
Le Roi essuie avec son bras les parfums de son visage. Il mange
dans les vases sacrés, puis les brise ; et il énumère intérieurement
ses flottes, ses armées, ses peuples. Tout à l'heure, par caprice,
il brûlera son palais avec ses convives. Il compte rebâtir la tour
de Babel et détrôner Dieu.
Antoine lit, de loin, sur son front, toutes ses pensées. Elles le
pénètrent, — et il devient Nabuchodonosor.
Aussitôt il est repu de débordements et d'exterminations ; et
l'envie le prend de se rouler dans la bassesse. D'ailleurs, la
dégradation de ce qui épouvante les hommes est un outrage fait à
leur esprit, une manière encore de les stupéfier ; et comme rien
n'est plus vil qu'une bête brute, Antoine se met à quatre pattes sur
la table, et beugle comme un taureau.
Il sent une douleur à la main, — un caillou, par hasard, l'a
blessé, — et il se retrouve devant sa cabane.
L'enceinte des roches est vide. Les étoiles rayonnent. Tout se
tait.
Une fois de plus je me suis trompé ! Pourquoi ces choses ? Elles
viennent des soulèvements de la chair. Ah !
misérable !
Il s'élance dans sa cabane, y prend un paquet de cordes, terminé
par des ongles métalliques, se dénude jusqu'à la
ceinture, et levant la tête vers le ciel :
Accepte ma
pénitence, ô mon Dieu ! ne la dédaigne pas pour
sa faiblesse. Rends-la aiguë, prolongée,
excessive ! Il est temps ! à l'œuvre !
Il s'applique un cinglon vigoureux.
Aïe ! non ! non ! pas de
pitié !
Il recommence.
Oh ! oh ! oh ! chaque coup me
déchire la peau, me tranche les membres. Cela me
brûle horriblement !
Eh ! ce n'est pas terrible ! on s'y fait. Il me
semble même...
Antoine s'arrête.
Va donc, lâche ! va donc !
Bien ! bien ! sur les bras, dans le dos, sur la
poitrine, contre le ventre, partout ! Sifflez,
lanières, mordez-moi, arrachez-moi ! Je voudrais
que les gouttes de mon sang jaillissent
jusqu'aux étoiles, fissent craquer mes os,
découvrir mes nerfs ! Des tenailles, des
chevalets, du plomb fondu ! Les martyrs en ont
subi bien d'autres ! n'est-ce pas, Ammonaria ?
L'ombre des cornes du Diable reparaît.
J'aurais pu être attaché à la
colonne près de la tienne, face à face, sous tes
yeux, répondant à tes cris par mes soupirs ; et
nos douleurs se seraient confondues, nos âmes se
seraient mêlées.
Il se flagelle avec furie.
Tiens, tiens ! pour toi !
encore !... Mais voilà qu'un chatouillement me
parcourt. Quel supplice ! quels délices ! ce
sont comme des baisers. Ma moelle se fond ! je
meurs !
|
Antoine était
Nabuchodonosor et Nabuchodonosor, qu'il avait rêvé, était Antoine. Qui n'était
autre que Gustave, pour la même raison. Cela ne vous
rappelle pas quelque chose ?
L'ambition démiurgique
« Tu te mettras à ce travail ». De quel travail s'agit-il ? Je
suis assez d'accord avec la définition iconoclaste que Michael Bishop en
propose, lorsqu'il dit qu'il n'est plus question ici de « poème » ni
d'« œuvre » :
J'ajouterai, pour conclure, que ce "travail"
dont parle Jeunesse — il ne s'agit plus d'"œuvre",
de poème — ce travail auquel Rimbaud réfléchit (travail, action à
partir d'une fatigue, d'une souffrance, travail de "rédemption" de
la part d'un homme qui ne peut s'empêcher de croire qu'il y a mal,
rachat, salut : toute une théorie apprise de ce qui pèse sur
l'innocence de l'existence), ce travail, mental, psychique surtout,
repossibilise, possiblement — tout est projet, "future Vigueur" —
la structure et le rythme de tout ce qui est. Il s'agit, il
s'agirait d'un travail mettant en mouvement transformations et
transfigurations de toutes sortes, motions et émotions d'"êtres
parfaits, imprévus" que, d'ailleurs, on n'est pas obligé de
chercher : tout s'offre, "s'ém[eut] autour de ton siège" ;
tout — perfection, harmonie, faisabilité inimaginable — tout est
déjà là, prêt à se révéler. Il ne s'agit pas d'une
psychologie/ontologie de la passivité, mais plutôt de
l'ouverture, de la disponibilité ontique, du consentement et de
la confiance
Enfance V
représente par excellence la fable du poète démiurge. Et du poème
comme activité compensatoire et réponse à la mélancolie. « Aux heures d'amertume,
écrit Rimbaud, je m'imagine des boules de
saphir, de métal. Je suis maître du silence. » Ces « boules
de saphir, de métal » sont les inventions qui, au sein du monde recréé par le
poète dans son « salon souterrain », suppléent poétiquement à l'occultation des
« lunes » et des « comètes ».
Force est de reconnaître que d'Enfance V à Jeunesse IV,
le caractère actif de la création poétique s'est estompé et a laissé
la place à une méthode nettement plus passive.
Ici, le poète ne dit plus « je m'imagine ». C'est de leur propre mouvement que les «
possibilités harmoniques et architecturales » s'émeuvent
« autour » du « siège » du poète, que « des êtres parfaits,
imprévus, s'offrent à [ses] expériences », que
« d’anciennes foules » et des « luxes oisifs »
affluent
« rêveusement », c'est-à-dire, me semble-t-il comme dans un rêve
et non pas « en rêvant ». C'est le poète qui rêve : pour
quoi et de qui les « luxes oisifs » rêveraient-ils ? C'est ainsi que
le comprend, par exemple, Antoine Fongaro :
Autour de lui ("tes
environs") le rêve ("rêveusement") fera affluer, dans ses
visions, des foules d'autrefois (voir, par exemple, la fin de
Villes II) ou des milieux luxueux (voir, par exemple, Villes
I, avec ses nababs, les divans de velours rouge, les boissons
polaires).
(« Un
brelan de "veillées" », Rivista di Letterature
moderne e comparate, ott.-dic. 2013, p.320).
On a beau répéter à l'envi, du côté de la
critique, que le « travail » créateur thématisé par les
Illuminations s'oppose par son caractère actif au caractère
passif des « visions », Bishop a beau nous assurer qu'il ne faut pas voir dans ces éléments un indice de
passivité ... cela y ressemble quand même beaucoup. On a plutôt
affaire à un rêveur, assumé comme tel, qu'à un démiurge.
Du coup, même si on ne l'approuve pas, on peut comprendre que Berrichon, en 1912, ait
déplacé Jeunesse IV pour en faire une
quatrième section de Veillées. C'est probablement à cette
occasion qu'une main, qui ne serait pas la sienne, d'après les experts, a indiqué le mot « Veillées » sur le manuscrit juste à côté
du « IV » de Jeunesse. Outre les atmosphères
oniriques des deux textes, Berrichon avait sans doute perçu
de fragiles correspondances entre les « êtres parfaits, imprévus » de Jeunesse IV et
les « groupes sentimentaux avec des êtres de tous les caractères
parmi toutes les apparences » de Veillées II, entre les « possibilités harmoniques et architecturales » de Jeunesse IV
et les « élévations harmoniques » issues des jeux de la lumière dans
la « salle » de la veillée.
Il est vrai que Rimbaud parle aussi d'« expériences »,
d'« impulsion créatrice », formules par lesquelles il
assume
le rôle actif de l'« inventeur ». Mais le sens des
phrases où il lève un peu le voile sur la nature de son mystérieux
travail créatif pose de sérieux problèmes d'interprétation :
Des êtres parfaits, imprévus, s'offriront
à tes expériences. Dans tes environs affluera rêveusement la
curiosité d'anciennes foules et de luxes oisifs.
Comment comprendre : « la curiosité
d'anciennes
foules » ? Les foules sont-elles curieuses de la création
du poète, affluent-elles autour de son siège comme on va observer le
travail des maçons dans un chantier voisin, pour découvrir le monde
refait à neuf qu'il est en train d'édifier ? C'est un sens possible.
Mais, dans le syntagme « l'amour de Dieu », Dieu peut aussi
bien, selon les contextes, apparaître comme le sujet ou comme
l'objet de l'action d'aimer. Ainsi, dans le syntagme « la curiosité
d'anciennes foules et de luxes oisifs ». on pourrait accorder aux
noms compléments (« foules », « luxes ») la fonction de l'objet dans
le procès induit par le nom « curiosité ». C'est-à-dire comprendre :
''d'anciennes foules et des luxes oisifs curieux à observer
afflueront autour de mon siège''. Ces foules (populaires) du passé
(anciennes) et ces (riches) oisifs feraient dès lors leur
apparition, non pas en rêvant mais dans le rêve du poète, selon la
modalité décrite par Rimbaud dans Veillées II :
« Rêve intense et rapide de
groupes sentimentaux avec des êtres de tous les caractères parmi
toutes les apparences. »
À quelles « expériences » le poète se livre-t-il
avec ces foules anciennes pour y susciter
d'imprévisibles et « imprévus » « êtres parfaits » ? Je ne vois de réponse
que dans son intérêt bien connu pour l'histoire et
pour ses révolutions, qu'il manifeste notamment dans la lettre
à Jules Andrieu, contemporaine des Illuminations,
récemment retrouvée. On aurait donc affaire
ici au poète sentinelle de Soir historique, à « l'être
sérieux » et à l'historien, plutôt qu'au fameux démiurge promu par la tradition
critique.
| L'Histoire splendide
d'après Rimbaud et d'après Delahaye
Dans une lettre datée "London, 16 April 74", Rimbaud expose à Jules
Andrieu le projet d'un recueil de "poèmes en prose" "avec
titre : L’Histoire splendide",
à paraître "en livraisons" (c'est-à-dire en feuilleton) dans la
presse anglaise. Il semble que ce soit la reprise d'un ancien projet
intitulé L'histoire magnifique dont Delahaye a parlé en 1923,
dans
Rimbaud, l'artiste et l'être moral, et dont il situait les
premiers essais "vers la fin de l'hiver de 71-72" :
"C'est
vers la fin de l'hiver de 71-72. Il me parle d'un projet nouveau
— qui le ramène aux poèmes en prose essayés l'année précédente,
veut faire plus grand, plus vivant, plus pictural que Michelet,
ce grand peintre de foules et d'actions collectives, a trouvé un
titre : L'histoire magnifique, débute par une série qu'il
appelle la Photographie des temps passés. Il me lit
plusieurs de ces poèmes (qui n'ont pas reparu jusqu'à présent :
peut-être en les cartons de collectionneurs jaloux). Je me
rappelle vaguement une sorte de Moyen âge, mêlée rutilante à la
fois et sombre, où se trouvaient les "étoiles de sang" et les
"cuirasses d'or" dont Verlaine s'est souvenu pour un vers de
Sagesse ; avec plus de netteté je revois une image du XVIIe
siècle, où le catholicisme de France paraît à l'apogée de son
triomphe, et qu'il condensait, il me semble, en un personnage
splendidement chapé et mitré d'or, se détachant sur une scène
dont cette seule lecture ne peut m'avoir laissé de souvenir
précis."
Ce sera, explique Rimbaud à Jules Andrieu, une évocation de
"l'histoire splendide" (c'est-à-dire épouvantable, en "style
négatif"), à travers "des dates plus ou moins atroces : batailles,
migrations, scènes révolutionnaires", et par des procédés
descriptifs relevant de l'"archéologie ultrà-romanesque" pratiquée
par Flaubert dans Salammbô. Autrement dit : l'expression
romancée des leçons terribles que sa lucidité de "double-voyant" (sa
vue pénétrante, ses dons de prémonition, ses pouvoirs prophétiques)
a tirées de la Commune et de sa répression sauvage par des bourgeois
apeurés. Ou encore, pour reprendre une expression du texte : "la
(magnifique) perversion" de la représentation courante de
l'histoire, la subversion de cette conception romantique, naïve ou
intéressée, qui voit l'histoire comme une marche imparable de
l'humanité vers l'entente universelle, la solution de la question
sociale, l'harmonie, le bonheur.
Il s'agit, explique Rimbaud à son correspondant, d'un projet "tout
à fait industriel", conçu dans un esprit de "réclame frappante", un
"bazar moral" à "exploiter", une "spéculation sur l'ignorance où
l'on est maintenant de l'histoire". Ce "boniment" du littérateur en
faveur d'un "ouvrage" dont "les heures destinées à [sa] confection
[lui] apparaissent méprisables" rappelle assez le style
auto-dépréciatif du locuteur de
Solde.
C'est que Rimbaud, comme le poète-voyant-bonimenteur de
Solde, sait d'expérience que la société n'est pas preneuse des
visions (d'histoire) qu'il a présentement à lui vendre, que "la
foule, qui ne s'occupa jamais à voir, qui n'a peut-être pas besoin
de voir" (car elle agit d'instinct et c'est aveuglément qu'elle
laisse libre cours à ses "révoltes logiques",
à l'"enharmonie des fatalités populaires"), que "les masses", comme
il dit encore dans Solde, n'ont cure des "morceaux de
bravoure historiques" qu'il se propose malgré tout de soumettre à
leur méditation.
|
« Quant au monde, quand
tu sortiras, que sera-t-il devenu ? »
Personnellement, je comprends : "Quand tu sortiras (ce labeur comblé) de ta petite chambre de poète,
dans quel sens le monde extérieur aura-t-il changé ?" Parce qu'il
aura changé, c'est certain.
De quel endroit est-il question de
« sortir », ici ? Du « salon souterrain » d'Enfance V,
du lieu retiré où se trouve le « siège » de l'inventeur et
où il aura rêvé un univers refait à neuf. Le monde qui s'offrira
à lui lorsqu'il quittera son siège, c'est le
monde extérieur, et Rimbaud conjecture que, pendant le temps qu'il aura consacré
à se forger un monde imaginaire dans le creuset du poème, le monde réel, de son côté,
aura continué à changer et perdu ses « apparences actuelles ». Quoi
de plus simple ? Une façon de plus de suggérer ce que Bishop appelle
sa « disponibilité ontique ». Je dirais plutôt, en reprenant les
mots du critique, son « consentement » au réel et sa « confiance »
dans le Génie de l'humanité.
Mais la tradition critique voit les
choses de façon beaucoup plus sophistiquée :
Guyaux : « Un déplacement a lieu à ce
moment, vers le monde [...] On
devinait auparavant, grâce à des mots tels que siège, un
espace limité. La question finale élargit cet espace et prévoit même
d'en sortir.
Autrement dit, ce n'est pas de sa petite chambre
de poète que Rimbaud sortirait, mais du monde.
Guyaux (suite) : L'espace prévu s'opposera implicitement au premier,
dont les êtres parfaits et les luxes oisifs
illustraient les apparences actuelles, lesquelles n'auront plus lieu
d'être. [...] Le véritable refoulement est celui du monde extérieur, réduit [...] à émaner de
l'impulsion créatrice personnelle [...] » (p.115).
J'avoue que je ne comprends rien à ces espaces
gigognes, sauf que le monde réel, d'après Guyaux, a été aboli. J'ai
l'impression que Guyaux reçoit le texte comme s'il voulait dire : « Quant
au monde [personnel que tu es en train de créer], quand tu [en]
sortiras, que sera-il devenu [deviendra-t-il] ? En tout cas, rien de
[ses]
apparences actuelles, [avec ses
êtres parfaits et ses luxes oisifs]. » Mais ce n'est pas du tout ce qui est écrit.
Brunel (2004) : « La fin
d'un monde. [...] Nulle part peut-être Rimbaud ne s'est autant
avancé dans l'annonce d'une sortie [...] du monde connu pour
accéder, non comme Baudelaire, à l'Inconnu, mais à un monde voulu.
Certes, des éléments irrationnels seront intervenus, et une autre
raison est à l'œuvre. Mais le résultat, "en tout cas" et dans tous
les cas, sera la disparition du monde réel, qui n'est que l'amas des
"apparences actuelles", au profit d'un monde nouveau que Rimbaud, du
moins pour l'instant, nous laisse à imaginer. » (p.600).
Ainsi, donc, Rimbaud
annoncerait, à la fin de Jeunesse IV, sa sortie du monde
connu et la substitution à ce dernier d'un autre monde. Non, le
« monde » dont il est question ici n'est pas, comme le dit Brunel,
une « création nouvelle » (p.599) émanant de
l'impulsion créatrice du « nouveau démiurge » (ibid.). Si tel
était le cas, le poète ne se poserait pas la question : « que
sera-t-il devenu ? » Il le saurait, puisque c'est lui qui
l'aurait créé. C'est tout simplement le monde
extérieur, la réalité
extérieure, que Rimbaud retrouvera « quand [il] sortira »
du lieu du poème. Mais cette réalité, le temps ayant continué à
s'écouler pendant qu'il construisait son œuvre,
aura nécessairement perdu ses « apparences actuelles ». Le monde
aura changé, non du fait du poète, mais de son propre mouvement. C'est une vérité de La Palice. Sauf,
il est vrai, que par cette simple question : « Quant au
monde [...] que sera-t-il
devenu ? », Rimbaud ouvre le champ des possibles. Il se
rend disponible à « l'imprévu ». Il suggère la
possibilité d'un scénario analogue à celui de Jeunesse II.
L'hypothèse d'un
« double événement d'invention et de succès » ayant changé
les « apparences actuelles » du monde dans la même
direction que celle illustrée par le poème (la mise en oeuvre de
« toutes les possibilités harmoniques et architecturales », la
génération d'« êtres parfaits », etc.). Cela, grâce à la conjonction du
désir individuel de l'auteur et d'un mouvement « imprévu » des
« foules », grâce à la conjonction du « travail » du poète et du
« travail » de l'histoire.
|