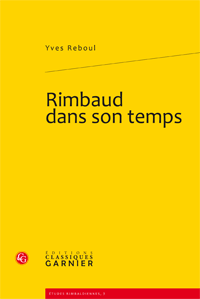 |
À PROPOS DE « BARBARE OU L'ŒUVRE FINALE », D'YVES REBOUL
Yves Reboul vient de publier chez Garnier un ouvrage intitulé
Rimbaud dans son temps (2009) qui regroupe d'excellents commentaires
de textes rimbaldiens. Les uns sont connus depuis longtemps (comme le
célèbre article sur L'Homme juste, les études novatrices
consacrées à Michel et Christine ou Les Mains de
Jeanne-Marie), d'autres sont plus récents, parmi
lesquels je signale notamment de remarquables exégèses de Mystique
ou Being
Beauteous. |
||
Yves Reboul, « Barbare ou l'œuvre finale », Rimbaud dans son temps, Classiques Garnier, 2009, p. 360-378.
|
BARBARE : UN ADIEU AU DRAPEAU ?
Barbare
est un de ces poèmes de Rimbaud qui ont coutume de recevoir les
interprétations les plus discordantes et sont à l’origine d’un véritable
« désespoir critique » (comme dit Atle Kittang, Discours et Jeu,
p.13). Pour nourrir l'espoir de surmonter un jour ce noir chagrin, il
faudrait au moins pouvoir observer un certain progrès
dans l’élucidation de ces textes, progrès dont le meilleur indice serait une
convergence croissante entre les analyses des spécialistes. Sous ce
rapport, l’étude de Barbare incluse par Yves Reboul dans son
livre est
moyennement encourageante : certaines idées semblent faire de plus en
plus consensus mais l’accord paraît encore loin d'être réalisé sur la
signification générale de l'œuvre. 1) La lecture proposée par Yves Reboul Le poème, nous dit Reboul, est une « rêverie » (p.374) :
Le mot « imagine » est mis en valeur par des italiques, pour signifier que le pavillon est un spectacle vu en imagination : « une chose vue (même fantasmatique) » (p.362). Et cette « chose » ne peut être que le drapeau rouge des révolutionnaires : « Ce pavillon en viande saignante, c’est bien entendu le drapeau rouge dont le locuteur, depuis le lieu fictivement retiré d’où il nous parle, fait le rêve, ancien chez lui (les vieilles fanfares) mais aussitôt réduit à néant, de le voir déployé jusqu’aux extrémités du monde − et donc jusqu’aux mers glacées qui recouvrent le pôle arctique. » (p.367-368) Pourquoi : « aussitôt réduit à néant » ? À cause de la parenthèse : « elles n’existent pas ». L’idée principale du commentaire est que le texte se divise en deux parties opposant deux visions distinctes. L’une renvoie à la fois à un passé qui s’éloigne (« Bien après… », « loin de… ») et à un horizon inaccessible. L’autre est un rêve qui prend son essor et paraît à portée de main (« Et là, les formes, les sueurs, les chevelures, … Etc. »). « L’opposition d’un lointain inaccessible et d’un proche investi par l’affectif tend à structurer l’ensemble de Barbare » (p.365). La première partie du poème, dédiée à la vision du « pavillon », évoque le rêve inaccessible dont le locuteur se sent de plus en plus distant, dont il se déclare « remis » comme on le dirait d’une maladie. Il s'agit du rêve de la révolution. La seconde partie, celle qui s’ouvre au cinquième alinéa avec le mot « Douceurs ! », change radicalement le ton et le sens du texte parce qu’elle substitue à la mélancolie de la perte (le « congé » signifié par Rimbaud à son ancien Moi) l’euphorie liée à la révélation d’une nouvelle raison de vivre et d’espérer, d’un nouvel espace ouvert à son désir : le monde réel, « l’immensité de l’univers » dont parle Génie, célébrés à travers la figure christique du « cœur terrestre éternellement carbonisé pour nous ». Cette figure n’a rien de religieux mais fonctionnerait dans le texte comme « une allégorie de la Vie et de l’Univers lui-même » (p.373), bientôt relayée par une imagerie sexuelle, sorte d’épanouissement orgastique, qui a la même signification : « car le sexe est partie prenante de cette générosité, de cette vie infinie (Génie) du monde que symbolise le cœur terrestre » (p.374). Le retour du « pavillon » à la fin du poème signifierait, dans ce cadre, le retour du balancier vers les errements du passé, l’hésitation persistante du poète entre le pavillon et le monde, le premier symbolisant l’espérance de chimériques révolutions poétiques, politiques, sexuelles, le second, celui de voir « le plaisir érotique […] conquérir, jusqu’aux extrémités du monde, l’espace sur lequel sa rêverie de naguère, dont il se dit remis, avait pensé voir flotter le pavillon en viande saignante » (p.375). Il y a là d’abord, nous dit Reboul, une véritable « morale du plaisir amoureux » (cf. le motif de « la voix féminine », p.377), et plus encore : une célébration matérialiste et païenne du monde, espace ouvert à l’homme et propice à la satisfaction érotique (voire, au bonheur), clé d’un avenir réconcilié, qui s’oppose donc en tous points à cette libido morbide de la révolte dont le « pavillon » était le symbole.
En reprenant à son compte certaines solutions déjà proposées (voir dans ce site la page consacrée au panorama critique du poème), Yves Reboul en conforte l’autorité :
Un bilan personnel :
les termes « saisons », « anciens assassins », « vieilles retraites »,
« vieilles fanfares d’héroïsme » sont interprétés comme des allusions à
des événements de la vie de Rimbaud ou à des aspects bien connus de sa
personnalité, en se fondant sur la présence de ces mots dans d’autres
passages de l’œuvre où ils paraissent avoir un sens voisin : Matinée
d’ivresse, Chanson de la plus haute tour (pour « retraites »),
Bannières de mai, Adieu (pour « saisons »). Quant aux
« flammes », elles « pourraient renvoyer à Qu'est-ce pour nous mon
cœur… (« Ça nous est dû. Le sang ! Le sang ! La flamme d'or ! ») »
(p.373; n.1). Le locuteur est, sans
précaution oratoire, désigné sous le nom de Rimbaud. Le sens du texte
est résumé par les expressions : « poème de bilan », « congé poétique ».
Ainsi que la plupart des analystes antérieurs, donc, (Claisse, Brunel,
notamment), Reboul considère Barbare comme un témoignage sur la
disposition d’esprit dans laquelle se trouve l’auteur au moment où il
rédige le texte. Pavillon de viande saignante = drapeau rouge : Richard, Claisse, Steinmetz, Brunel, Murphy, Reboul acceptent peu ou prou l'assimilation du "pavillon" à un drapeau : un drapeau rouge, sanglant. Jean-Pierre Richard écrit par exemple :
Mais cela ne règle évidemment pas la question de
la valeur
symbolique de l'image, qui dépend du sens accordé par chacun au texte dans son
ensemble. Nous y reviendrons.
Une maladie surmontée :
le terme « remis » est interprété par Reboul, à l’exemple de ses
prédécesseurs (Claisse, Brunel, notamment), comme un constat de
convalescence : Rimbaud aurait surmonté une maladie l’ayant affecté dans
le passé. À leur exemple encore, il estime cette guérison confirmée par
la tonalité voluptueuse du dénouement du poème (je souligne d’autant
plus cette opinion convergente que, personnellement, je ne la partage
pas : voir mon
commentaire).
Une évocation érotique :
on retrouve dans l’article de Reboul la glose érotique avancée pour
« les larmes blanches, bouillantes » par Steinmetz (qui, en 1973,
parlait d' « éjaculation »), par Fongaro, Claisse (et d’autres). Il y aurait sans doute, aujourd’hui, un accord assez
large pour considérer l’avant-dernier paragraphe de Barbare,
voire les précédents,
comme la description plus ou moins cryptée d’un orgasme (Steinmetz
voyait même le « pavillon » comme un « vagin »). Une « œuvre finale » : Reboul reprend ici, au nom d’arguments qui lui sont propres, une hypothèse formulée par Michel Murat selon laquelle Rimbaud aurait conçu Barbare comme un poème de clôture pour les Illuminations. Cette hypothèse indémontrable mais qui a pour elle une certaine logique découlerait des observations faites par Steve Murphy concernant la numérotation des 24 feuillets confiés par Rimbaud à Verlaine lors de leur rencontre de février 1875 à Stuttgart. Cependant, Murphy n'a jamais dit que les 24 feuillets numérotés représentaient un ensemble achevé. Un grand nombre d'Illuminations (toutes celles qui figurent après Barbare dans les éditions courantes) ne sont pas incluses dans cette pagination alors qu'elles existaient déjà, très probablement, au moment où Rimbaud (en compagnie de Germain Nouveau) a procédé à une mise au net de son manuscrit. On peut donc penser que Rimbaud aurait placé ces feuillets non-numérotés à la suite de Barbare, s'il avait mené jusqu'au bout la préparation de son manuscrit. En tout cas, il parait opportun de rester prudent sur ce chapitre, plus prudent que je ne l'ai été moi-même dans mon commentaire de 2007.
3) Des divergences persistantes De quel genre de drapeau rouge parle-t-on ? Pour Reboul, il s’agit du drapeau des révolutionnaires. Murphy avait déjà formulé cette hypothèse à plusieurs reprises :
Quelle expérience existentielle, quelle réalité psychologique se cache dans les plis du rouge pavillon ? Ces différents drapeaux ont en commun de symboliser une disposition héroïque à la lutte, à l’aventure, à la conquête, au sacrifice. Or, l’héroïsme sacrificiel du poète, clairement comparé à celui des martyrs de la Commune, est un thème récurrent chez Rimbaud depuis la lettre à Demeny de 1871 ...
... jusqu’à Matinée d’ivresse :
Sans compter que le thème du sacrifice est fréquemment associé à des
évocations sodomitiques chez Verlaine et Rimbaud (mais peut-on aller
jusque là en parlant de Barbare ? Je n'en suis pas sûr !). En
tout cas, la contradiction entre les divers exégètes
me paraît ici relativement surmontable. Comme je l’ai suggéré dans mon
commentaire, Rimbaud pourrait avoir conçu cette image du
« pavillon en viande saignante » comme un symbole polyvalent de la quête
périlleuse de
l’Inconnu, sous toutes ses formes.
Le drapeau rouge et ce qu’il représente sont-ils pour le locuteur objets
de désir ou de rejet ?
Ici,
Reboul s’écarte de ses prédécesseurs. Pour tous, me
semble-t-il, le « pavillon » exerce un attrait irrésistible sur le
locuteur, il est régénérateur, il est l'antidote à la maladie. Brunel,
très proche, ici, de Claisse, écrit par exemple : « il a la couleur du
sang cru, il est l'emblème d'une cruauté régénératrice » (p.512). Reboul,
au contraire, fait du « pavillon en viande saignante » le
symbole du même passé que celui des
« vieilles flammes », des « vieilles fanfares d’héroïsme » et
des
« anciens assassins », en vertu de quoi il l'identifie à la
maladie elle-même, celle dont le locuteur se dit « remis ». Sur ce
point, j'aurais tendance à lui donner raison. Mais faut-il en conclure
que le « pavillon », c’est-à-dire le rêve ancien et morbide du locuteur,
n’exerce plus aucun attrait sur lui ? Ou qu'il n’exerce plus
qu’un attrait très affaibli, en train de céder la place à une
libido de substitution ? Je n’en crois rien, car j’accorde spontanément
au poème la signification exactement inverse. Mon hypothèse est qu’on y
assiste au retour en force du passé, ce en quoi je ne suis en phase ni
avec les uns, ni avec les autres ! Le « pavillon en viande saignante» et « la voix féminine arrivée au fond des volcans » sont-ils deux rêves distincts de polarités opposées ? C’est la grande idée de Reboul : deux parties contrastées, deux visions opposées. Il diverge sur ce point aussi, je crois, de tous ses prédécesseurs qui perçoivent plus ou moins explicitement le poème comme un glissement continu d’une image dans une autre (l’épiphanie du pavillon/l’éruption féerique/l’extase orgastique) dans le cadre d’une vision évolutive mais unitaire. C’est sur cette perception binaire de la structure du poème que repose sa thèse selon laquelle Barbare serait un poème de l’Adieu, un « congé poétique ».
4) 5 arguments contre la thèse de l’adieu au drapeau Ponctuation. On constatera d’abord l’absence totale de ponctuation à la fin du quatrième alinéa, c’est-à-dire au moment où le mot « Douceurs ! » fait, selon Reboul, basculer le texte. De cette absence de virgule, on peut conclure que c’est l’apparition (ou la réapparition) du « pavillon en viande saignante » qui suscite dans l’esprit du rêveur un soudain sentiment d’euphorie, avant même que ne se déclenchent les rafales de givre et les éruptions volcaniques. Il n’y a donc pas, d’un côté, une vision sinistre et désabusée (le « pavillon ») et de l’autre, une vision délicieuse et attirante (le fantasme érotique). Ce schéma en antithèse ne correspond pas au scénario réel du texte.
Le décor arctique
du poème. Reboul trouve erronée
la lecture spontanée du texte :
« Contrairement
à ce qu'on a cru et dit,
le pôle n'est pas le lieu du poème » (p.364). « Ce serait se tromper
radicalement que d'imaginer, par exemple, que le but de Rimbaud est
d'évoquer un paysage arctique » dont le « pavillon en viande saignante »
ferait partie (p.364). Ce qui ne l'empêche pas
d'écrire, deux pages plus loin, que le poète imagine le pavillon
« déployé sur la soie des mers et des fleurs arctiques » (p.366). La valeur des propositions relatives en incise. Pour Yves Reboul, comme pour les autres commentateurs du poème, celui qui dit « je » dans le texte est véritablement détaché de son passé. Est-ce si sûr ? Ne pourrions-nous pas envisager, au contraire, que l’apparition du « pavillon en viande saignante » dans le cerveau halluciné du locuteur soit le symptôme d’une récidive, qu'elle signifie le réveil du mal dont ce locuteur se croyait « remis ». Reboul ne soupçonne pas que les trois petites propositions relatives en incise des troisième et septième alinéas (« qui nous attaquent la tête et le cœur », qu’on entend, qu’on sent ») pourraient avoir pour unique fonction d’alerter le lecteur sur cette éventualité et de l’avertir ainsi du sens profond du texte comme récit d’une récidive. Ou plutôt si, il le soupçonne ! Et c’est bien pour anticiper cette possible objection à sa thèse qu’il croit nécessaire d’affirmer sans preuve le rôle anecdotique de ces propositions relatives dans l’économie du récit :
Eh bien, je crois qu'ici
encore
le critique se trompe.
Lorsqu’un bon conteur signale, comme en passant, une possible complication (pour reprendre la terminologie de Greimas), c’est que
cette complication va jouer un rôle essentiel dans le
conte. Si
Rimbaud nous informe que ses « vieilles fanfares d’héroïsme » attaquent
encore sa tête et son cœur, c’est précisément que le poème est, essentiellement, le récit d’une de ces
attaques. Le sens littéral du premier alinéa. La vision du poème (unitaire dans son principe même si elle est évolutive, comme sont les rêves), commence par une image sanglante et s’achève dans une voluptueuse apocalypse. Cette apocalypse est annoncée dès le premier alinéa : « Bien après les jours et les saisons, et les êtres et les pays, » Est-ce à dire, se demande Yves Reboul au sujet de cet incipit, que le locuteur est projeté « au-delà de l’espace et du temps comme on a pu le croire ? ». Une note fait référence ici à Pierre Brunel (Éclats de la violence, José Corti, 2004, p.505). « C’est peut-être l’impression que Rimbaud a voulu donner », concède-t-il. Le mot « impression » est mis en relief par des italiques. Cependant, « ce n’est pas d’abolition du temps qu’il s’agit mais, plus simplement, d’un retrait par rapport aux temps que le locuteur a traversés » (p.363). J’aurais à redire au concept d’ « impression ». Rimbaud ne cherche pas seulement à donner l’impression d’une fin des temps et du monde (comme on pourrait le dire d’une fausse piste, introduite par jeu pour tromper le lecteur). Il dit, il affirme que c’est la fin des temps, qu’il voit la fin du monde : l’emploi de l’article défini (« les jours », « les saisons », « les êtres », « les pays ») ne laisse aucun doute sur le sens littéral du syntagme. Bref, il se voit parvenu à cette heure dernière qui, dans le Mythe (chrétien notamment), s’appelle une apocalypse. Et, comme le poème va s’achever par un déchaînement de forces élémentaires qui correspond en tous points à l’imagerie de la fin du monde, motif récurrent chez Rimbaud et dont on connaît la signification symbolique, tout à fait en accord avec le symbole du drapeau rouge, il me paraît suspect que Reboul ne retienne pas cette interprétation comme l’un des sens, à tout le moins, de ce premier alinéa. Cela ne veut pas dire que l'interprétation biographique préférée par Reboul soit fausse. La suite du texte la valide. Les deux sens, donc, coexistent, ce qui n'a en soi rien d'invraisemblable, venant de Rimbaud. Car, comme le dit fort bien André Guyaux dans l’introduction de son édition des Œuvres complètes dans La Pléiade : « Le double sens est son langage » (op.cit. p. XXXV). Les rapprochements intertextuels. La deuxième partie du poème présente donc une tonalité plus ambiguë, moins simplement idyllique, que ce que veut bien en dire Yves Reboul. Elle débouche sur un orgasme, certes. Mais c’est aussi une sorte de fin du monde : le ou les corps semblent flotter dans l’espace, réduits à des « formes », morcelés, comme démantelés. Par cet aspect de son métaphorisme, la fin de Barbare n’est pas sans rappeler ces cataclysmes naturels qui servent fréquemment de dénouement dans les poèmes de Rimbaud : l’éruption volcanique (Qu’est-ce pour nous mon cœur ...), le Déluge (Après le Déluge), « le moment de l'étuve, des mers enlevées, des embrasements souterrains, de la planète emportée, et des exterminations conséquentes » (Soir historique). Tandis que, par son autre aspect (son versant érotique), la vision ultime de Barbare fait plutôt penser à ces « bravoures » amoureuses qui concluent Dévotion ou Métropolitain, sur fond de « chaos de glace et de nuit du pôle » (Après le Déluge). Or, ces deux pistes métaphoriques ne sont pas du tout incompatibles. L’une et l’autre ont en commun une idée de bataille ou de révolte. Ce sont, pourrions-nous dire pour faire chic, des métaphores agonistiques. Lorsque le contexte permet de leur supposer une portée politique, ce qui est souvent le cas, on peut aller jusqu’à y voir des allégories de la révolution, de l’émeute et de sa répression. Il serait bien étonnant qu’il en soit autrement dans Barbare. On m’opposera que, dans ce poème-ci, l’euphorie et l’extase l’emportent de loin sur la tonalité tragique qu’on est en droit d’associer à l’idée du conflit et de la destruction. C’est vrai. Mais le lecteur notera que dans plusieurs des références précédemment citées, le thème agonistique ne contredit nullement une certaine effervescence libidinale. Dans Après le Déluge et Soir historique, c’est explicitement d’un désir d’apocalypse qu’il s’agit, dans Dévotion ou Métropolitain, d’un phantasme d’étreinte amoureuse. L’exemple de Métropolitain est particulièrement significatif car, comme le rappelle Reboul, ce texte précède immédiatement Barbare dans le manuscrit des Illuminations (Barbare trouve place sur le feuillet 24, juste au-dessous de la fin de Métropolitain). Steve Murphy note de son côté à ce propos :
Or, le motif érotique qui sert de conclusion à Métropolitain revêt à l’évidence une signification socio-politique. Le locuteur s’y débat avec une mystérieuse entité féminine, symbole probable de la force virile du poète (« Elle […] ta force ») au milieu d’une explosion de couleurs (« neige », « vertes », « glaces », « noirs », « bleus », « pourpres ») où l’on voit s’agiter des « drapeaux noirs » brandis au « soleil des pôles ». Dans le contexte, cette décharge de violence se laisse interpréter comme la revanche imaginaire du « métropolitain » contre la Ville qui lui refuse les richesses de ses « boulevards de cristal » (§1) et séquestre derrière les « grilles » de ses « parcs » ces « atroces fleurs qu’on appellerait cœurs et sœurs », autres objets de séduction et d’interdit (§4). Il est un autre texte avec lequel Barbare paraît entretenir une affinité secrète : Qu’est-ce pour nous mon cœur... (Reboul formule d'ailleurs lui aussi, ponctuellement, cette hypothèse de filiation, à propos du mot « flammes », comme je l'ai déjà mentionné ci-dessus). Ainsi que Barbare, ce poème de 1872 se présente comme une songerie déclenchée par une vision sanglante (des « nappes de sang »), face à laquelle le locuteur exprime d’abord sa lassitude de la destruction (des « braises », des « meurtres », des « vengeances ») : « Qu’est-ce pour nous, mon cœur que ces nappes de sang […]. Rien ! » Puis il se reprend : « Mais si, toute encore, nous la voulons... » (la vengeance), ce qui l’entraîne jusqu’à l’insurrection et l’expose à la répression. C’est alors que le locuteur et ses « romanesques amis » sont engloutis par une planète en fusion (« Sur moi de plus en plus à vous ! La terre fond »). On ne peut certes pas parler de délire orgastique mais, enfin, c’est bien une sorte de transe qui saisit le sujet, où semblent entrer à parts égales le vertige collectif de l'émeute et l’euphorie d’un destin partagé. Barbare commence et finit à peu près de la même manière. Le sujet commence par se dire très distant de son passé, « remis » des « vieilles fanfares d’ « héroïsme » (révolutionnaire), mais avoue immédiatement et à deux reprises (alinéas 2 et 7) qu’elles lui « attaquent encore la tête et le cœur », qu’il les « entend », qu’il les « sent ». Or qu’est-ce que « le pavillon en viande saignante » sinon précisément le retour en force, dans l’esprit du rêveur, d’un fantasme de revanche ou d’un souvenir de révolution (« saignante » parce que réprimée). Preuve, par conséquent, que le sujet n’est pas du tout « remis » et que sa rêverie actuelle constitue le réveil de l’obsession, le retour du refoulé. Comme dans le texte précédent, le scénario conduit à un branle-bas de combat universel où il est question de « volcans », de « brasiers, pleuvant aux rafales de givre », de « virement des gouffres » et de « choc des glaçons aux astres ». Pour le lecteur qui se souvient du premier alinéa (« Bien après les jours et les saisons, et les êtres et les pays ») il va de soi qu’on assiste là à une sorte de fin du monde. Par ailleurs, il me semble qu'on entend dans Barbare, comme dans Qu'est-ce pour nous mon coeur, quelque chose comme un dialogue entre deux moi : celui qui « sent » et celui qui pense ; celui qui « entend » les « vieilles fanfares d'héroïsme », qui voit le vieux rêve du « pavillon en viande saignante » reprendre possession de lui et celui qui croit s'être « remis », s'étonne d'abord de cette épiphanie (« Oh »), s'en effraie sans doute, puis s'en réjouit (« Ô »). La conclusion que je tire de ces convergences autotextuelles, c’est que le grand tressaillement cosmique sur lequel Barbare s’achève n'est pas du tout en opposition avec l’apparition du « pavillon en viande saignante » dans l’esprit du songeur, il en est la conséquence logique. Il ne constitue pas un rêve alternatif à celui du « pavillon » mais une autre image du même rêve. Le drapeau et l'extase ne sont en aucune façon des symboles de sens ou de tonalités contradictoires chez Rimbaud. On l'a vu dans Métropolitain, on pourrait encore citer ce verset de Génie : « Il est l'affection et l'avenir, la force et l'amour que nous, debout dans les rages et les ennuis, nous voyons passer dans le ciel de tempête et les drapeaux d'extase. » *
Voilà donc comment on parvient, à partir de prémisses très proches, à des lectures contradictoires du même texte. Pour Reboul (en cela, il rejoint tous les autres commentateurs) Barbare est le moment d’une rémission dans la trajectoire morale de Rimbaud. Une rémission qui débouche sur un dépassement des impasses existentielles ayant accompagné son aventure poétique. Mais il précise la nature de ce dépassement d’une façon qui lui est propre. Barbare serait le poème du « congé » (presque) définitif donné aux illusions révolutionnaires : à la Commune, à l’hétérodoxie sexuelle (cf. p.370) et, sans doute, bien que Reboul ne le dise pas : à la poésie, puisque Barbare est « l’œuvre finale ». Poème de l’Adieu, comme on dit. Pour moi, Barbare est au contraire le récit d’une récidive ou, plus poétiquement, de ce que Rimbaud appelle dans Dimanche « la visite des souvenirs » (Dimanche, Jeunesse I, Les Illuminations). Un poème de bilan ? Sans aucun doute. Mais, lequel ? Le bilan que fait Rimbaud dans Barbare, c'est que les blessures anciennes ne sont pas refermées, que « les anciens assassins » reviennent le visiter, de loin en loin, et qu’à des moments d’intense rêverie, il lui arrive encore de voir « le pavillon » barbare, noyé de sang, flottant sur le monde en voie de destruction ! Aussi a-t-il toujours en lui ce désir d’apocalypse qui, tout au long de son œuvre, métaphorise sa colère (sa « perpétuelle colère contre chaque chose », comme dit Verlaine dans la dernière lettre qu’il adressa à Rimbaud, le 12 décembre 1875). Le poète aura occupé à cette évocation quelque « séance des rythmes » dominicale comme celle dont il parle dans Jeunesse. Il aura décidé de représenter la volupté de cette apocalypse comme une éruption volcanique merveilleuse, un tourbillon de glace et de feu, et de peindre sur le modèle d’une décharge orgastique la dernière convulsion du Vieux Monde. Pensa-t-il plutôt à l’ivresse de la victoire ou à la volupté du sacrifice ? Je ne sais … Peut-être, perversement, au plaisir de la destruction ? N’est-ce pas le « Prince », c’est-à-dire Rimbaud lui-même, qui se pose dans Conte cette question sans réponse : « Peut-on s'extasier dans la destruction » ? |
||
|
>>> RÉPONSE À LA NOTE D'A.BARDEL INTITULÉE : « UN ADIEU AU DRAPEAU ? », PAR YVES REBOUL
|