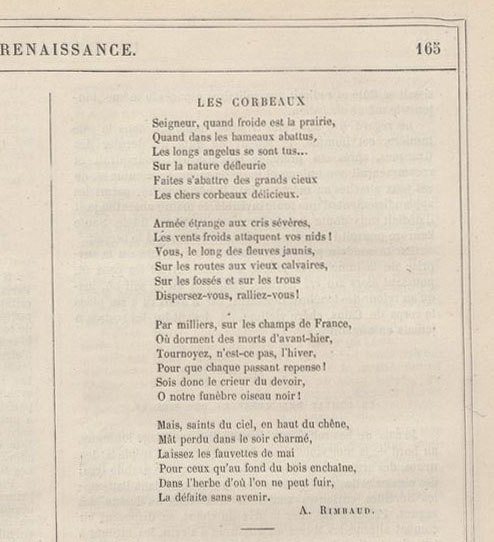|

|
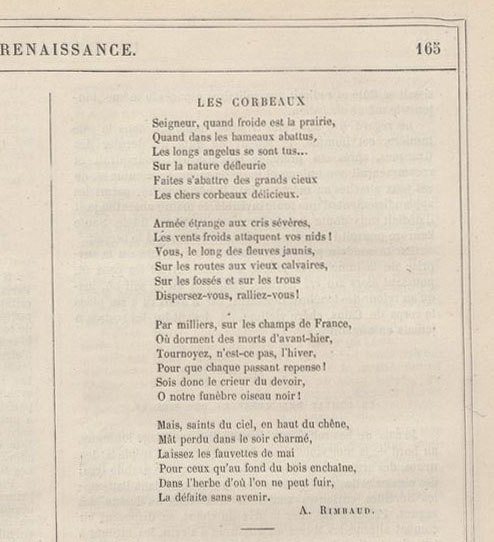 |
|
|
[1]
Rimbaud, Œuvres, Classiques Garnier, 1961, p.384-385.
[2]
Dans l'entrelacs de
causes expliquant l'émergence de
la Commune, le sentiment
patriotique occupe une part non négligeable. Au lendemain de la
capitulation de Napoléon III à Sedan, une première insurrection
parisienne pousse la minorité républicaine de la Chambre à
proclamer la République (le 4 septembre 1870).
La population modeste de la capitale accuse les élites
bonapartistes, déjà coupables d'avoir déclenché une
absurde guerre dynastique, d'avoir permis par leur
incompétence une infamante défaite militaire. Mais la
nouvelle assemblée élue en février 71, où la droite
(républicaine et monarchique) est majoritaire, grâce au vote
conservateur des "Ruraux", ne la satisfait
pas davantage. Elle voit dans son empressement à signer
l'armistice une arrière-pensée de restauration. Ou, pour le
moins, une volonté de la mettre au pas, en
s'appuyant sur Bismarck s'il le faut, afin de frustrer les
espoirs de profondes réformes sociales nés de l'effondrement de
l'Empire et de l'instauration du régime républicain. Cette conjonction de motifs patriotiques et socio-politiques explique en dernier ressort le
soulèvement du 18 mars.
[3]
Rimbaud, Œuvres complètes, édition établie par André
Guyaux avec la collaboration d'Aurélia Cervoni, Gallimard,
Bibliothèque de la Pléiade, 2009, p.893.
[4] Christophe Bataillé, "Les
Corbeaux, chef-d'œuvre anticlérical", Parade sauvage,
Colloque n°5, 2005, p.170-180.
[5] Alain Vaillant, "Rimbaud ou
le génie poétique de l'anticléricalisme", Europe, 2009,
p.94-101.
[6] Dans sa thèse
universitaire, Le Goût de la révolte : caricature et
polémique dans les vers de Rimbaud, Thèse (Ph D), Université
de Canterbury, 1986, puis dans son article "Le goût
de la charogne : Les Corbeaux",
Rimbaud et la Commune,
Classiques Garnier, 2009, p.771-841.
[7]
Alain Vaillant, " Du bon usage de la lecture thématique ", in Parade sauvage
n°28, Dossier "Questions d'herméneutique rimbaldienne",
2017, p.53-67. |
Dans son
édition critique des Œuvres de Rimbaud
[1], publiée en 1961, Suzanne Bernard résume ce qui était alors l’état de
l’interprétation concernant Les Corbeaux. Il vaut la
peine de reproduire largement ces notes et d’en faire le point
de départ de notre réflexion. Suzanne Bernard est, dans
l'histoire de l'édition rimbaldienne, la première
éditrice à avoir accompagné les textes de notes interprétatives. Les auteurs qu’elle cite,
Jules Mouquet, Henry de Bouillane de Lacoste, Jacques Gengoux
sont (avec Étiemble) les principaux "rimbaldiens" du milieu du
XXe siècle :
|
Note 1 : "Ce poème a paru dans
La Renaissance littéraire et artistique […] le 14 septembre
1872. Il n’en subsiste aucun manuscrit. J. Mouquet pense que le
poème serait de 1872, les morts d’avant-hier pouvant désigner
les morts de 1870. Mais Bouillane de Lacoste fait remarquer que
la versification régulière de ces strophes n’est pas celle des
poèmes de 1872 et je crois avec lui qu’il est beaucoup plus
plausible de dater cette pièce de 1871 […]".
Note 3 concernant le v.6 : "Les chers corbeaux délicieux" :
"Le même vers se retrouve dans La Rivière de Cassis,
pièce datée de mai 1872 : il est très possible que Rimbaud ait
repris consciemment le vers de 1871. Suivant Gengoux, ces
corbeaux sont les Germains (dans La Rivière de Cassis,
les corbeaux sont appelés ‘soldats des forêts’) et il y aurait
ici un symbolisme sarcastique : Rimbaud souhaitait, il l’a
écrit, que l’Ardenne fût "occupée et pressurée de plus en plus
immodérément". Verlaine, au contraire, présentait ce texte dans
Les Poètes maudits comme ‘une chose patriotique bien’. Il
semble en effet que Rimbaud a voulu faire du corbeau le ‘crieur
du devoir’, qui doit sans cesse rappeler aux Français les morts
qui ont été sacrifiés et les raisons de la défaite."
Note 4 concernant le v.14 : "Où dorment les morts
d’avant-hier": "L’expression est étrange : pourquoi pas plutôt
les morts "d’hier" ? Suivant Gengoux, il s’agirait des morts
de Quatre-vingt-douze ; mais peut-être les morts de la
guerre sont-ils ‘d’avant-hier’ par rapport à ceux de la Commune,
morts en 1871."
On a là un bon condensé des
problèmes que pose généralement l’interprétation de la poésie,
et, particulièrement, celle de Rimbaud. Quelques détails de
texte énigmatiques ou, du moins, inattendus, des intuitions
divergentes que leurs auteurs tentent de justifier à coups d’arguments tirés de la
biographie, de la chronologie, de la versification ou de
rapprochements intertextuels. Suzanne
Bernard met l'accent sur la diversité des hypothèses. À
la lire, on peut avoir l'impression d'un
écheveau emmêlé de significations contradictoires. Mais, en
réalité, tous les éléments d'une approche méthodique du texte
sont là réunis. Verlaine, en nous enjoignant de ne voir dans le
poème qu'un
message "patriotique bien" (bien pensant), nous
laisse deviner qu'on pourrait y trouver tout aussi bien un patriotisme
très mal (très mal vu), celui qui a présidé à l'insurrection
parisienne du 18 mars 1871 [2]. Gengoux apporte une glose qui,
jointe à l'allusion communarde décelée par Suzanne Bernard,
confirme la possible présence dans le poème d'une signification
indirecte : une dénonciation cryptée des
massacres de la Semaine sanglante, habilement intriquée au sein
du discours
patriotique qui en constitue le sens manifeste.
Cette
hypothèse offre, selon nous, une solide base pour ce
qu'on appelle une "lecture" (satisfaisante et,
dirions-nous, suffisante) du poème.
C'est celle qui tend à prévaloir aujourd'hui. Elle ne
s'est pas imposée en un jour. Longtemps, les commentateurs ont
accueilli avec réticence l'idée communarde. Antoine Adam (Pléiade
1972) ne voit dans le poème qu'une méditation sur la
défaite de la France, que le poète compare avec sa
propre défaite privée de
mars-avril 1872. Marcel Ruff (Poésies, Nizet,
1978) écrit : "les morts dont il s'agit sont indiscutablement
ceux de la guerre et non de la Commune". Steinmetz, GF 1989, en reste à la
dénonciation de la guerre et au contenu patriotique. Forestier,
Bouquins, 2004, estime que
"leur métrique, leur sujet [implicitement : la guerre de
1870] rendent vraisemblable de rattacher
ces vers à la période 1870-1871". Brunel, La Pochothèque, 1999, retient
l'hypothèse Gengoux (il cite la lettre à Delahaye de
juin 1872 dont nous aurons à reparler) sans faire
allusion à la Commune. Guyaux, enfin, dans la Pléiade
2009, cite la Commune sans retenir Gengoux :
"Peut-on déduire de l'esprit de l'hiver qui inspire
ce poème et détermine tout un climat que ces vers
ont été composés pendant l'hiver 1871-1872 ? Cette
conjecture chronologique correspond assez bien au
sujet du poème, qui oppose les "morts d'avant-hier"
(v.14), victimes de la guerre de 1870, aux autres
morts, ceux de la Commine, enchaînés par "La défaite
sans avenir" (v.24) : aux uns, l'hiver, les "vieux
calvaires" (v.10), les corbeaux et les délices du
deuil patriotique ; aux autres, les "fauvettes de
mai" (v.21) — le mois de la Commune de Paris et de
sa défaite." [3].
Mais l'interprétation d'un
poème n'est jamais achevée. Ceux de Rimbaud se retrouvent souvent
durablement au
centre de véritables "conflits de lecture" et tel est
encore le cas pour Les Corbeaux, comme on va le
voir.
Laurent Jenny,
dans son cours numérisé
Méthodes et problèmes. L'interprétation,
écrit :
"Les
significations indirectes, construites par l'herméneute (ou
interprète) n'ont pas le même statut que les significations
littérales. Effectivement, elles ne sont pas explicitement
assertées par l'énonciateur, elles sont seulement suggérées,
en sorte que le locuteur peut toujours refuser de les
assumer comme siennes.
Par ailleurs, ces significations indirectes sont en nombre
indéfini. C'est une caractéristique du texte littéraire de
s'adapter à la compétence interprétative de son lecteur. Il
fournit en général une signification littérale minimale,
repérable même par un lecteur fruste. Mais il permet en
outre au lecteur perspicace et cultivé de déployer un
ensemble de significations secondes, à la mesure de sa
culture et de sa compétence symbolique."
Il ne
faut donc pas s'étonner que certains textes, notamment ceux qui
témoignent d'une certaine opacité, suscitent un grand nombre
d'interprétations plus ou moins divergentes. Et, dans le cas de
Rimbaud, "le locuteur" n'est plus là pour, éventuellement,
"refuser de les faire siennes".
Les Corbeaux sont loin de compter parmi les
poèmes de Rimbaud les plus opaques. Néanmoins, ils ont donné matière, depuis
1986, à une nouvelle interprétation. Plusieurs auteurs,
Christophe Bataillé [4],
Alain Vaillant
[5],
Steve Murphy
[6]
ont mis au point et défendu à
plusieurs reprises une lecture dite "anticléricale" du poème que nous jugeons quant à nous peu convaincante.
Le sens profond, la clef du poème, résiderait dans la
comparaison des noirs volatiles qui hantent les champs de
bataille avec des prêtres. Dans son article du récent Parade sauvage consacré aux "Questions d'herméneutique rimbaldienne"
[7], Alain Vaillant présente
même cette
interprétation (avec quelques autres consacrées à Voyelles
et
Le Cœur supplicié, notamment) comme un exemple de
démarche méthodique dans l'interprétation des textes de Rimbaud,
ce qui contribue à faire du débat critique autour des
Corbeaux un cas
d'école.
Dans une première partie, nous justifierons notre
adhésion à la première des deux interprétations mentionnées :
celle qui voit principalement dans Les Corbeaux une dénonciation cryptée
des massacres de la Semaine sanglante. Dans la seconde, nous
étudierons celle qui veut faire de ce poème une satire anticléricale, encodée sous l'évocation
pathétique des désastres de la guerre. |
|
|
UNE DÉNONCIATION CRYPTÉE DES MASSACRES DE LA SEMAINE SANGLANTE |
|
[8]
Jaques Gengoux, Symbolique de Rimbaud, 1947, p.135,
et La Pensée poétique de Rimbaud, 1950, p.187-189.
|
Les Corbeaux ne sont pas le genre de poèmes, comme
il y en a tant chez Rimbaud, où l’on peut avoir l’impression de
n'y rien comprendre. Le sujet traité, à défaut du message crypté qui
peut-être s'y dissimule, est clair et n’est mis en cause
par personne : il s’agit d’une déploration sur les victimes
de la guerre (les morts tombés
"par milliers sur les champs de France", livrés à ces
charognards que sont les corbeaux). Étant donnée l’époque à
laquelle écrivait Rimbaud, chacun devine que ces victimes sont
celles du conflit franco-prussien de 1870. D’où la
possibilité d’une intention patriotique, hypothèse que défend
Verlaine dans
Les Poètes maudits.
"Une seule
pièce, d'ailleurs sitôt reniée ou désavouée par lui, a été
insérée à son insu, et ce fut bien fait, dans la
première année de la Renaissance, vers I873.
Cela s'appelait Les Corbeaux. Les curieux pourront se
régaler de cette chose patriotique mais patriotique bien, et
que nous goûtons fort quant à nous [...]."
Mais on connaît Rimbaud, on a lu
ses lettres contemporaines de la guerre en question, dans
lesquelles il adopte une attitude radicalement défaitiste, on a
lu ses lettres à Delahaye de jumphe 72 et de mai 1873 (nous en
reparlerons). D’où l’intuition d’un sens second qui déclenche le
processus d’interprétation, comme en témoigne, ci-dessus,
l’exégèse étonnante émise par Jacques Gengoux [8].
Pour approfondir l'analyse, nous pouvons adopter la terminologie et la méthode prônées
par Alain Vaillant dans son article intitulé "Du bon
usage de la lecture thématique".
Il les résume ainsi :
"Les linguistes ont pour leur
usage un couple de concepts dont nous pouvons aussi faire notre
profit : thème/rhème […]. Le thème est le sujet dont il est
question dans l’énoncé et désigne les informations qui sont
connues de tous ; le rhème est l’information nouvelle qu’apporte
le locuteur" (op.cit. p.56-57).
Quand on
commente un texte de Rimbaud, poursuit Vaillant, il est
particulièrement conseillé de dépasser le simple repérage du
"thème" pour atteindre le "rhème". Le "thème" d'un texte
peut n’être qu’une banalité conforme à l’air du temps, un poncif
d'époque. Le "rhème", c’est le "quelque chose de singulier"
qui correspond à l’ "univers imaginaire" du poète. Le
"thème" est cette signification manifeste que tout un chacun,
à l’époque de Rimbaud, percevait de façon spontanée, le
"rhème", la signification indirecte que seul le lecteur
perspicace, réactif, complice, était en mesure de détecter et de
comprendre.
|
|
|
LE "THÈME"
Comme exposé plus haut, nous ne savons pas quand Rimbaud a écrit
ce texte. Nous exposons
ici le débat auquel cette question a donné lieu dans
l'histoire du rimbaldisme. La facture régulière du poème a
parfois fait dater la pièce de 1871 mais l'allusion probable à
la Commune de Paris (que nous tenterons plus loin de démontrer) a
aujourd'hui convaincu la majorité des spécialistes que la
période de composition des Corbeaux se situe entre, au
plus tôt, les derniers mois de 1871 et septembre 1872, date de
sa publication dans La Renaissance (Verlaine fait une
erreur manifeste dans le passage des
Poètes maudits cité plus haut, quand il situe "vers 1873"
la publication du poème). Cette conjecture chronologique un peu
floue suffit malgré tout à identifier la référence principale du
texte. Les batailles, la défaite, le siège de Paris, les dégâts
de la guerre franco-prussienne de 1870 ont suscité
en France une production massive de gravures dans les mois qui
ont suivi la débâcle et toute une littérature dans laquelle on
peut repérer notamment le motif des corbeaux. Citons par exemple
cette strophe du poème Les Paroles du vaincu (1871), de
Léon Dierx :
Qu’ils sont gras, les corbeaux, mon frère !
Les corbeaux de notre pays !
Ah ! la chair des héros trahis
Alourdit leur vol funéraire !
Quand ils regagnent, vers le soir,
Leurs bois déserts, hantés des goules,
Frère, aux clochers on peut les voir,
Claquant du bec, par bandes soûles,
Flotter comme un lourd drapeau noir.
Le
tableau évoqué par Dierx présente une similitude frappante avec
celui de notre poème et nous pouvons y reconnaître sans
hésitation un stéréotype, un poncif d'époque.
Nous possédons en outre deux indices sur la façon dont le
poème rimbaldien des Corbeaux était lu par ses
contemporains. Premièrement, le fait que le texte ait été publié,
c’est-à-dire admis, voire choisi, par La Renaissance
littéraire. Cette revue, dans les années
immédiatement postérieures à la défaite de 1870, était engagée
dans une fervente campagne d’enrôlement des littérateurs en
faveur du redressement national (il vaut la peine de lire, dans
le numéro du 4 mai 1872,
la lettre-manifeste revancharde et chauvine adressée par Victor
Hugo à ses "jeunes confrères" de La Renaissance)
ce qui explique certainement son intérêt pour Les Corbeaux
malgré la réputation sulfureuse de leur auteur.
Deuxièmement, la présentation qu'en fait Verlaine dans Les Poètes
maudits :
"Les curieux pourront se régaler
de cette chose patriotique, mais
patriotique bien, et
que nous goûtons fort quant à nous".
La formule est ambiguë mais pour le lecteur naïf, appelons-le
"standard", de 1883, ce "bien" évoquait à n'en pas douter
l'ordre moral. Et, de la même façon, le lecteur standard de
1872 comprenait nécessairement le "devoir" dont il est question dans le poème
comme étant le devoir patriotique (conformément au commentaire
qu’en offre ci-dessus la note 3 de Suzanne Bernard). Le
"patriotique bien", c'est-à-dire "bien-pensant", voilà quelle
était la lecture prévisible, à l'époque, d'un tel texte, la
réception spontanée, banale et conventionnelle qu'il était
habile pour le poète d'autoriser en apparence. Voilà quel fut
pour Rimbaud le "thème" à illustrer ... et à subvertir en
sous-main ainsi que nous allons le voir.
|
|
[9]
Tzvetan Todorov,
Symbolisme et interprétation, Éditions du Seuil, 1978, p.92.
[10] On chiffre parfois à
30.000 les victimes de la répression de la Commune.
[11]
Il semble que ce soient
Mouquet et Rolland de Renéville
qui en aient avancé les premiers l'idée, dans la première
pléiade Rimbaud, 1963, p.730. Mais la formule ambigüe de
Verlaine ("patriotique bien" mais dans quel sens ?) montre que
le double discours du poème ne lui avait pas échappé. Nous y
reviendrons.
|
LE "RHÈME"
À quels
indices le lecteur perspicace, celui que visait idéalement
Rimbaud, pouvait-il déceler cette intention subversive ? Tzvetan
Todorov écrit :
"L'interprétation (en tant que
distincte de la compréhension), n'est pas [...] un acte
automatique ; il faut que quelque chose, dans le texte ou en
dehors de lui, indique que le sens immédiat est insuffisant,
qu'il doit être considéré seulement comme le point de départ
d'une enquête dont l'aboutissement sera un sens second.[9]"
Quel est, ou plutôt quels sont,
dans le texte des Corbeaux, ces déclencheurs possibles de
l'interprétation ? On peut en compter jusqu'à cinq :
-
Une formule énigmatique : "les
morts d'avant-hier".
Pourquoi pas "les morts d'hier",
s'interrogeait (supra) Suzanne Bernard ? Sans doute parce que
les morts d'hier, pour Rimbaud, à la date à laquelle il écrit,
ne sont pas ceux de la collision inter-impérialiste de 1870 mais
ceux de la révolution communaliste du printemps 1871. Pourquoi
cette indication temporelle étrange, en effet, si ce n'est pour
suggérer au lecteur que la France a eu à pleurer, depuis la
guerre, bien d'autres morts : les milliers de morts de la
semaine sanglante [10] ?
L'hypothèse a été lancée par Suzanne Bernard en 1961 et a
généralement convaincu.
Il y avait là, certainement, de quoi inciter certains
lecteurs de 1872 à pousser plus loin l'enquête herméneutique et
à remarquer, par exemple, au v.21, un indice convergent :
"les fauvettes de mai". La critique rimbaldienne s'est avisée
depuis longtemps que les "fauvettes de mai" pouvaient bien se
rapporter au printemps révolutionnaire de mai 1871
[11]. "Les fauvettes de mai, écrit Murphy,
représentent en effet le chant de liberté de la révolution ;
elles combinent les implications des motifs coréférentiels de
trois poèmes de 1871 : le "soir fauve" où les ouvriers du
faubourg s'assemblent dans une atmosphère prérévolutionnaire
dans Les Poètes de sept ans, le "fauve renouveau" de la
Commune évoqué après la Semaine sanglante dans L'Orgie
parisienne ou Paris se repeuple et le "papillon de mai" du
Bateau ivre." (2009, p.802).
La critique a noté une apparente
contradiction dans la clôture du poème. Si les "fauvettes de
mai" doivent être comprises comme un symbole d'espoir et de
résurrection, pourquoi terminer le texte sur "la défaite sans
avenir" ? Personnellement, nous pensons que cette fin
ambivalente s'explique par le double discours conduit par
Rimbaud. Au lecteur "patriotique bien", comme dit
Verlaine, Rimbaud propose un dénouement lucide et affligeant,
anti-belliciste et anti-religieux : pris comme un individu
isolé, le mort est mort, sans aucun salut à attendre. Au lecteur
complice, par contre, il adresse le traditionnel discours
messianique, que Steve Murphy résume à merveille : les morts
d'hier, écrit-il, "reviendront sous la forme de nouvelles
générations acquises aux mêmes idéaux, qui reprendront la
bannière de la révolution et de la Liberté [...]. Tout porte à
penser que c'est vers le printemps que tend la fin du poème, le
chant des fauvettes pouvant laisser anticiper un nouveau temps
des cerises et la renaissance de cette nature défleurie (dé-florée)
par la violence − par le viol (cf. les "enleveurs d'héliotropes"
et le symbolisme au cœur de L'Orgie parisienne ou Paris se
repeuple) − des vainqueurs." (ibid. p.827-828). |
|
|
-
Une ambiguïté
sémantique troublante : l'attitude paradoxale du sujet lyrique à l'égard
des corbeaux.
Les corbeaux de Rimbaud sont des soldats ("armée
étrange aux cris sévères"). Ils s'abattent sur les "champs de
France" comme hier les bombes des Prussiens sur les "hameaux"
aujourd'hui "abattus". Le poète utilise deux fois le même verbe
"abattre" à quelques vers de distance, consolidant par là une
isotopie militaire (bien rendue par
le tango martial à la Kurt Weill
imaginé par Léo Ferré pour mettre le poème en musique). Mais il suffit de comparer le
texte de
Rimbaud à celui de Dierx précédemment cité pour constater ce
qu'il y a de politiquement incorrect dans la façon dont Rimbaud
s'empare du thème patriotique (représenté chez Dierx dans sa
variante antibonapartiste, cf. l'allusion aux "héros trahis").
En bon patriote, l'auteur des Paroles du vaincu se lamente au spectacle des charognards et il prescrit aux
forgerons du pays de fabriquer les armes en vue de la
revanche :
Battez le fer, ô forgerons !
Pour percer un jour leurs entrailles !
Fondez le plomb pour les mitrailles,
Quand, un jour, nous les chasserons !
L’odeur des morts emplit la brume.
Dans la plaine et sur le coteau
Que l’espoir, feu sacré, s’allume,
Que la vengeance soit l’enclume,
Et la haine, le dur marteau !
Au contraire, le sujet
lyrique de notre poème encourage de la voix les prédateurs à
accomplir leur funèbre besogne ("tournoyez", "dispersez-vous",
"ralliez-vous"), à "s'abattre" sur les "hameaux" et les "routes
aux vieux calvaires". Il demande aux charognards d'entretenir,
en en répétant indéfiniment le geste, le souvenir du massacre, de ragaillardir "le passant"
ou "le piéton" dans son courage (comme Rimbaud dit dans
La Rivière de
Cassis) et de lui rappeler
son "devoir" (devoir de revanche, s'entend) :
Sois donc le crieur du devoir
Ô, notre funèbre oiseau noir.
Paradoxalement, donc, les "chers corbeaux délici-eux" se
trouvent devenir, dans notre poème, des personnages positifs. Ce
sont eux, ces "saints du ciel", que
"le passant" supplie de "laisser les fauvettes de mai...". Et si
cette prière a un sens, c'est bien que
les "corbeaux délicieux" se révèlent être, pour
l'occasion, les alliés paradoxaux du poète. Il parle du rapace
comme on parle d'un parent, d'un ami. Cf. l'utilisation du
pronom possessif dans : "Ô, notre funèbre oiseau noir".
L'ironie évidente de la formule ne suffit pas à lui ôter son
caractère de familière sympathie. Le rapprochement avec La
Rivière de Cassis est ici décisif :
Soldats des forêts que le
Seigneur envoie,
Chers corbeaux délicieux !
Faites fuir d'ici le paysan matois
Qui trinque d'un moignon vieux.
C'est aux "corbeaux délicieux" ("à
la bonne voix d'ange", "Soldats des forêts que le Seigneur
envoie") que "le piéton" de cet autre poème demande de chasser
"le paysan matois", cible traditionnelle du ressentiment
politique de Rimbaud (cf. la désignation des Versaillais comme
des "Ruraux" dans Chant de guerre parisien). L'impression qui ressort de tout cela est
celle d'une complicité masochiste entre le poète et l'oiseau de
malheur. C'est peutêtre cet aspect du texte qui a
suggéré à Jacques Gengoux le rapprochement qu'il opère avec les
propos tenus par Rimbaud dans sa correspondance avec Ernest
Delahaye, son ami de
Charleville. |
|
[12]
Jean-Pierre Chambon, "Noms
de lieux et construction du sens : le cas de la lettre de
Laïtou" Parade sauvage, Colloque n°2, p.121-129. |
-
Des échos autotextuels qui
confirment l'intuition précédente et contredisent l'idée
d'un patriotisme bien-pensant.
Tous ces impératifs que le
poète adresse aux corbeaux ("tournoyez", "dispersez-vous",
"ralliez-vous", "Sois donc le crieur du devoir") ne sont pas
sans rappeler au lecteur rimbaldien de nombreux autres textes
où, à grand renfort d'impératifs aussi, Rimbaud se commande à
lui-même : "Mon esprit ! Tournons dans la Morsure" (Qu'est-ce
pour nous mon cœur...), où il ordonne aux "eaux et tristesses,
montez et relevez les Déluges" (Après le Déluge), aux
"flots abracadabrantesques, Prenez mon cœur, qu'il soit sauvé !"
(Le Cœur supplicié), où il intime aux "cent agneaux, de
l'idylle soldats blonds" [...] "Fuyez" ! [...] "la toilette
rouge de l'orage" [...] "les "mille loups" [...] les "cent
hordes" déferlant "sur l'Europe ancienne" [...] et "les
guerriers" aux fronts "rougis" (Michel et Christine).
Dans Soir historique, il guette "le moment de l’étuve
[...], des embrasements souterrains [...], des exterminations
conséquentes".
Ce sont ces moments, si caractéristiques de la psychologie
et de la politique de Rimbaud, où le sujet lyrique appelle sur
lui et sur le monde "les bourreaux" et "les fléaux" (prologue d'Une
saison en enfer), ressasse sa souffrance pour mieux
entretenir sa rage : "tourne dans la Morsure" comme il le dit
si bien, en détournant de façon expressive lé locution
traditionnelle "retourner le fer dans la plaie",
effet de
style dont il est coutumier. Il y a beaucoup de ça dans l'étrange
fascination que l'auteur de notre poème semble éprouver pour
l'"armée étrange aux cris sévères" des corbeaux.
C'est pourquoi le rapprochement entre cette attitude
ambivalente du poète envers les corbeaux et celle que Rimbaud
adopte à plusieurs reprises à l'égard des
"Prussmars" (des Prussiens) dans sa
correspondance avec Delahaye n'est pas aussi saugrenu qu'on
aurait pu penser a priori :
"Je
souhaite très fort que l'Ardenne soit occupée et pressurée de
plus en plus immodérément." (lettre de Jumphe 72).
"J'ai été hier voir les Prussmars
à Vouziers, une sous prefecte de 10 000 âmes, à sept kilom
d'ici. Ça m'a ragaillardi." (lettre de "Laïtou", mai 1873).
Dans l'étude qu'il a consacrée à
la lettre dite de "Laïtou", J.-P. Chambon, commentant les
propos provocateurs de Rimbaud, écrit :
"Cette attitude est celle d'un
vaincu, dont le seul recours est un cynisme exaspéré, fruit
d'une impuissance désespérée. En 1872-1873, Rimbaud est trop
profondément atteint par la défaite de la Commune pour
songer à une réorganisation des forces, à une reprise du
combat. Il ne souhaite pas 'la revanche', mais bien
seulement la vengeance. Cette 'vingince', il la destine
avant tout − et nous pouvons retrouver ici une autre
connotation, paysanne, de Laïtou − aux 'Ruraux' qui
l'entourent. Dans leur 'innocince' factice, les paysans se
sont ralliés à des chefs réactionnaires et capitulards. Leur
'innocince' (un 'fléau' !) a ainsi permis l'écrasement de la
Commune de Paris [...] Que les paysans boivent maintenant le
calice jusqu'à la lie !" [12]
Tel est donc le paradoxe
auquel nous convie Rimbaud dans Les Corbeaux : les
charognards, symboles du soldat cruel et sanguinaire,
apparaissent comme les alliés du poète révolutionnaire. Mieux
encore, ils sont (comme les Prussmars de Vouziers) l'instrument
paradoxal de sa revanche. C'est
peut-être pourquoi le poète les proclame (suggestif oxymore
rendu plus suggestif encore par la di-érèse) "délici-eux" : ils
lui procurent le plaisir délectable de la vengeance. Tout cela,
au niveau du fantasme, bien sûr. Ils sont, en dernier ressort,
la projection fantasmatique de ses idées noires, de sa
mélancolie et de sa colère. |
|
|
Les
Corbeaux commencent, sur un ton de supplication, comme une
prière : "Seigneur, quand froide est la prairie
[...]". Ces oiseaux de proie sont décrits comme des "saints du
ciel". De même, dans La Rivière de Cassis, Rimbaud les
décrit comme des "Soldats des forêts que le Seigneur envoie".
Leurs "cris sévères" sont assimilés à une "bonne voie d'anges".
Steve Murphy commente :
"Rimbaud [a] choisi comme 'armée
d'anges' un oiseau qui − vautour à la française − n'a ni
l'immatérialité de l'ange prototypique, ni sa blancheur : on est
en droit d'y voir des anges paradoxaux sinon antonymiques. Des
anges certes à comprendre dans leur relation étroite avec le
Catholicisme, mais qui, pour tout lecteur catholique, ne
pourraient être positifs" (ibid., 2009, p.785).
Ce ne peut être que par
raillerie, en effet, voire par goût du blasphème, que ces charognards
par ailleurs définis comme des soldats se voient
présentés comme des messagers divins.
Le lecteur familier de l'œuvre de Rimbaud possède les
références nécessaires pour interpréter cette raillerie. Il
connaît la propension du poète à déguiser sous forme de prières
les pièces les plus profanes et les moins catholiques (Oraison
du soir, Dévotion). Par ailleurs, la représentation
du Dieu chrétien comme un dieu injuste présidant aux pires
"boucheries héroïques", dans la tradition de l'anticléricalisme
des Lumières (pensons aux Te Deum du chapitre III de
Candide, répertorié dans tous les bons manuels de
littérature), constituait le sujet même du sonnet de 1870, Le
Mal.
Cette dimension parodique contribue elle aussi à ruiner
l'idée d'un poème patriotique bien-pensant au profit d'une lecture
secrètement "communarde". |
|
|
Celui que nous
appelons "le lecteur complice" — disons : l'abonné de La Renaissance plus socialiste que
républicain, par exemple — surtout s'il avait déjà lu du Rimbaud
ou entendu parler de lui, savait d'avance que le sermon
patriotique servi par cet énergumène dans Les Corbeaux ne
pouvait être qu'un leurre dissimulant un sens second à
élucider. Ce même type de lecteur, découvrant la présentation
verlainienne du
poème dans Les Poètes maudits, en a probablement décrypté
sans peine l'équivoque. Si, dans la bouche de l'auteur de
Sagesse, le "bien" de "patriotique bien" pouvait suggérer au
lecteur naïf un moralisme de convention, de la part du
sympathisant de la Commune qu'avait été Verlaine, elle pouvait
être interprétée comme une référence au patriotisme de version
communarde. Par sa formule à
double entente des Poètes maudits, Verlaine ne faisait au
fond que prolonger l'ambiguïté voulue du poème.
On se perd en conjectures concernant cette autre
phrase alambiquée
utilisée par Verlaine dans Les Poètes maudits, que nous
avons déjà citée plus haut :
"Une seule pièce, d'ailleurs sinon reniée ou désavouée par lui,
a été insérée à son insu, et ce fut bien fait, dans la
seconde année de la Renaissance, vers 1873 [Verlaine fait
erreur sur la date]. Cela s'appelait Les Corbeaux."
On
croit comprendre que, contrairement à Verlaine, Rimbaud jugea
qu'on n'avait pas "bien fait" d'insérer Les Corbeaux dans
La Renaissance. Personnellement, nous n'y voyons que deux
raisons possibles. La forme :
Rimbaud l'aurait jugée trop
conventionnelle et aurait préféré que la revue publie son sonnet
des Voyelles, par exemple (Blémont, directeur de La
Renaissance, en avait un manuscrit que
l'on a retrouvé bien plus tard dans ses archives familiales). Le
fond : il aurait craint qu'un tel poème, trop conforme, dans son
sens apparent, à la ligne politique de la revue, ne soit, publié
là, mal
compris et n'apparaisse de sa part
comme une concession à l'air du temps.
Mais si Blémont avait le texte, c'est qu'on le lui
avait confié. Comment, dès lors, lui reprocher
de le publier "à l'insu" de l'auteur ? Le mécontentement de
Rimbaud, avoué à demi-mot par Verlaine, viendrait-il alors du
fait qu'"on" aurait communiqué son texte sans lui en parler.
Qui ? Verlaine ? un autre compagnon de route ?
Peut-être pendant les mois où il était absent de Paris, exilé à
Charleville sur l'ordre de Verlaine (mars-avril 1872) ?
Cet imbroglio, en tout cas, une fois de plus, ne
pouvait que confirmer le "lecteur perspicace" des Poètes
maudits dans sa conviction :
Les Corbeaux ne devaient pas être réduits au message
patriotique proclamé par Verlaine.
En conclusion, le "thème",
le stéréotype d'époque décelable dans Les Corbeaux, est à
l'évidence insuffisant à rendre compte du poème. Les indices
d'un discours plus original, caractéristique de l'imaginaire
propre au poète, surabondent dans le texte et autour du texte. Ils pouvaient
difficilement échapper tous au lecteur d'hier ou d'avant-hier. Ils constituaient
et constituent pour nous ce
qu'Alain Vaillant appelle le "rhème", c'est-à-dire les
indices d'un sens second que nous avons identifié, pour
le dire vite, comme un message communard. Mais plusieurs
commentateurs parmi lesquels Alain Vaillant lui-même,
même s'ils partagent l'idée d'un "poème communard", n'entendent
pas en rester là et proposent une toute autre lecture que la
nôtre.
|
|
L'HYPOTHÈSE D'UNE SATIRE ANTICLÉRICALE |
|
[13]
Alain Bardel, "Pour mémoire",
Parade sauvage n°24, Dossier sur Mémoire, 2013,
p.15-76. |
L'exégèse
d'un texte littéraire est potentiellement illimitée. Voir,
supra, la citation de Laurent Jenny. Un bon exemple de cela dans
la production rimbaldienne pourrait être
Mémoire, un des poèmes qui ont suscité le plus grand nombre
d'interprétations. Mais nous avons pu montrer dans un article de
Parade sauvage
[13]
que, parmi les dizaines de
commentaires qui lui ont été consacrés, reflétant l'évolution de
la réception de ce texte au fil du temps et correspondant à
différents types d'approche très variés, presque tous restent
fidèles à un cadre interprétatif général commun, qu'ils
enrichissent chacun à sa manière et dont le respect,
en dernière instance, les valide.
Mais il n'en est pas toujours ainsi et, devant
certaines exégèses étranges, on est parfois obligé de rappeler
qu'on ne peut pas faire dire à un texte tout à fait autre chose
que ce qu'il dit.
Umberto Eco
lui-même, jadis théoricien de
L'Œuvre ouverte (1962), en est venu sur le tard à intituler l'un de ses livres
Les limites de l'interprétation (1990). Il y défend que la
liberté du lecteur s'arrête là où elle rentrerait en
contradiction, sinon avec l'intention de l'auteur, du moins avec
ce qu'il appelle "l'intention de l'œuvre" (intentio
operis) :
"L'initiative
du lecteur consiste à émettre une conjecture sur l'intentio
operis. L'ensemble du texte – pris comme un tout
organique – doit approuver cette conjecture interprétative,
mais cela ne signifie pas que, sur un texte, il ne faille en
émettre qu'une seule. Elles sont en principe infinies, mais
à la fin, elles devront être testées sur la cohérence
textuelle, laquelle désapprouvera les conjectures
hasardeuses."
Sur le
plan de la cohérence, l'interprétation "communarde" des
Corbeaux exposée ci-dessus passe avec succès le "test" dont
parle Umberto Eco. Nous avons trouvé sur l'ensemble du texte au
moins cinq indices de nature différente convergeant vers le sens
indiqué et se validant mutuellement. En sera-t-il de même
avec l'exégèse dite "anticléricale" ? Nous nous le demandons sérieusement.
|
|
[14]
Bouillane de Lacoste, par exemple, en 1939, voit dans Les Corbeaux "un texte
uniquement descriptif et sentimental" (Rimbaud, Poésies, Mercure
de France, 1939, p.38).
[15]
Aucune édition courante, à notre connaissance, ne la reprend.
Jean-Marie Méline, dans le récent Dictionnaire Rimbaud de
la collection "Bouquins", pense que, vu le "sujet (des morts par milliers 'sur les champs de France',
au cœur de l'hiver)", Rimbaud a écrit Les Corbeaux
à l'époque de la guerre franco-allemande, ou en souvenir de
celle-ci". Point final (Dictionnaire Rimbaud,
dir. J.-B. Baronian, Robert Laffont, 2014, p.178). |
LE CORBEAU, INCARNATION DU PRÊTRE : THÈME
ÉVIDENT DU POÈME ?
Ici, sans encore toucher au fond de la question, une remarque préliminaire. Dans
son article "Du bon usage de la lecture thématique",
l'anticléricalisme est présenté par Alain Vaillant comme étant
le "thème" du poème. Cet "anticléricalisme
(thématique)", dit l'auteur, est "évident" (p.58).
Peut-être pas pour tout le monde mais "pour qui a un peu
fréquenté la presse satirique de l'époque (notamment ses
caricatures) l'identification des corbeaux à des prêtres (à
cause de leur soutane noire) est immédiate [...]" (ibid.).
Cette identification est donc un poncif
d’époque, ce qui constitue la définition même du "thème" dans la terminologie que l'auteur nous
propose d'adopter.
Selon nous, au contraire, l'assimilation des
corbeaux à des prêtres, dans le cas même où elle serait
parfaitement démontrée, ne saurait en aucune façon être
considérée comme le "thème" du poème, dans le sens
conceptuel précis que Vaillant donne à ce mot. Telle ne
fut certainement pas, à l'époque de sa
parution, la signification superficielle et banale immédiatement saisie par tout un
chacun. Et ce ne serait certes pas un tel
message qui aurait séduit les rédacteurs de La Renaissance
s'ils l'avaient diagnostiqué. Tel n'est
pas non plus le contenu mis en avant par Verlaine lorsqu'il présente
l'œuvre dans Les Poètes maudits. Et Verlaine, malgré
tout, savait lire. Aucun commentateur, enfin, n'a suggéré cette compréhension du texte avant sa mise au point par
les auteurs cités [14].
Une petite enquête parmi les vingt à trente spécialistes
qui penchent aujourd'hui sur l'œuvre de Rimbaud leurs "grands fronts
studieux" montrerait d'ailleurs à Alain Vaillant que peu d'entre eux partagent
cette approche du texte [15].
C'est que l'accès à une lecture comme la sienne, contrairement à
ce qu'il semble croire, suppose une investigation
symbolique, un processus interprétatif. Si la représentation
caricaturale des hommes d'église joue un rôle important dans
Les Corbeaux, ce ne peut
être, dans la terminologie propre à l'auteur, qu'en tant que "rhème", subtilement encodé et
partiellement dissimulé au sein
du discours patriotique, qui constitue le sens manifeste du poème.
Il n'y a là probablement qu'un malentendu sur les mots
(nous ne mettons pas exactement le même sens, Vaillant et nous,
sous le mot "thème"), car, sur le fond, nous serions bien
étonnés que les tenants de la lecture anticléricale
croient que les premiers lecteurs des Corbeaux, dans
La Renaissance, y ont vu un vol de soutanes s'abattant sur la
campagne française. Ceci, pour ne rien dire de ce qu'aurait été
la réception par un lectorat plus fruste si ce genre de
littérature avait bénéficié, à l'époque, d'une large diffusion.
Mais le cas est malgré tout symptomatique (un "cas d'école",
disions-nous). Les commentateurs sont parfois si convaincus de l'insuffisance du
premier niveau de lecture, en ce qui concerne Rimbaud, qu'ils
enjambent allègrement le stade initial d'interrogation du texte pour en
venir tout de suite au symbole, au code, à la clé
autobiographique ou autre. Bref, on passe si vite de la lecture
naïve à la lecture experte qu'on en arrive à prendre l'une pour
l'autre. Ou, plus dangereux encore, on saute illico au scénario
bien connu, à la grille d'interprétation préconçue, érotique,
politique, etc., au risque de trouver surtout dans le texte ce
qu'on y a apporté. On pourrait sans peine citer quelques interprétations circulaires
de ce genre au sein de la littérature
rimbaldienne,
concernant Voyelles, ou Barbare, ou Dévotion
par exemple,
mais c'est là un autre sujet que nous laisserons pour une autre fois.
|
|
|
LES ARGUMENTS EN
FAVEUR DE LA THÈSE ANTICLÉRICALE
Revenons-en aux Corbeaux : quels seraient les
indices du texte en faveur de l'exégèse anticléricale ? Nous nous
appuierons ici sur l'article de Steve Murphy "Le goût de la
charogne" (2009), document d'une exceptionnelle richesse
informative et argumentative. La religion,
explique Murphy, occupe une "place décisive" dans Les Corbeaux :
"Ainsi, que le référent soit
la guerre contre la Prusse ou la Commune, la place décisive
qu'occupe la religion dans ce poème ne peut être sans
rapport avec l'opposition intransigeante à l'Église, aux
engagements politiques et sociaux et à la pensée du Vatican"
(op.cit., p.804)."
L'anticléricalisme est
incontestablement présent
dans le texte, nous l'avons dit. Essentiellement, pour nous, à
travers son allure blasphématoire. Mais est-ce suffisant pour
faire de la question religieuse la clé de voûte, le centre de
gravité du poème ? Voyons malgré tout les arguments avancés
par Steve Murphy :
-
"Le corbeau est un emblème
traditionnel du prêtre et du curé dans la littérature
anticléricale" (813) ;
-
"Retenons pour les nids du poème" que "NID DE CORBEAU" désigne
une Abbaye en argot (814) ;
-
les corbeaux du texte symbolisent
"l'obscurantisme hivernal" (815), ce sont les "messagers de
l'obscurantisme" (824) ;
-
dans
Sommation (L'Année terrible), Hugo parle de
Trochu comme d'un "soldat cher au prêtre" ;
-
"les caricatures
républicaines de l'époque sont évidemment remplies de corbeaux
cléricaux" (816) ;
-
l'une de ces caricatures (par Faustin)
représente "L'Abbé Trochu" (816) ;
-
"il se peut que Rimbaud pense
à Sommation et à Trochu, véritable symbole de la
capitulation..." (819) ;
-
dans
La Voix de Guernesay (II), c'est au pape, accusé
d'avoir béni les soldats de Napoléon III, que Hugo impute la
responsabilité des vols de charognards :
O sinistre vieillard, te
voilà responsable
Du vautour déterrant un crâne dans le sable,
Et du croassement lugubre des corbeaux !
-
"Rimbaud avait déjà utilisé cette
image dans Un cœur sous une soutane où Monsieur Léonard
fuit le séminaire : 'Les basques de mon habit noir volaient
derrière moi, dans le vent, comme des oiseaux sinistres !'"
(822).
Cette profusion de preuves est
trompeuse. Elle consiste surtout à nous rappeler que les
prêtres sont fréquemment caricaturés en corbeaux et les
Versaillais en curés à l'époque de Rimbaud. Mais les arguments ne reposent
presque jamais sur le texte et, quand c'est le cas (les "nids",
par exemple) ils constituent des rapprochements
trop hasardeux pour pouvoir nous convaincre.
Quand Rimbaud, dit encore Steve Murphy (en citant Alain
Vaillant), fait du corbeau "le crieur du devoir", il faut
l'entendre au sens du devoir de croire, car le corbeau croasse,
il crie "croa/crois". Quand on vous dit que les corbeaux sont
des curés ! Nous ne sommes pas hostiles par principe à détecter
des calembours d'almanach dans les textes de Rimbaud mais encore
faut-il qu'ils n'en contredisent pas le sens premier (le
"devoir" dont il est question dans le texte est à l'évidence le
devoir patriotique, pas le devoir de croire) et qu'ils n'en
dénaturent pas la tonalité. Or, le registre de ce poème qui fait
du poète l'ordonnateur et des corbeaux les officiants d'un
atroce cérémonial funèbre, dans un style, appelons-le apocalyptique, est plutôt
celui de l'élégie ou de la tragédie que celui de la satire ou de
la farce. Nous pourrions en dire autant du recours aux
caricatures d'époque. Convaincant dans l'interprétation d'une
pièce burlesque comme Chant de guerre parisien, charge
anti-versaillaise joyeuse, d'ailleurs antérieure à la fin
tragique de la Commune, il l'est beaucoup moins, appliqué aux Corbeaux. Et ne parlons pas de la référence à
Un cœur
sous une soutane !
|
|
|
LA QUESTION
(CAPITALE) DU
REGISTRE
On
fait violence au poème, selon nous, en le présentant comme une
pièce satirique, à la limite humoristique, en dépit du registre
élégiaque qui est le sien. Il s'agit certes d'une parodie, d'une
parodie de prière, mais qui n'a rien de comparable avec, par
exemple, Oraison du soir ou Dévotion. Dans ces
textes, les indices d'une intention ironique, voire humoristique, sont nombreux
et visibles. Tel n'est pas le cas dans Les Corbeaux. Et
encore moins si l'on s'accorde à déceler dans le poème une
dénonciation cryptée des massacres de la Semaine sanglante.
Les Corbeaux,
dit sarcastiquement Steve Murphy, se rattachent à "une auguste
tradition descriptive et élégiaque" (op.cit. 2009, p.782). Le
poème suit en effet le protocole traditionnel
de la correspondance entre un paysage et un état d'âme. L'état
d'âme, c'est la tristesse à la pensée des vies perdues, la
déploration de "la défaite sans avenir". Le paysage, c'est une
plaine doublement martyrisée par la guerre et par l'hiver ("les
hameaux abattus", "la nature défleurie"). Il y a certes là un
programme lyrique des plus classiques mais que Rimbaud exécute avec
art, en "enfant touché du doigt de la muse" qui a fait ses
classes dans la fréquentation assidue des poètes. Et cela ne
mérite pas le sous-entendu un peu méprisant de la formule de Murphy.
Rimbaud peint la désolation avec ses adjectifs ("quand
froide est la prairie", "vents froids", "armée étrange aux cris
sévères", "nature défleurie", etc.) ; évoque le vol des corbeaux
avec des verbes de mouvement, en choisissant ces verbes de façon
à connoter des manœuvres guerrières et en imitant à travers
l'impératif le style de commandement ("dispersez-vous",
"ralliez-vous", "tournoyez") ; utilise le même mot pour décrire
le vol des oiseaux ("s'abattre") et les ravages de la bataille
("les hameaux abattus") ; double d'un parallélisme syntaxique la
symétrie de l'alexandrin pour mieux mimer le déplacement en
bande des corbeaux d'un point à un autre : "Sur les fossés et
sur les trous / Dispersez-vous, ralliez-vous !" ; attribue
métaphoriquement au vent le comportement guerrier des
oiseaux ("les vents froids attaquent vos nids") ; compare à un
"mât perdu" au milieu d'un naufrage le "chêne" réduit à sa
silhouette hivernale qui sert de perchoir aux charognards ...
Tout cela est fort réussi.
Un telle tonalité, c'est vrai, relève du premier niveau de
lecture. Mais elle convient aussi, parfaitement, au message
communard, encodé au sein du discours littéral patriotique, tel
que nous l'avons dégagé. Peut-on en dire autant de la tonalité
satirique perçue par les tenants de la lecture anticléricale ? Est-il possible de
diagnostiquer dans un texte une visée secrète contredisant par
l'effet qu'elle provoque le sentiment issu d'une première lecture ? Nous ne le
pensons pas.
Alain Vaillant semble avoir dûment repéré le problème
représenté par ce télescopage entre deux registres. Le bref commentaire
qu'il consacre
aux Corbeaux
dans Parade sauvage n°28 est précisément destiné à
opérer un dépassement dialectique de la contradiction.
Comme nous l'avons
signalé plus haut, il réaffirme la thèse de
l'anticléricalisme, mais en l'assortissant d'une très légère
critique.
Il faut éviter qu'une telle "lecture idéologique" du texte ne
nous détourne de ses "enjeux proprement littéraires". Aussi
doit-on se mettre en quête, au delà de son "thème" fameux, de la
"valeur rhématique du poème" que l'auteur résume ainsi :
"[...] il
faut repérer l'anticléricalisme pour mesurer
l'extraordinaire puissance d'évocation du poème, de cette
vision à la fois terrifiante et fantastique d’un vol de
corbeaux-prêtres s’abattant sur les champs dévastés par
l’hiver et la guerre [...]. Autrement dit,
l'anticléricalisme (thématique) est la condition de la
poéticité du texte, qui constitue pour nous sa valeur
rhématique : Ce que Rimbaud nous permet de comprendre, c’est
que l’anticléricalisme, malgré son caractère doxique (pour
l’époque) et idéologique, est un pur matériau poétique, le
plus lyrique et le plus intense qui soit." (op.cit.
p.58-59).
Ici, à nouveau, une remarque préliminaire étonnée sur la liberté
que prend Vaillant avec sa propre terminologie.
Ce que l'auteur demande de considérer comme "rhème" des
Corbeaux n'a rien à voir, nous semble-t-il, avec la
définition qu'il en donne dans ses attendus théoriques :
un sens indirect constituant le propos original de l'auteur. Il
s'agit seulement d'une question de forme ou plus exactement de
tonalité du texte. Mais quittons ces problèmes de mots.
Alain Vaillant, donc, demande au critique rimbaldien de
ne pas négliger l'effet proprement lyrique obtenu par Rimbaud
à partir d'un projet satirique. Un mélange de
registres en effet étonnant et détonnant, voire détonant. Il en donne comme exemple
« cette vision à la fois terrifiante et fantastique d’un vol de
corbeaux-prêtres s’abattant sur les champs dévastés par l’hiver
et la guerre ». On ne pouvait pas être moins convaincant. Car le
poème des Corbeaux, répétons-le, s'il en vient à se
représenter, à s'imager
dans l'esprit du lecteur, sous la forme grotesque de
curés-vampires planant au-dessus d'un champ de bataille, perd
instantanément toute chance de toucher chez ce même lecteur la
corde de l'empathie et de la tristesse mélancolique.
Entre la vignette satirique et la tonalité élégiaque, il
faut choisir. On touche là aux limites de la
liberté d'interpréter. |
|
|
Novembre 2018
N.B. 1 - On pourra
consulter aussi dans ce site :
N.B. 2 - Dans une réplique à ce
commentaire postée sur son blog "Enluminures
(Painted plates)", le
14/12/2018, David
Ducoffre nous reproche à juste titre d'ignorer un autre possible
intertexte des Corbeaux dû à la plume de François Coppée
: Plus de sang ! Cf. David Ducoffre,
Retour sur le récent article d'Alain Bardel sur le poème "Les
Corbeaux". On trouvera ce texte ici :
http://www.unjourunpoeme.fr/poeme/plus-de-sang.
Comme le rappelle David Ducoffre, Plus de sang !
a paru en plaquette en avril 1871 chez l'éditeur Lemerre. Coppée
y dénonce la guerre civile fratricide qui vient de se déclarer
et surtout, en réalité, les partisans de la Commune. S'adressant
à la France, "pauvre mère indignée", il lui demande de l'aider à
ramener la paix entre ses fils de manière à ce qu'ils puissent
ensemble, demain, reconquérir le Rhin. Nous copions les trois
dernières strophes :
La paix ! faites la paix !
Et puis, pardon, clémence !
Oublions à jamais cet instant de démence.
Vite à nos marteaux. Travaillons.
Travaillons en disant : C’était un mauvais rêve.
Et plus tard, quand mon front qui vite se relève
Lancera de nouveaux rayons,
Alors, ô jeunes fils de la
vaillante Gaule,
Nous jetterons encor le fusil sur l’épaule
Et, le sac chargé d’un pain bis,
Nous irons vers le Rhin pour laver notre honte,
Nous irons, furieux, comme le flot qui monte
Et nombreux comme les épis.
– Dis-leur cela, ma mère,
et, messagère ailée,
Mon ode ira porter jusque dans la mêlée
Le rameau providentiel,
Sachant bien que l’orage affreux qui se déchaîne
Et qui peut d’un seul coup déraciner un chêne,
Épargne un oiseau dans le ciel.
Il est bien possible, en effet,
que Rimbaud ait emprunté à Coppée le motif de l'oiseau (au
dernier vers du poème) en l'assortissant d'un symbolisme tout à
fait différent. Coppée exprime l'espoir que l'orage (la
révolution) épargnera l'oiseau, c'est-à-dire entendra le message
de son "ode", "messagère ailée" de la paix (et de la revanche
contre l'envahisseur allemand). L'espoir de Rimbaud, au
contraire, c'est que l'"armée aux cris étranges" des corbeaux
(et des Prussmars ?) continue à s'abattre sur les "champs de
France", à châtier comme il faut la patrie, mais épargnent les
"fauvettes de mai", messagères du printemps et annonciatrices
d'une tout autre revanche.
|
|
|
 |
| |
|