|
|
Mémoire (1872)
|
|
|
| 4 |
Mémoire
L'eau claire ; comme le sel des
larmes d'enfance,
L'assaut au soleil des blancheurs des corps de femmes ;
la soie, en foule et de lys pur, des oriflammes
sous les murs dont quelque pucelle eut la défense ;
|
| 8 |
l'ébat des anges ; — Non... le courant d'or en marche,
meut ses bras, noirs, et lourds, et frais surtout, d'herbe.
Elle
sombre, avant le Ciel bleu pour
ciel-de-lit,
appelle
pour rideaux l'ombre de la colline et de
l'arche. |
| 12 |
2
Eh !
l'humide carreau tend ses bouillons limpides !
L'eau meuble d'or pâle et sans fond les couches prêtes.
Les robes vertes et déteintes des fillettes
font les saules, d'où sautent les oiseaux sans brides.
|
| 16 |
Plus pure qu'un louis, jaune et chaude paupière,
le souci d'eau — ta foi conjugale, ô l'Épouse !
—
au midi prompt, de son terne miroir, jalouse
au ciel gris de chaleur la Sphère rose et chère. |
| 20 |
3
Madame se tient trop debout dans la prairie
prochaine où neigent les fils du travail ; l'ombrelle
aux doigts ; foulant l'ombelle ;
trop fière pour elle
des enfants lisant dans la verdure fleurie
|
| 24 |
leur livre de maroquin rouge !
Hélas, Lui, comme
mille anges blancs qui se séparent sur la route,
s'éloigne par-delà la montagne ! Elle, toute
froide, et noire, court ! après le départ de l'homme ! |
| 28 |
4
Regret des bras épais et jeunes d'herbe pure !
Or des lunes d'avril au cœur du saint lit ! Joie
des chantiers riverains à
l'abandon, en proie
aux soirs d'août qui faisaient germer ces pourritures.
|
| 32 |
Qu'elle pleure
à présent sous les remparts ! l'haleine
des peupliers d'en haut est pour la seule brise.
Puis, c'est la nappe, sans reflets, sans source, grise :
un vieux, dragueur, dans sa barque immobile, peine. |
| 36 |
5
Jouet de cet
œil d'eau morne, je n'y puis prendre,
ô canot immobile ! oh! bras trop courts ! ni l'une
ni l'autre fleur : ni la jaune qui m'importune,
là ; ni la bleue, amie à l'eau couleur de cendre.
|
| 40 |
Ah ! la poudre des saules qu'une aile secoue !
Les roses des roseaux dès longtemps dévorées !
Mon canot, toujours fixe ; et sa chaîne tirée
Au fond de cet œil d'eau sans bords, — à quelle boue ? |
|
|
Lexique |
|
|
|
ciel-de-lit
: tenture fixée au-dessus d'un lit; synonyme : baldaquin. 
louis
: Pièce d'or ou d'argent à l'effigie des rois de France (de Louis XIII à Louis XVI).


le souci d'eau
: "Le souci d'eau est le nom populaire du populage ou de la caltha,
plante herbacée à fleurs jaunes qui croît dans les endroits
marécageux, dit le dictionnaire. Rimbaud semble avoir choisi cette fleur
pour plusieurs raisons. D'abord pour sa couleur jaune mais aussi pour sa
forme ronde et son éclat, comparables à ceux du louis. [...] Mais ce qui
est non moins important dans le choix de ce nom, c'est son étymologie. Le
souci est du latin solsequium qui veut dire suivre le soleil (sol,
soleil + sequi, suivre)" (Yoshikazu Nakaji, op. cit. p.50).

Soucis d'eau

ombelle
: terme de botanique; type de fleurs composées dont les inflorescences
sont disposées au bout de la tige en forme de faisceaux, comme un parasol
ou une ombrelle.

Ombelle

maroquin
: nom dérivé de Maroc (ce sont les arabes qui ont apporté l'artisanat
du cuir d'abord à Cordoue, puis dans l'Europe entière); désigne un cuir
rouge ou jaune dont on se servait pour l'ameublement ou la reliure des
livres. Généralement porteur d'une idée de luxe. Cf. cet exemple donné
par le Trésor de la Langue Française Informatisé (TLFI) : "Il y a là renfermés, un certain nombre de beaux vieux maroquins sanguins, où la patine du temps a mis comme une pourpre sombre" (E. DE GONCOURT, Mais. artiste, t. 1, 1881, p. 344).

dragueur
: ouvrier chargé d'extraire la vase ou le sable au moyen d'une drague.
Une drague est une sorte de pelle ou une machine montée sur une construction flottante (chaland, bateau, ponton) dont le travail consiste à curer les canaux, rivières, ports, etc. afin qu'ils restent navigables
(d'après le TLFI). 
Les roses des roseaux : le roseau commun est une graminée formée
d'une longue tige fine surmontée d'un plumeau dont la teinte argentée peut
aussi prendre des tons roses :


Delahaye a une autre
explication : "il veut dire les fleurs de
joncs" (op.cit.42.n6). Les joncs en fleur peuvent être roses, en effet :

Roseaux en fleur
Les fleurs de joncs sont
fanées depuis longtemps, parce que la saison en est passée (le contexte
évoque au passé les "lunes d'avril" et les "soirs d'août") et surtout parce
que, symboliquement, pour la rivière féminisée, la saison de l'amour est
révolue (allusion au topos ronsardien du Carpe diem :
Mignonne allons voir si la rose...).

|
|
Interprétations |
|
|
|
La mention "op.
cit." renvoie à la
Bibliographie
Mémoire
(le titre) :
Suzanne Briet
propose (c'est une idée qui sera souvent citée et reprise par les
commentateurs, à sa suite) d'accorder au mot du titre "le double
sens de remembrance du passé et de mémorandum d'une situation donnée
dans le présent. D'une part, la mémoire restitue des impressions et
des événements vécus, et d'autre part, l'œuvre est l'exposé poétique
d'un cas personnel et d'un problème vital. En effet, le drame
familial évoqué par Rimbaud est toujours présent : il est "là" (le
mot se trouve dans le poème). Le passé et le présent sont intimement
liés, d'où l'usage du présent de l'indicatif." (op.cit)
Michael Riffaterre
suggère de déceler dans le titre du poème une sorte de calembour. La
mémoire littéraire de Rimbaud (Banville fait rimer dans
Songe
d'hiver, I, 7-15, le
mot "mémoire" avec le mot "moire"), la langue elle-même et,
peut-être, son inconscient, auraient fait dériver dans l'esprit du
poète le titre "Mémoire" du syntagme "Mes moires". Le calembour
relie, en effet à l'idée du souvenir le thème de l'eau ("moire" se
dit des reflets soyeux à la surface de l'eau), et n'est pas sans
rappeler à l'auteur les chatoiements de la lingerie féminine ("the
top of the line of elegant fabric in interior decorating and in
feminine apparel", op. cit. 189). L'hypothèse est amusante, mais le
caractère intentionnel du jeu de mots est loin de pouvoir être
démontré.
L'eau claire ; comme le sel
des larmes d'enfance, :
La découverte des
manuscrits de Mémoire (1994) et Famille maudite (2004), les
analyses procurées par Steve Murphy des manuscrits du premier
(op.cit. 1994 et 1999) et du second (op.cit. 2004) ont ouvert un champ de
réflexion fort intéressant sur ce premier vers (et sur toute la première
section du poème).
|
Famille maudite |
Mémoire |
|
L’Eau,
—
pure comme le sel des larmes
d’enfance
Ou l’assaut du soleil par les
blancheurs des femmes,
Ou la soie,
—
en foule et de lys pur !
—
des oriflammes,
Sous les murs dont quelque Pucelle eut la
défense,
Ou l’ébat des anges,
—
le courant
d’or en marche,
L’Eau meut ses bras lourds, noirs,
— et
frais surtout,
—
d’herbe. Elle,
L’Eau sombre, avant la nuit pour
ciel-de-lit, appelle
Pour rideaux l’ombre de la colline et
de l’arche. |
L'eau claire ; comme le sel des larmes
d'enfance,
l'assaut au soleil des blancheurs des corps de femmes ;
la soie, en foule et de lys pur, des oriflammes
sous les murs dont quelque pucelle eut la défense ;
l'ébat des anges ; — Non... le courant d'or en marche,
meut ses bras, noirs, et lourds, et frais surtout, d'herbe. Elle
sombre, avant le Ciel bleu pour ciel-de-lit, appelle
pour rideaux l'ombre de la colline et de l'arche. |
Dans Famille
maudite, version du poème considérée comme antérieure à celle de
Mémoire, la
structure rhétorique de la première phrase est relativement simple. Le
premier vers présente (en le soulignant et l'isolant par un tiret) le sujet,
qui est aussi le comparé de la figure analogique complexe qui va suivre (L’Eau,),
puis le sème de la comparaison (l'adjectif épithète : pure), puis le
mot-outil (comme), puis quatre comparants constitués par des groupes
nominaux séparés par des virgules. Intervient à cet endroit une ponctuation
légèrement plus marquée (la virgule étant renforcée par un tiret) suivie par
une circonlocution en apposition renvoyant au comparé (le courant
d’or en marche,), après quoi apparaît enfin le verbe de la
phrase suivi de ses compléments (meut ...) précédé d'une reprise du sujet (L’Eau) afin d'être bien
clair.
Le dispositif, tout en restant très semblable, se complique un peu
dans Mémoire.
Passons rapidement sur le remplacement de "pure" par "claire". Les
sèmes de clarté et de pureté sont de toute façon mêlés dans la quadruple
comparaison proposée par la phrase. Rimbaud a-t-il souhaité éviter la
répétition avec le "pur" du vers 3, ou marquer davantage le rôle de la
lumière, donc de l'interpénétration entre le soleil et l'eau, du facteur
libidineux pourrions-nous dire (eu égard à l'érotisation de la relation
entre eau et soleil tout au long du texte), dans la vigueur matinale et juvénile de la
rivière ? Les deux sans doute.
Passons aussi rapidement aussi sur la suppression des trois "ou". Rimbaud
les a sans doute trouvés trop insistants, trop lourdement logiques. Mais
leur suppression, par elle-même, ne change pas la structure de la phrase dès
lors que les conjonctions sont remplacées (dans deux cas sur trois) par des
points virgules (V.2,4) dont le sens est équivalent. Et c'est là
qu'intervient le problème des changements de ponctuation intervenus au vers
1, changements étudiés avec une grande précision à plusieurs reprises par
Steve Murphy.
Avant même qu'on ne connaisse Famille maudite certains
éditeurs avaient estimé nécessaire, car plus logique, de placer un point-virgule à la fin du premier vers
(comme après les syntagmes comparatifs des vers 2, 4 et 5) bien que sa présence
sur le manuscrit soit contestable : selon Steve Murphy l'observation
du manuscrit montre que Rimbaud a prolongé le "e" terminal du mot "enfance"
de manière "à occulter et à annuler le point virgule" d'abord tracé (1999
p.831) :
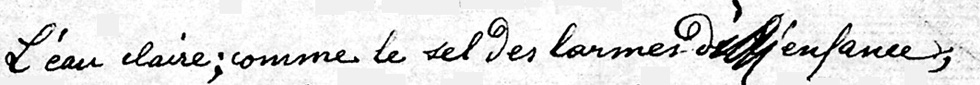
La modification très
significative du début de vers par rapport à ce qu'il était dans Famille
maudite (l'inscription d'un point-virgule après "l'eau claire")
dénote une intention convergente. La conséquence de cette double modification, écrit
Steve Murphy, est que "de comparant, 'le sel des larmes d'enfance'
devient le comparé des trois comparants qui suivent" (2004, p.415). Sur le
plan de l'interprétation, nous dit Murphy, l'effet de cette association
entre "le sel des larmes d'enfance" et les "blancheurs des corps des femmes"
lançant leur assaut sous ou plutôt contre le soleil est d'affecter
les dites "blancheurs" d'une coefficient négatif alors qu'on aurait pu leur
prêter une connotation positive (2004, p.283). L'ambiguïté sous/contre, en
effet, déjà présente dans Famille maudite sous une formulation
différente, est trop manifeste pour ne pas être intentionnelle et porteuse
d'un sens caché. La remarque de Murphy est donc logique, mais il me semble difficile d'adhérer
à l'interprétation politique qu'il donne à cette suggestion d'agressivité
féminine (la peau blanche, comme on le voit dans Les Mains
de Jeanne-Marie, serait la caractéristique des femmes de
l'aristocratie). Je risque une autre glose possible (mais fort incertaine) :
Rimbaud pourrait avoir voulu suggérer que la séparation entre l'eau et le
soleil, c'est-à-dire symboliquement la dispute entre la Femme et l'Homme,
n'était pas pour rien dans les "larmes d'enfance".

L'assaut au soleil des blancheurs des
corps de femmes :
Le travail de Rimbaud dans Mémoire se caractérise par la recherche
constante de l'énoncé ambigu. Ainsi, devant le vers 2 ("l'assaut au soleil
des blancheurs des corps de femmes"), on peut envisager une double lecture :
contre le soleil / sous le soleil. Notons que la formulation de Famille
maudite, bien que différente, était déjà fort ambiguë, le groupe
circonstanciel introduit par la préposition "par" pouvant être compris soit
comme le complément d'agent d'"assaut" (nom verbal de sens passif), soit
comme un complément de lieu : "L’Eau,
—
pure comme le sel des larmes d’enfance / Ou l’assaut du soleil par les
blancheurs des femmes, [...]".
Le consensus est total parmi les critiques pour considérer que
Rimbaud a souhaité cette ambiguïté. Michel Collot commente ainsi le
passage : "On peut lire dans le premier quatrain une évocation de l'union du
Père et de la Mère, de la rivière et du soleil, résumée par la formule
initiale ('Leau claire'), et présentée, conformément à l'interprétation
sadique des rapports conjugaux, comme un combat ; l'agression étant dirigée
tantôt contre l'acteur masculin ('L'assaut au soleil des blancheurs des
corps de femmes'), tantôt contre l'acteur féminin ('la soie, en foule et de lys pur, des oriflammes /
sous les murs dont quelque pucelle eut la défense')"
(op. cit. 1988, p.163).

sous les murs dont quelque pucelle eut la
défense :
"L'évocation de
'quelque pucelle', écrit Henri Meschonnic, est une harmonique du
thème de l'enfance par le rappel d'images du livre d'histoire de l'enfant.
De même les anges du vers 5, que reprendra le vers 22" (op.cit. p.105).
La remarque n'est pas nécessairement contradictoire avec l'interprétation
érotique mentionnée dans la note précédente.

l'ébat des anges :
"Le mot "ébat", employé généralement au pluriel, désigne "les
mouvements folâtres exprimant la joie de vivre" (TLFI). Fréquemment employé
pour évoquer la mêlée
amoureuse (les "ébats amoureux"), il contribue ici à suggérer un symbolisme érotique,
partout implicite dans ce début de texte. Appliqué à des anges, il recherche
à l'évidence un effet d'ironie (comme d'ailleurs le chromo de "la pucelle"
d'Orléans, au vers précédent).
L'ébat des anges, qu'est-ce que c'est, se demande Peter
Collier ? Est-ce le reflet des nuages sur la surface de l'eau ?
Oui et non, car ce sont aussi les mouvements en profondeur des
herbes fluviales" (op. cit. p.70).
Pour Michel
Collot, ce début du poème peut être interprété comme une « version
optimiste de la scène primitive » ; l’ « ébat des anges » nous fait
« assister à l’apothéose fulgurante du coït parental » (op. cit. p.163).
Ces anges métaphoriseraient,
selon Steve Murphy, "les flèches d'or du soleil" (2004,
p.286). Mais le même auteur rappelle dans la note 48 de cette même
page que Rimbaud, dans
Beth-Saïda,
utilise la comparaison avec un "ange blanc" dans une description de reflets
aquatiques : "le soleil de deux heures après midi, laissait s'étaler une
grande faux de lumière sur l'eau ensevelie [...] dans ce reflet, pareil à un
ange blanc couché sur le côté, tous les reflets infiniment pâles remuaient."
Dans le contexte de ce début de Mémoire, je serais tenté d'y voir
d'abord une image de corps nus
et blancs : l'assaut au soleil des blancheurs des corps des anges. Voir la représentation traditionnelle des anges en liesse
dans l'iconographie religieuse, ci-dessous chez Rubens. Comme la métaphore des "blancheurs des corps de femmes"
(v.2), celle-ci vise à restituer l'impression visuelle produite par les ondulations
de l'eau sous le soleil. Dans les deux formules, le galbe des corps en mouvement
mime les renflements du flot,
animé d'un élan impétueux que le poète décrit comme un "assaut
au soleil" (assaut lancé sous le soleil et contre lui).
Ce sont les mêmes sèmes de mouvement, de formes arrondies et de
blancheur éclatante qui ressortent, aux vers 3-4, des "oriflammes" :
gonflements soyeux de drapeaux blancs fleurdelisés agités par le
vent.
Les commentateurs se sont souvent contentés de relever, dans ces
images de la première strophe du poème, l'isotopie de la blancheur. Mais
tout aussi caractéristique est la convergence des notations de mouvement
ressortant des noyaux substantifs de ces phrases nominales : "l'assaut",
"l'ébat", "le courant". Paule Lapeyre décrit de façon pertinente la
façon dont ce sème de mouvement est mis en relief par la syntaxe. Le texte,
écrit-elle, "nous invite à contempler 'l'ébat des anges', non des anges qui
s'ébattent, 'le courant d'or en marche', non l'eau dorée qui court ou marche
et 'l'assaut au soleil des blancheurs de corps de femmes' au lieu des corps
blancs des femmes [...] ainsi les mouvements essentiels sont saisis avant
l'objet mouvant". Certains commentateurs déduisent de "l'assaut au soleil"
(compris comme "contre le soleil") que le poète a souhaité exprimer un
mouvement ascensionnel. L'iconographie traditionnelle des ébats angéliques
confirmerait assez cette intuition. 

Pierre-Paul Rubens,
L'assomption de la Vierge
— Non... le courant d'or en marche, :
"Le courant d'or en
marche" peut être considéré comme un syntagme métaphorique désignant
la rivière, lorsqu'elle est dorée par le soleil.
C'est encore un exemple du goût bien connu de Rimbaud pour la création de
figures nouvelles à partir d'une catachrèse. Processus paradoxal ici puisque
le mot "courant" est seulement rendu à son sens premier. Il est déchargé de
la valeur métaphorique qui est la sienne dans la catachrèse du "courant
d'air" dont la tournure analysée est dérivée. La substitution métonymique de
l'or-matière au doré-couleur et la personnification largement lexicalisée
"en marche" représenteraient à elles seules la valeur créative de la figure
s'il n'y avait la perception chez le lecteur de l'élément ludique constitué
par le détournement de la catachrèse (paronymie /or-air/ ; parallélisme des
constructions syntaxiques avec la préposition "d'"). Jean Gilibert
commente ainsi le procédé : "'Le courant d'or en marche' ne doit pas faire
illusion quant à l'assonance à laquelle personne ne peut se soustraire : 'le
courant d'or' pour le 'courant d'air'. Le glissement de sens ne va donc ni
contre la perte du sens premier (le courant d'air) ni pour son maintien
(dans courant d'or, il faudrait 'lire' courant d'air, comme on ferait pour
un processus de déplacement de condensation tels qu'ils s'exercent dans les
processus primaires du travail du rêve). Le "courant d'or", par sa
néoformation, est un nouveau sens qui dit adieu à ce qu'un consensus avait
trop prosaïsé. Car il y avait de la poésie dans le 'premier' courant d'air ;
il n'y en a plus maintenant ; la métaphore est usée ; la poésie 'nouvelle'
du 'courant d'or' demande plus qu'une reconnaissance ; elle demande le
déploiement de sa marche vers l'horizon de sa mort, plus simplement, de sa
défaite" (op. cit. p.83).
La critique est quasiment unanime à conférer une
puissante ou, du moins, significative valeur contradictoire au "Non"
du vers 5 de Mémoire.
Michel Collot voit dans le "Non" du vers 5 "une violente
rupture sémantique, syntaxique et prosodique" et, développant l'idée, il
écrit : "À l'image du couple réuni par le plaisir, de l'eau investie par la
clarté solaire et animée d'une sorte d'élan ascensionnel, succède celle du
"courant d'or en marche", dont le mouvement horizontal et 'lourd' ne quitte
pas le niveau de 'l'herbe'" (op. cit. p.163).
Suzanne Bernard voyait de son côté un contraste
porteur de sens entre la couleur blanche et claire des quatre premières
comparaisons et la couleur dorée du "courant... en marche". Elle paraphrase
ainsi le passage : "Non, ce n'est pas là une eau claire et blanche mais un
courant d'or en marche (à cause des reflets du soleil), et ses bras sont
noirs d'herbe" (op.cit. P.446).
Steve Murphy envisage qu'il puisse s'agir ici à la fois d'une
synthèse des images précédentes et d'une évolution de l'aspect de la rivière
due à la progression de la journée : "la vision plutôt éclatée de la
blancheur initiale tend à se recomposer et à s'unifier, la rivière prenant
une nouvelle coloration dorée ("le courant d'or") qui restera au cœur de la
section 2 (v.10 : "d'or pale" ; v.13 : "louis", "jaune", "souci d'eau") ; il
s'agit, comme la suite le confirme, de la lumière d'abord "d'or pâle" du
soleil qui, bien après l'aube, monte dans le ciel." (2004, p.240).
Henri Meschonnic reconnaît ici ce geste fréquent de retour
sur l'illusion lyrique (telle que la véhicule le travail métaphorique) par
un rappel à la réalité de la chose vue, que l'on peut observer dans les
derniers poèmes de Rimbaud : "'L'ébat des anges', métaphore des 'bouillons
limpides' du vers 9, est à la limite de la chose vue et de la figure de
rhétorique. Il est caractéristique du traitement de la rhétorique chez
Rimbaud, dans ces derniers poèmes, que la figure soit niée par l'intrusion
même de la rhétorique (Non...) pour réinstaller l'ordre du visuel." (op.
cit. p.105).
Peter Collier perçoit dans ce "Non" la
caractéristique d'un poème "plein de refus et de négations" (op. cit. p.61)
Pierre Brunel rappelle que la critique rimbaldienne a
voulu voir dans l'interruption par ce "Non..." de la séquence comparative
introduisant le texte l'expression des "refus" multiples du poète : "refus d'une
poétique jugée périmée ? refus profonds de Rimbaud — plus de larmes, plus de
femmes, plus de rois, plus de religion ?" (Rimbaud, Œuvres, La
Pochothèque, 1999, p.364, n.3).
Personnellement, je ne suis
pas certain que Rimbaud ait voulu opposer aussi emphatiquement "le courant
d'or en marche" aux images précédentes.
Au risque de paraître réducteur, je rappelle que "non" est mis
entre parenthèses dans le manuscrit et que Rimbaud semble avoir eu
l'intention de le supprimer pour pouvoir introduire un "ou" en tête de vers,
ce qui tend à montrer que cette négation n'était pas jugée par l'auteur
absolument indispensable. Je remarque aussi que, dans Famille
maudite, le mot "non" ne figure pas et que le syntagme "le courant d'or
en marche", simple apposition à "L'Eau", apparaît davantage comme un
résumé synthétique et réaliste de ce qui précède que comme une
remise en cause ou même une évolution de la perception. En tout cas, on n'y saurait trouver aucune contradiction avec les
caractéristiques visuelles des images précédentes. S'il y a opposition,
c'est moins en amont qu'en aval, entre "le courant d'or" et les
teintes lugubres évoquées aux vers suivants ("noirs", "sombre", "ombre",
"nuit").
Je rappelle encore que le mot-phrase négatif, inséré dans une
séquence de perceptions incertaines, est un lieu commun de l'écriture de
l'illusion (visuelle ou auditive).
Cf. par exemple ce haïku d'Ichû : "Roulement de tonnerre ? / Non. Des pas de
rats sur les toits m'ont éveillé / C'est l'été" ; ou Hugo dans
Les Orientales : "Tout est désert : mais non, seul près des murs
noircis, / Un enfant aux yeux bleus..." ; ou Mallarmé dans
L'Après-midi d'un faune, version de 1865 (inédite
en 1872) : "Ce vol… de cygnes ? non, de naïades, se sauve." Une vision jugée
douteuse est remplacée par une nouvelle hypothèse considérée comme plus
satisfaisante.
Ce nouveau jugement perceptif, néanmoins, peut lui-même susciter à
son tour un soupçon d'irréalité et de méprise : les naïades existent-elles
vraiment ? L'évocation de la vision prend conséquemment la forme d'un
enchaînement de dénégations successives et c'est ainsi que John Lapp,
par exemple rend compte du début de Mémoire.
La
pratique de l'image que l'on observe au début du poème, nous dit ce
critique, est à la limite « anti-métaphorique » (1971 : 167) au sens où
chaque évocation nouvelle, plutôt que de chercher à « préciser ou
amplifier », comme c'est la fonction traditionnelle des comparaisons, vise
« l'effacement momentané d'un état visuel par l'autre ». Cet effet d' « à la
place de », de substitution abrupte ou de superposition, serait propre à
l'expérience hallucinatoire telle que la décrit Baudelaire dans Les
Paradis artificiels.
C'est ainsi qu'il faut comprendre, selon moi, la fin de la séquence
comparative, au deuxième quatrain. Après l'enchaînement
rapide d'associations insolites suscitées par ce qu'on a appelé "une
symphonie en blanc majeur" (François Ruchon) ou "l'épiphanie
de la blancheur" (Alain Badiou), le locuteur en vient à une
représentation plus
rationnelle de ce qu'il voit qui ne contredit pas vraiment les impressions
antérieures mais en corrige l'aspect fantasmagorique et en précise la nature. Le syntagme "le courant
d'or en marche", en effet, précise le comparé (courant = cours d'eau,
rivière), dégage les principaux sèmes (or = lumière solaire ; en marche =
mouvement impétueux). Il propose au lecteur une image plus
compréhensible et réaliste de l'objet de la description, presque un cliché ...
Mais, la lumière ayant peut-être changé sous l'effet d'un événement naturel
(l'état du ciel, l'interposition d'un obstacle à la vision) et/ou l'acuité
(visuelle et intellectuelle) de l'observateur se renforçant, cette
perception lumineuse de l'eau va être à son tour révoquée en doute
(ainsi que tout ce qui précède) dans les vers 6-7-8, par la révélation de la face nocturne, sombre et froide,
de l'Eau, quand elle n'est pas infusée de soleil.

Elle
:
Le pronom personnel "Elle" (v.6) n'est
pas suivi d'une virgule, comme il serait logique si l'on considère
"sombre" (v.7) comme un adjectif. Toutes les éditions, depuis
celle de H. de Bouillane de Lacoste (Mercure de France, 1939),
attestent cette ponctuation (ou absence de ponctuation). En décembre
1994, Steve Murphy publiait dans Parade sauvage, grâce à
"la générosité d'un collectionneur" qu'il remerciait de tout cœur
"sans pouvoir le nommer", un fac-similé inédit du manuscrit de
Mémoire. Ce document essentiel confirme l'absence de
virgule.
Certains commentateurs n'en interprètent pas
moins "sombre" comme un adjectif. C'est le cas de Suzanne
Bernard, par exemple, qui écrit : "Il faut alors penser que le courant
d'or devient sombre au moment où la rivière reçoit l'ombre
de la colline et de l'arche" (Classiques Garnier, note 3). De même, Albert
Henry (op. cit. p. 219) considère qu'il faut lire comme s'il y avait
une virgule et rapproche des vers 23-24 : "Elle, toute / froide, et
noire, court!". Steve Murphy, au contraire, tend à lire
"sombre" comme un verbe (op. cit. 2004, p. 290).
La découverte récente (2004) de Famille
Maudite, édité et commenté par Steve Murphy dans ses Stratégies
de Rimbaud, renforce néanmoins sérieusement la thèse de l'adjectif
(sérieusement mais pas de façon décisive, vu la tendance du poète à
faire évoluer son texte et à y introduire des ambiguïtés volontaires).
Rimbaud y écrit en effet : "Elle,
/ L’Eau sombre,
..." 
avant
:
Jusqu'à
une date récente, la majorité
des éditions croyaient devoir corriger le manuscrit de Rimbaud (tel qu'il
avait été décrit par Henri de Bouillane de Lacoste, Mercure de
France, 1939), en remplaçant "avant" par "ayant".
Ainsi, Suzanne Bernard, dans son édition aux Classiques Garnier,
caractérisait "avant" de "lapsus" (note 4). Antoine Adam, dans son édition de La Pléiade (p.944),
considérait que la leçon du manuscrit ne pouvait être qu'une
"distraction". Et Louis Forestier, dans son édition chez
Robert Laffont (p.479), ne lui trouvait "aucun sens". Dans son
article de 1994 (op. cit. p.72) Steve Murphy dénonçait dans cette
tradition une correction intempestive : "dans un poème émaillé de
mouvements temporels déconcertants qui scandent l'écoulement d'une
source vers la boue d'une rivière, le "avant" du vers 7,
accompagné du verbe "appelle" qui prévoit également un
"après", n'a guère le caractère inacceptable qu'on lui
impute".
Les éditeurs récents (Brunel, Murphy)
maintiennent "avant".
Quant au sens, il nous semble qu'on peut retenir
celui que proposait déjà Henri de Bouillane de Lacoste :
elle appelle l'ombre pour rideaux avant (d'appeler) le ciel bleu pour ciel
de lit (Suzanne Bernard, Classiques Garnier, Mémoire, note 4). 
le Ciel bleu :
Il est intéressant, ici, de remarquer que Rimbaud, dans Famille
maudite, avait écrit "avant la nuit pour ciel-de-lit". La correction est
de conséquence, elle correspond à une volonté de
rationalisation des indices temporels, très significative du souci
architectural de Rimbaud. Dans FM, la formulation du v. 7 « L’Eau
sombre, avant la nuit pour ciel-de-lit » montre que Rimbaud avait d’abord
opté pour une présentation d’ensemble de l’allégorie (« Elle » comme entité
à deux visages, « courant d’or en marche » versus « Eau sombre », lourde,
noire, nocturne) dès la première section. Dans M. il revient sur ce choix :
il remplace « avant la nuit » par « avant le ciel bleu » au v.7.
Corrélativement, il supprime « l’antique matin » au début de la section 2 et
remplace, en quelque sorte, cette indication par « au midi prompt », inséré
au v.15, de manière à suggérer une progression temporelle entre la section 1
(matin) et la section 2 (midi).
Du coup, la face
obscure de l’Eau-femme reste bien indiquée dès la seconde strophe du poème,
mais il faudra attendre la fin de la sixième pour que le crépuscule tombant
sur le paysage fluvial qui sert de décor à l’allégorie vienne en compléter
l’argument narratif.
Michel Collot, me semble-t-il, avait en quelque sorte anticipé
la découverte de Famille maudite et/ou deviné l'alternative qui s'est
présentée à l'esprit du poète au moment de corriger son texte, lorsqu'il
écrivait en commentant les images sombres des vers 7-8 : "L'heure n'est
plus, ou pas encore, au devoir conjugal. On peut penser à un crépuscule, qui
présagerait celui du vers 23" (op.cit. p.163 et n.12). Dans Famille
maudite, en effet, c'est comme pour hâter la venue de "la nuit" que la
rivière "appelle pour rideaux l'ombre de la colline et de l'arche". On peut
penser que "l'heure n'est plus", pour elle, au devoir conjugal. Dans
Mémoire, par contre, le même geste (d'appeler les rideaux, etc.),
présenté comme antérieur à l'union sous "le Ciel bleu", peut être interprété
comme un geste de pudeur virginale, de résistance bientôt vaincue.
"L'heure", dès lors, "n'est pas encore au devoir conjugal". Rimbaud a
peut-être choisi cette solution parce qu'elle permettait de situer les deux
premières strophes le matin (un symbolique matin de la vie) avant
d'enchaîner logiquement sur la deuxième section du poème, située "au midi
prompt" et ainsi de suite jusqu'au crépuscule da la section 4 et à la nuit
de l'âme représentée par la section 5. 
appelle /
pour rideaux :
Steve Murphy résume bien la perplexité du lecteur désireux
de donner un sens univoque à ce geste de la rivière féminisée : "ces rideaux
sont non seulement une partie d'un lit à baldaquin (cf. Bottom dans
Les Illuminations) mais aussi un métonyme ou une métaphore du non-dit
ou de l'interdit (cf. tirer le rideau sur quelque chose), en particulier à
titre d'emblème de la pudeur sexuelle — à moins que l'euphémisme ne soit
retourné en son contraire, comme manière suggestive et presque obscène
d'insinuer des rapports sexuels. Mais ces rideaux de la domesticité (de la
domestication ?) ont aussi une autre signification contextuellement évidente
puisqu'il s'agit d'utiliser ces rideaux pour cacher dans l'ombre la scène
érotique qui se prépare, alors que cette union sexuelle doit se faire avec
le soleil : laisser dans l'ombre, c'est encore le secret, mais faire régner
l'ombre n'est sans doute pas la meilleure manière d'attirer le soleil :
c'est un stratagème qui servirait plutôt à s'en protéger, la pudeur laissant
imaginer dans cette optique la possibilité d'un manque de chaleur
(affective, érotique), même si pour l'instant la rivière semble encourager
les attentions érotiques du soleil. C'est peut-être déjà l'amorce d'une
contradiction essentielle entre les aspirations de la rivière et la nature
même du soleil." (op.cit. 2004, p.293).
L'ombre de la colline et de
l'arche :
Paterne Berrichon, qui avait épousé
Isabelle, sœur de Rimbaud, a publié plusieurs témoignages concernant
son beau-frère. Dans l'un d'entre eux (Rimbaud en 1870-1871,
Mercure de France, 1er novembre 1910) il apporte les explications
suivantes sur le contexte biographique de Mémoire :
"Madame
Rimbaud, pendant les vacances scolaires, avait l'habitude d'aller promener
ses enfants dans la prairie qui séparait alors Mézières de Charleville
[...] Les garçons, ordinairement, profitaient de la présence de barques
amarrées au bord de la Meuse pour se livrer à une navigation n'allant
pas plus loin que le bout de l'amarre [...] Du quai de la Madeleine, quand
on avait franchi Charleville et atteint le viaduc séparant les deux cités, on accédait à la prairie par une ouverture ménagée à
l'extrémité de la balustrade de ce viaduc, au point de sa jonction avec
le pont-levis rabattu sur le fossé des fortifications de Mézières, et
après avoir suivi le long du fossé un terrain en pente planté de
peupliers". Cité par Steve Murphy, op. cit. 2004, p.
331.
La critique rimbaldienne, tout en manifestant
souvent un scepticisme de principe à l'égard d'interprétations
biographiques jugées simplificatrices, n'a jamais véritablement remis en
cause la validité de ces références pour expliquer certains détails de
Mémoire, comme ici "l'arche". Citons pour exemple ce
commentaire de Suzanne Briet (op. cit.
p.37) :
"le lieu —
ou, si l'on préfère, le décor — est donné par Charleville (le pays
natal), la prairie amoureuse ou l'île du Vieux Moulin, le Mont Olympe, et
la Meuse". Voir aussi plus loin nos notes sur "les chantiers
riverains" et "par-delà la montagne".

l'humide carreau tend ses bouillons limpides
:
Le sens immédiat de cette expression ne fait pas
problème : le "carreau" est la surface à la fois transparente
et réfléchissante de la rivière (sens de vitre),
"humide" cela va de soi. Pour Michael Riffaterre (op.
cit. p.185), il y a là un exemple typique du goût de Rimbaud pour le
dynamitage humoristique des lieux communs de la poésie : "l'humide
carreau" parodierait, en style prosaïque, les évocations romantiques du
"cristal liquide" (Nodier), des "mobiles vitraux" ou des "humides
vitraux" d'une fontaine (Sainte-Beuve).
"Bouillons" se comprend
aisément comme eaux bouillonnantes, "limpides" parce qu'éclairées par le soleil.
Steve Murphy attire l'attention sur la relative contradiction
entre l'image du "carreau", évoquant une surface lisse, et celle des
"bouillons". Il s'agit, dit-il, d'une "complication perceptuelle", dont
la notion n'est cependant pas absente de la langue puisque, selon
Littré, on désigne couramment du mot "bouillon" une bulle d'air restée
dans le verre et en faussant la transparence (op. cit. 2004, p.294-295).
Le verbe "tendre" est un peu
inattendu. On attendrait plutôt "étendre" ou
"étaler". Steve Murphy suggère le sens de "tendre
quelque chose à quelqu'un" : la rivière se tend vers le soleil,
s'offre au soleil (op. cit. 2004, p.294, p.417).
L'anthropomorphisme généralisé du passage
a cependant conduit plusieurs commentateurs à envisager d'autres
interprétations. Remarquant le choix systématique de
termes susceptibles d'évoquer la vie domestique ou l'ameublement d'une
maison, Paule Lapeyre écrit par exemple : "Ainsi le carreau
est sans doute la surface de l'eau qui s'interpose entre l'œil scrutant
et le fond, comme une vitre, ou bien le carrelage ou le pavement que
semblent dessiner les vagues au fond ou à la surface, dans une sorte de
bouillonnement. Mais si l'on admet que le carreau peut être la pierre qui
sert de base à une cheminée, le mot bouillons apparaît dans
toute son ambiguïté sémantique. À la cheminée s'associe l'image des
bouillons culinaires qui se superpose au sens premièrement appréhendé
de bouillonnement" (op. cit. p.33). 
L'eau meuble
d'or pâle et sans fond les couches prêtes :
Les commentateurs désireux de mettre en valeur le
brouillage référentiel comme une caractéristique éminente de la
modernité rimbaldienne citent souvent ce vers comme un exemple
d'hermétisme. Il paraît cependant fort exagéré d'y voir une phrase "qui
n'a pas à proprement parler de 'sens'", "clairement insoluble",
"évidemment ininterprétable", ainsi que l'écrit Jean-Marie Gleize
(op.cit. p.38-39), ajoutant :
"Personne, jamais, ne pourra
justifier ce que c'est que meubler pour l'eau ...
[sauf celui qui a remarqué
que l'eau est ici femme et épouse en sa maison, performance
intellectuelle qui n'est pas hors de portée
du lecteur moyen (c'est évidemment moi qui commente)]
et ce que
sont ces couches ; ...
[sauf celui qui se souvient de la strophe précédente où
le lit de la rivière est assimilé à la couche de l'épouse]
ni pourquoi
l'or est 'pâle'...
[probablement parce que le poème évoque des reflets et
que l'or solaire pâlit en se reflétant dans l'eau sombre de la rivière]
et sans fond."
[sans doute parce que Rimbaud pratique ici une sorte
d'hypallage généralisé : ce n'est pas l'eau mais le soleil qui meuble
d'or pâle la
rivière, ce n'est pas l'or pâle qui est sans fond mais
l'eau parce qu'elle est sombre : ces procédés, en effet, brouillent la
référence,
mais dans une certaine mesure seulement].
À
propos de "meuble", Paule Lapeyre écrit : "À l'évocation des reflets
du soleil sur le fond sableux se joint, irrésistiblement et plus ou moins
consciemment, l'image de la chambre et du lit nuptial, puisque la couche est
un lit (le lit de la rivière ou le lit conjugal, c'est-à-dire un meuble,
justement)." (op. cit. p.33).
Nathaniel Wing a proposé pour ce vers une
interprétation convaincante : "Les éléments 'les
couches prêtes' rappellent les images 'ciel de lit', 'rideaux', et
maintiennent une ambiguïté semblable entre les codes naturel et humain.
Le suspense est intensifié ici par l'adjectif 'prêtes' qui prolonge la
tension introduite par l'énigmatique mouvement introduit par 'tend' [au
vers précédent]. Les deux termes laissent entendre une prochaine union
entre l'eau et le soleil ; l'eau s'étend vers la lumière et prépare un
lit." (op.cit. 199). 
Les robes vertes et déteintes des fillettes /
font les saules :
Jean Gillibert commente ainsi ce passage : "Ce
n'est ni une métamorphose réciproque de saules près d'une rivière en robes
(vertes et déteintes) de fillettes, ni une analogie de présence, les robes
et les saules se ressemblent, en ce que les saules se mirent dans l'eau,
ajoutant une présence, par le flou et le tremblé du reflet, comme dans une
toile impressionniste, et en ce que, dans le même temps, les robes
acquièrent leur flou et leur 'tremblé' par la qualification 'déteintes' ; on
aurait trempé leur couleur verte dans l'eau et le vert n'y aurait pas
résisté. Non, les robes font les saules ; Etre = faire = pure magie.
'Toi, tu fais le voleur, toi, tu fais le gendarme' décident les enfants ;
car c'est de décision — poétique — qu'il s'agit ; ici, avec Rimbaud, c'est
le langage qui décide, c'est-à-dire la relation référentielle qu'est tout
langage, avec un monde qui serait déjà un langage" (op.cit. p.87).
Dans un commentaire sensible aux écarts rimbaldiens par
rapport à une esthétique classique de la représentation, Jean-Marie
Gleize explique qu'ici "le charme de la lecture" vient de
l'impossibilité de dire simplement que le poète compare la rivière à une
chambre et le reflet des saules qui la bordent à des fillettes en robes
vertes : "La chambre sort de la rivière, il faudrait dire, de la langue, de
sous la langue" (c'est de la façon anthropomorphique dont la langue décrit
la rivière que dérivent les images du "lit", des "bras"). "On le comprend
bien, ajoute le critique, lorsque apparaissent dans le texte des 'fillettes'.
À quel espace appartiennent-elles ? Elles sont quelque part autour du lit
(de l'un ou l'autre 'lit'). Ce qui est tout à fait clair, c'est que les
'saules' (pleureurs, comme bientôt Elle) semblent issus des robes des
fillettes. J'ai dit (ou plutôt observé) : la rivière est d'abord ; si cela
était absolument, il y aurait des saules et puis les robes des fillettes,
vertes comme les saules ; or, il y a ces robes, qui 'font les saules'.
Les saules sortent des robes comme la chambre sort de la rivière. Toutes ces
différentes figures, ciel, arche, lit, robe, saule, etc. sont en vérité (en
mémoire textuelle) les uns dans les autres, sans autre lieu que le lieu
mental et le lieu du poème." op.cit. p.38. 
d'où
sautent les oiseaux sans brides :
Alexandre Amprimoz note que "ces images préparent déjà "la
poudre des saules qu'une aile secoue" et suggère que les fillettes "semblent
envier la liberté des 'oiseaux sans brides'" (op.cit. p.75)

au midi prompt
:
Rares sont les commentateurs qui glosent
l'adjectif avec précision. Faut-il, comme Paule Lapeyre (op.
cit. p.33), y voir une idée de fugacité : "Mais cette halte
au zénith, ce "partage de midi", est prompt et la
double union prendra fin au couchant" ?
Benoît de Cornulier fournit l'explication
suivante : "À l’époque de Rimbaud, « midi », sans article comme dans «
Au réveil, il était midi », est comme une espèce de nom propre (employable
adverbialement) désignant le milieu de la journée solaire ; mais « midi »
nom commun, avec article comme dans « le midi » ou « au midi », n’a pas ce
sens « horaire » et désigne plutôt le secteur ou la direction du soleil à
midi (comme « le sud »). Le sens horaire de « midi » est donc exclu dans «
au midi prompt ». – D’autre part, dans II : ii, « jalouse » ne peut qu’être
la forme indicative du verbe « jalouser ». – Enfin, comme il est apparemment
peu pertinent de comprendre que le souci est au midi (au sud de quoi ?),
l’interprétation de « au midi prompt » comme signifiant par antéposition «
prompt au midi » semble s’imposer ; c’est encore un latinisme de l’auteur,
signifiant à peu près « à la disposition du midi » comme « promptus alicui »
signifie à peu près « à la disposition de quelqu’un ». Sur le plan naturel
de l’analogie, on peut comprendre que le souci, étymologiquement rattachable
au latin « solsequium » (qui suit le soleil), est tourné vers le soleil
(qui, au moment où il est le plus chaud, se trouve dans le secteur du midi)
et, sans pouvoir aller vers lui, s’ouvre à ses rayons ; sur le plan humain,
on peut comprendre que l’Épouse est à la disposition du mari, non seulement
sexuellement, mais, d’une manière beaucoup plus générale, selon
l’interprétation de la malédiction d’Ève qui fait de la femme la servante,
voire l’esclave de l’homme." (op.cit. p.92).
Marc Dominicy partage cette analyse sémantico-syntaxique
avec une nuance, sur laquelle il fonde une interprétation plus radicale du
symbolisme sexuel de la phrase (v.13-16) : "La quasi-totalité des
commentateurs (dont Steve Murphy) voient dans prompt une simple
épithète de midi ; seuls Jacques Gengoux et Giampietro Marconi ont
deviné que prompt, rapporté au sujet grammatical le souci d'eau,
régit au midi placé en inversion, sur le modèle du tour latin
promptus ad + accusatif. L'un et l'autre auteurs glosent prompt au
midi en « tourné vers le midi ». Une telle lecture, qui attribue au
souci d'eau (ou populage des marais) l'héliotropisme du tournesol, se
laisse justifier par l'étymologie, quoique Rimbaud ait pu ignorer le terme
de basse époque solsequium ou solsequia ; promptus, de
toute manière, n'autorise pas cette interprétation. En réalité, il faut
comprendre « exposé, ouvert au
midi » : en tant que métaphore de la femme et de ses organes génitaux, le
souci d'eau s'offre à la pénétration que lui inflige le soleil de midi." (op.cit. 2013,
p.171). Pour Dominicy, en effet, "on ne peut que déceler, dans le jaune
[...] souci d'eau de Famille Maudie / Mémoire 13-16, une
métaphore du pubis ; les épithètes chaude et grasse ne
laissent subsister aucun doute à cet égard." (ibid. p158) ; "chaude
et grasse évoquent les propriétés inhérentes au pubis" (ibid. p.195).

Madame
se tient trop debout dans la prairie / prochaine
:
La plupart des commentateurs admettent qu'il ne
s'agit plus ici de la rivière. Par exemple, Suzanne Bernard écrit :
"Ici, il semble bien qu'il s'agit de promeneurs installés dans la
prairie voisine de l'eau; il y a sans doute des images qui interfèrent,
mais aussi probablement une association d'idées qui rapproche la
rivière, Épouse du soleil, et Madame, pour laquelle il faut
penser peut-être à Madame Rimbaud" (Classiques Garnier, note 9).
Signalons pourtant une interprétation curieuse
d'Albert Henry qui refuse de voir dans "Madame" autre
chose que la rivière :
"Écartons donc résolument de cette section
3 toute rage biographique, je veux dire biographie anecdotique et
immédiate, alors qu'il faut se tenir à carreau à la biographie
poétique, ici synthèse de souvenirs accumulés. Si Madame se tient
trop debout dans la prairie, c'est que Rimbaud, assis dans son canot
immobile et installé dans sa méditation, la voit "monter" vers
l'horizon et l'entend comme malmener la végétation de la rive."
(op. cit. p.221).
Selon Albert Henry, la rivière est "sans
considération pour l'ombelle" ("foulant l'ombelle; trop fière
pour elle") car elle "agite sans ménagement la végétation des
bords" (op. cit. p.224).
Dans Rimbaud ou l'éclatant désastre (1984),
Pierre Brunel rejetait lui aussi l'idée que le terme "Madame" puisse désigner ici la mère du poète : "imagine-t-on la digne Mme Rimbaud, "froide" sans doute, et vêtue de noir avant même son veuvage, courant après le fugitif ?" (op.cit. p.15) Pour lui, à cette date, l'allégorie identifiant la rivière à la mère du poète et le soleil à son père absent "paraît transparente, et justement elle l'est trop. Elle n'est pas dans la manière poétique de Rimbaud" (op.cit. p.15). Mais il semble qu'il ait changé d'avis dans son édition de 1999 à
La Pochothèque, tout en limitant la portée de cette interprétation : "la mère se substitue, pour peu de temps (v.17-21), à la rivière personnifiée"
(op.cit. p.838).

où neigent les fils du travail :
"Étrange expression,
commente Jean-Luc Steinmetz, qui substitue à un non-dit (la Vierge ;
voir "fils de la Vierge") le "travail" — ce qui donne un tout autre sens au
texte ; car s'il est normal que sur l'herbe matinale blanchissent les fils
de la Vierge (le langage populaire désigne ainsi les toiles d'araignée
nattées de rosée), il est plus surprenant d'y voir neiger les "fils du
travail"." (1982, p.54-55). L'intérêt de cette substitution résidait
certainement pour le poète, indique le même Steinmetz (édition de Rimbaud
chez GF, tome 2, 1989, p.177), dans l'effet humoristique généré par la
prononciation /fis/ (enfants) en lieu et place de /fil/ (fils d'araignée) :
"les fils arachnéens se confondent alors avec les fils (les enfants) de la
gestation et de l'accouchement". Les commentateurs rappellent
à ce propos que le mot "travail" désigne communément dans la littérature
libertine la besogne érotique et, dans la langue la plus courante,
le "mal d'enfant", l'accouchement, et que la formule
"fils du travail" apparaît avec le même sens qu'ici dans un poème zutique (Les remembrances du
vieillard idiot). Nul doute qu'en faisant allusion à cette
sorte de "travail" que l'on nomme "œuvre de chair", condition incontournable
de la procréation dont la théologie exonère la mère du Christ par le dogme
de l'Immaculée Conception, Rimbaud n'ait recherché avant tout
un effet d'ironie blasphématoire. Qui n'est pas sans rapport avec les thèmes
centraux du poème (attirance et frustration sexuelles, rapport homme/femme
dans le couple, époux/épouse, fils/mère ...) au demeurant.
Cette interprétation nous
paraît compliquée. Mais elle était sans doute plus directement accessible
aux lecteurs contemporains de Rimbaud.
La critique a repéré une possible source dans le poème Sol
natal (Pauvres fleurs, 1839) où Marceline Desbordes-Valmore,
auteur bien connu des lecteurs de poésie de l'époque, comparait des gambades d'enfants au
vol erratique des "fils de la Vierge" :
Ils vont, les beaux enfants !
dans ces clos sans concierge,
Ainsi que d’arbre en
arbre un doux fil de la vierge,
Va, dans les jours d’été
s’allongeant au soleil, [...]
L'expression des "fils de la Vierge"
pour désigner les fils de soie tissés par les araignées, et les légendes qui s'y rattachent
dans la tradition chrétienne, leur étaient très familières. Il suffit de faire une petite recherche sur internet pour trouver quantité de documents de l'époque y faisant allusion :
"Dans les
herbes et dans les chaumes brillent d’innombrables filaments,
soyeux et légers, sur lesquels les gouttelettes de la rosée
miroitent encore plus vivement. De loin, pour le chasseur qui
traverse la plaine, ou pour le petit soldat en manoeuvres de
septembre, on dirait un immense tapis blanc reflétant les rayons
du soleil, tandis que sur la route ces mêmes fils, si fins, si
ténus, si souples, si argentés, accrochés aux arbres, flottent
et ondulent dans l’air matinal. [...] La campagne en est toute
blanche et le paysan, les voyant s’élever de tous côtés, pense
en lui-même : « L’hiver sera dur cette année ». Ils portent un
nom bien gracieux, ces filaments ondoyants que l’automne nous
envoie. Dans toutes nos vieilles provinces françaises, ce sont
les Fils de la Vierge.
C’est, suivant les antiques légendes, les fils provenant de la
quenouille de la mère de Jésus-enfant. Pendant qu’il sommeille,
la Vierge assise les file de ses doigts menus au bout de son
fuseau, et les laisse s’éparpiller dans l’air, pour rendre plus
chaud, l’hiver, le nid des oiselets." (Les fils de la Vierge
de G.Dubosc, Journal de Rouen, 1899 :
http://www.bmlisieux.com/normandie/dubosc48.htm).
-
des pièces musicales,
comme cette (paraît-il) célèbre romance intitulée "Le fil de la Vierge"
qui passe pour avoir été l'unique composition de Scudo, critique musical
parisien que Baudelaire raille, dans L'Art romantique, pour sa
prétentieuse et vaine cabale contre le Tanhäuser de Wagner, lors de sa création
à Paris :
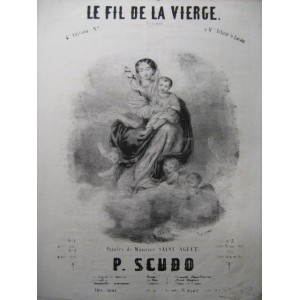
-
ou des œuvres
graphiques, comme la tapisserie ci-dessous, intitulée Le fil de la
Vierge et datée de la fin du XIXe siècle,
que j'ai trouvée grâce à Google-Images :

Rien d'étonnant, quand on observe ces représentations où le fils de la
Vierge tient au moins autant de place que les fils de sa quenouille (le
calembour y est manifestement implicite), où triomphent
la religiosité naïve et le culte de la famille, à ce que Rimbaud ait
pu, d'abord, associer spontanément le détail descriptif des "fils de la
Vierge" à l'évocation d'une promenade familiale à la campagne, puis suggérer
malicieusement /fis/ derrière /fils/ par la substitution au complément "de
la Vierge" du complément "du travail", dans un but d'allusion blasphématoire
à la besogne sexuelle.
"On peut donc supposer ici, écrit Marc
Dominicy (op. cit. p.518), une remotivation du lexème complexe 'fil(s) de la vierge' qui, en
autorisant la syllepse, ouvre la voie à une lecture anti-religieuse où la
'Famille maudite' se mue en avatar de la Sainte Famille". Steve Murphy,
de son côté, envisage une éventuelle allusion aux imageries
chrétiennes de la procréation "où des enfants pleuvraient
miraculeusement —
ou plutôt neigeraient avec la blancheur habituelle des anges, tombant du
ciel comme de petits Jésus inattendus" (op. cit. 2004, p. 305).
Songeant sans doute aussi à la mention du "saint lit" au vers 26, il
discerne dans Mémoire le tableau satirique d'une "Sainte
famille au bord de la décomposition" (op. cit. p. 304).
Michael Riffaterre a proposé une curieuse exégèse de ce passage
(op.cit.1988).
Selon lui, pour élucider le sens
de "fils" brouillé par
l'alternative phonétique /fil/-/fis/, le lecteur est conduit à actualiser successivement deux
solutions complémentaires. D'abord guidé par la connotation de
couleur du
verbe "neigent", le lecteur contemporain de Rimbaud accède
spontanément à une image de tissu (de /fil/ tissé) blanchi sur
le pré, pratique courante à cette époque. Puis, l'apparition du
mot "travail" présente à l'esprit du lecteur ce cliché de la
"littérature bourgeoise de la Révolution industrielle pour
désigner le prolétariat" : "les fils (/fis/) du travail". Il
s'agirait donc ici de tisserands blanchissant des tissus sur
l'herbe ("weavers are bleaching cloth on the grass"). La
première compétence exigée par cette lecture est la connaissance
du "sociolecte", c'est-à-dire du contexte d'époque, la seconde
repose sur la mobilisation d'un "intertexte". La
méthode est certainement excellente mais l'identification des références
contextuelles ou intertextuelles paraît peu pertinente. 
trop
fière pour elle :
Un grand nombre d'éditions indiquent un point-virgule après "elle". Mais le fac-similé du manuscrit publié
par Steve Murphy dans Parade sauvage n° 11 ne présente
aucun signe de ponctuation à la fin du vers 19. Il est donc impossible de
lire comme Jean-Pierre Giusto (et beaucoup d'autres commentateurs)
: "Madame se tient trop debout et impitoyable foule
l'ombelle innocente mais trop fière pour elle" (op. cit.
p.50). Il est préférable de suivre Michel Murat (op. cit. p.65)
qui paraphrase de la façon suivante : "[Madame est] trop fière pour
elle (tire trop de fierté personnelle) des enfants lisant (du fait que
les enfants lisent : c'est un signe de distinction sociale)". 
Vers
21-24 : "Hélas, Lui, comme / mille anges blancs ..."
:
Marie-Paule Berranger résume ainsi le débat
académique autour de ce passage : "Les commentateurs s'opposent en deux
groupes : 'Elle', 'Lui', pour les uns, sont de toute évidence Madame
mère et Rimbaud père ; pour les autres, une nouvelle représentation
personnifiante et symbolique de la rivière et du soleil assimilés aux
principes femelle et mâle. Étiemble évoque le soleil qui
'lorsqu'il disparaît derrière la montagne laisse derrière lui un
faisceau de rayons qui se divisent dans le ciel comme mille
anges blancs qui se séparent sur la route'. Il est clairement
impossible de trancher ce débat, 'Elle' et 'Lui', littéralement,
figurent l'un et l'autre, l'un dans l'autre ou l'un par l'autre, le
drame familial primitif et déterminant pour le "Je" du poème et la
séparation mythique des éléments, de la rivière et du jour au soleil
couchant ; il est clair aussi que dans ces deux séparations pèsent comme
une tragédie la division et l'éloignement du principe féminin et du
principe masculin comme si la virginité, les eaux claires du début,
relevaient d'une innocence idyllique, d'une enfance androgyne, en deça
de la prise de conscience de la différence des sexes, celle-ci
n'intervenant que pour le malheur du sujet" (op.cit. p.156-157).
"Il serait naturel, écrit Yoshikazu Nakaji, de
voir en "Madame" la mère de Rimbaud et dans le couple "Lui / Elle" le
père qui s'enfuit et la mère qui le poursuit. Mais les pronoms avec
majuscule situent le drame de la séparation sur un plan quasi mythique
et le revêtent, à travers la double surimpression de la femme-rivière en
"Elle" et de l'homme-soleil en "Lui", d'un caractère abstrait et
universel qui dépasse la simple représentation biographique " (op. cit.
p.52). On pourrait rapprocher de ce commentaire cette remarque d'un
autre critique japonais, Hiroyuki Hirai, montrant comment le
souvenir personnel est aussi pris en charge et, en quelque sorte,
sublimé au travers de ce qu'il appelle "l'érotisme cosmique de
Rimbaud" : "On pourrait remarquer, en tout cas, dans ce tableau de la
rivière un exemple typique de l'érotisme cosmique de Rimbaud où la
dualité est constituée entre le soleil homme en haut et l'eau
femme en bas. On pourrait atteindre l'"Éternité" au moment où cette
dualité se dissoudrait dans la mer mêlée avec le soleil" (op. cit.
p.94). Peter Collier, se demande si les "glissements" que l'on
peut observer dans le texte entre mémoire privée et mémoire publique
("celle de la légende et de la culture collective"), entre mémoire
privée et histoire (Jeanne d'Arc dans la strophe 1), relèvent de l'oubli
: "il oublie peut-être l'identité trop intime de Madame et de
l'homme et les transforme en archétypes". Mais il conclut que "c'est
plutôt le sujet qui transforme son expérience refoulée, impossible à
détailler, en histoire (culturelle, légendaire, même naturelle)
sublimée" (op. cit. p.67).
Michael Riffaterre, rappelant que pour toute la
tradition critique, ces vers décrivent (en personnifiant la scène) un
coucher de soleil, remarque qu'il n'est dit nulle part que "Lui" soit
ici le soleil. Or, personne ne doute de cette explication et c'est,
d'après lui, parce que plus ou moins consciemment, nous mobilisons
(comme Rimbaud lui-même) des intertextes romantiques représentant la
course vaine du sujet à la poursuite du soleil déclinant :
Le Coucher du soleil romantique de Baudelaire,
Le
Rayon vert de Jules Verne, le chapitre 16 de
Volupté de Sainte-Beuve. Il néglige peut-être un peu trop l'indice
constitué par la présence des "anges" ("mille anges blancs") qui, déjà
au vers 5, fournissaient à Rimbaud une métaphore solaire, ou du moins
lumineuse. Sans doute cette présence est-elle suffisante à guider le
lecteur dans le métaphorisme des vers 21-24. Les intertextes qu'il
signale n'en restent pas moins assez convaincants (op. cit. p.194-195).
À propos de "par-delà la montagne", Jean-Luc Steinmetz (Rimbaud, Vers
nouveaux, Une Saison en enfer, GF, p.177) fournit le
commentaire suivant : "Rimbaud rend légendaire les éléments de son
univers [...] Ici la montagne peut tout simplement évoquer une
colline dominant Charleville, le mont Olympe". 
saint lit
:
Au vers
26, le
manuscrit de Mémoire montre que Rimbaud avait d'abord écrit : "Or des
lunes d'avril au cœur du sentier". Puis, il a surchargé en
"saint lit" (Steve
Murphy, op. cit. 1994). Par contre, Famille Maudite (que Steve
Murphy considère comme une version antérieure à Mémoire — et
antérieure à juillet 72), présente déjà la leçon "saint
lit". Le même phénomène se produit au vers 29. L'observation du
manuscrit montre que Rimbaud avait d'abord écrit : "Quel murmure
à présent sous les remparts!". Puis il a corrigé en "Qu'elle
pleure. Mais Famille Maudite
présente déjà la leçon "Qu'elle pleure".
Il semble donc que
Rimbaud ait hésité, à deux endroits du texte, entre tirer sur le registre du
réalisme descriptif ou tirer sur celui de la personnification et de la
dérision. Quand il a repris son poème Famille Maudite
(abandonné semble-t-il à Paris au printemps 72) pour en faire Mémoire,
Rimbaud a dans un premier temps, par souci de réalisme, remplacé "au cœur du saint lit" et
"Qu'elle pleure" (ses premières rédactions) respectivement par
"au cœur du sentier" et "Quel murmure". Puis, il est
finalement revenu aux formules de Famille maudite,
probablement pour que le lecteur
ne perde pas de vue la dimension symbolique et autobiographique du texte.
Le référent "réaliste"
de la description était suffisamment représenté par l'"herbe pure", les "chantiers",
"les remparts". 
chantiers riverains à
l'abandon :
Ernest Delahaye (op. cit.), ami d'enfance
de Rimbaud, apporte l'interprétation biographique suivante : "À
Mézières, entre la Meuse et ce qui reste des fortifications, il y a
aujourd'hui une place que décore une statue du chevalier Bayard.
Autrefois cet endroit était un chantier. On y mêlait du sable à du
ciment, l'on y accumulait, puis tamisait le gravier retiré du fleuve par
ces dragueurs dont le poète contempla les travaux". Cité par Steve
Murphy, op. cit. 2004, p. 333. 
Qu'elle pleure :
Le manuscrit montre que Rimbaud avait d'abord
écrit : "Quel murmure à présent sous les remparts".
Puis, il a surchargé en "Qu'elle pleure" (Steve Murphy,
op. cit. 1994). Voir ci-dessus notre note sur "saint
lit". 
sous les remparts
:
Voir ci-dessus notre note sur "l'ombre
de la colline et de l'arche". 
ni la
jaune qui m'importune :
Le poème a déjà évoqué dans la section 2 une fleur
jaune (comparable à un louis d'or pur, à une "jaune et chaude
paupière") : le "souci d'eau". On pense ici nécessairement,
explique Nathaniel Wing, à la "pure fleur jaune associée
au serment conjugal dans la seconde section. Ceci peut expliquer
la signification d'"importuner" dans le contexte ; la fleur
jaune est importune parce qu'elle constitue, d'une manière ou
d'une autre, une allusion sexuelle à ce qui est évoqué dans la
section 2." (op. cit. p.209). 
ni la
bleue, amie à l'eau, couleur de cendre :
Yoshikazu
Nakaji donne une interprétation intéressante du symbole de la fleur
bleue en faisant appel au texte de Rimbaud : Les Poètes de sept ans.
Pour une meilleure compréhension de la glose proposée, il est peut-être
nécessaire de résumer l'argumentation au terme de laquelle elle s'inscrit.
Nakaji, dans cet article, souligne la communauté de destin par laquelle
Rimbaud se sent lié, en dépit de tout, avec sa mère. Comme plusieurs
commentateurs avant lui (Jean-Pierre Giusto, notamment) l’auteur observe que
« ce n’est que dans la seconde moitié que le poème révèle pleinement son
sens ». Après l’apparition de « Madame », dans la première strophe de la
section 3, il laisse progressivement apparaître une visée symbolique et, en
outre, un changement d’attitude significatif du je-narrateur. Jusque
là, celui-ci restait observateur de ce « drame du féminin » ; il n’était pas
engagé dans le « drame du couple ».
« Mais le ton change, explique Nakaji, dès la seconde strophe de la
section 3. Prêtons attention aux points d’exclamation qui sont au nombre
de dix-sept dans tout le poème et dont quatorze se trouvent dans la
seconde moitié. C’est dire que le narrateur n’est plus là comme simple
observateur, qu’il se serre désormais contre la femme-eau, parle pour
elle et se laisse envoûter et contaminer par sa vitalité sombre. La
contamination commence par le partage du ’regret’ (v.25), etc. » (op.
cit. p.52-53).
Par l’effet de cette identification à la « femme-eau », le narrateur se voit
contaminer par l’impuissance de celle qui s’est montrée « incapable
d’atteindre l’homme-soleil qui fuit » et qui a perdu sa « part virile » de
femme « trop debout ». Et la contamination a pour effet l’impossibilité de
la communication, ce mal dont souffrait l’origine de la contamination. » Tel
est le sens que le critique pense pouvoir dégager de l’incapacité du
narrateur à saisir quelqu’une des deux fleurs, à la fin du poème. Car la
« boue déposée au fond de l’œil gigantesque captivant » est « un avatar de
ce ‘bleu’ des yeux dont Rimbaud constatait, dans Les Poètes de sept ans,
qu’il était fatalement commun à sa mère et à lui. Ce ‘bleu’-là, transparent,
tant qu’il est un ‘bleu regard’ est susceptible de faire espérer un
éclaircissement — c’est pourquoi il était [dans Les Poètes de sept ans,
précédemment commenté dans l’article] l’instrument de l’hypocrisie
réciproque entre la mère et l’enfant — , est désormais décomposé et
déposé au fond de l’eau-œil stagnante, comme de la lie de vin, comme du
résidu noir et pernicieux de l’être» (op. cit. p.53-54).
Pour Steve Murphy, Rimbaud a nécessairement pensé
aux "myosotis immondes" stigmatisés par le locuteur anti-lyrique de Ce
qu'on dit au poète à propos de fleurs, petites fleurs bleues
qu'une incontournable tradition présente comme le symbole du souvenir et de
l'amour. "L'herbe d'amour qu'est le myosotis, écrit Steve
Murphy, pousse, comme le populage, dans les lieux humides et surtout les
paludes (myosotis palustris). Ce sont des fleurs du passé du sujet et
de la rivière : il n'en reste que des cendres, si ce n'est dans la mémoire"
(op. cit. 2004, p.318). 
sa
chaîne tirée :
Jean Gillibert écrit : "'Mon canot' qui est Rimbaud,
le poète, est toujours fixe [...] la chaîne qui amarre [arrime]
le canot est comme un cordon ombilical non encore sectionné."
(op. cit. p.81) 
cet œil d'eau sans bords :
Pour justifier l'image sur le plan de la vraisemblance
narrative-descriptive, on pourra dire, avec Albert Henry,
qu'"on ne voit même plus les rives dans la nuit" (op. cit.
p.225). Mais l'image a aussi une valeur symbolique : suggérer la
présence d'un œil aux dimensions fantastiques braqué sur le
locuteur comme l'œil de Dieu dans la tombe de Caïn.

|
|
Commentaire |
|
|
|
Mémoire
est un des poèmes les plus commentés de Rimbaud. Chacun, en effet, sent
dans ce texte
—
à la date qui est la sienne : 1872 — un triple aboutissement :
- Sur le plan thématique, Rimbaud est rarement allé aussi loin dans la réflexion sur
lui-même, dans l'élaboration de ce que la psychanalyse a appelé un
"roman familial" (c'est à dire la façon subjective
—
plus ou mois "romancée"
—
dont
chacun d'entre nous tente de reconstituer l'histoire de sa vie et de s'expliquer la
formation de sa personnalité).
- Dans le domaine de l'image,
il atteint aussi une sorte d'équilibre limite dans l'art de laisser
dériver les associations d'idées à partir d'un noyau métaphorique
central, sans sacrifier la rigueur et l'ampleur architecturale. Les
analogies s'enchaînent par variations successives sur une couleur, un
mouvement, une forme, se répètent en changeant légèrement de sens, renversent
le rapport entre comparant et comparé, glissent les unes dans les autres,
s'entremêlent avec la même ductilité que les eaux d'une rivière.
- Dans le domaine du vers, enfin, Rimbaud atteint
ici "le point ultime de [sa] critique de la prosodie dans la prosodie en
conservant la référence explicite au nombre et à la rime" (Jacques
Roubaud, La Vieillesse d'Alexandre, p.32, Maspéro, 1978). Mémoire
se compose de cinq parties numérotées, contenant chacune deux quatrains
d'alexandrins (cinq huitains). Les règles du décompte des syllabes et de
la rime sont respectées mais la césure à l'hémistiche est soit
impossible à réaliser, soit très affaiblie par son décalage avec la
structure syntaxique. En fin de vers, de nombreux enjambements incitent le
lecteur à marquer plus légèrement la cadence, fluidité renforcée par
l'absence de majuscules en début de vers. "Rimbaud incorpore en
quelque sorte au vers ce qui fait la beauté de la prose : une esthétique
de la continuité" (Michel Murat, op.cit. p.61). On ne
peut pas rêver style mieux adapté à l'évocation d'une rivière.
De cette extrême richesse découle souvent une
extrême difficulté, dont la critique est loin d'être venue à bout. Il
nous semble malgré tout possible, en nous appuyant sur l'imposante tradition
exégétique suscitée par ce texte (voir notre
bibliographie), d'en
proposer ici une analyse linéaire.
Nous
insérons en annexe le poème Famille maudite,
manuscrit récemment retrouvé qui constitue une première version de Mémoire
(c'est du moins la conviction de Steve Murphy, qui s'appuie sur des
indices stylistiques, graphologiques et sur les histoires respectives de la transmission
de ces deux manuscrits. Cf. op. cit. p.377-382). Nous nous appuierons à
l'occasion sur ce document dont les variantes permettent parfois d'éclairer
les intentions de Rimbaud (en tenant compte du fait que ces
"intentions" ont manifestement évolué d'un texte à l'autre;
il ne s'agit évidemment pas d'utiliser le premier comme une traduction en
clair du second).
***
Section 1
Les huit
premiers vers de Mémoire contiennent ce qu'on peut appeler la
description d'un paysage : une rivière roulant ses eaux entre ombre
et soleil.
-
Le mot "rivière" n'est pas prononcé.
Cependant, certains des termes employés dans la description de l'eau :
"lit" (v.7), "bras" (v.6), "le courant d'or en marche"
(v.5) constituent des indices suffisants pour identifier la rivière comme
thème principal du passage (et, au-delà, du poème).
-
Une "colline" est présente dans le tableau,
projetant son ombre sur une partie de la rivière ("l'ombre de la
colline"). Le soleil n'est donc pas à son zénith. Comme il sera
précisé plus loin (v.15) que la deuxième section du poème restitue
le spectacle de "midi" ("au midi prompt"), nous sommes en droit de penser que
cet épisode initial évoque le matin de la même journée : le soleil,
encore bas, s'élève progressivement derrière la colline. Un argument
supplémentaire peut être tiré de Famille Maudite, version
de Mémoire antérieure à celle que nous étudions, qui
comporte la variante suivante pour le vers 9 : "Eh! l'antique matin
tend ses réseaux limpides" (nous soulignons).
-
L'"arche" (d'un pont) contribue à maintenir dans l'ombre une
partie du cours d'eau : "l'ombre de la colline et de l'arche"
(v.8).
Plusieurs facteurs indiquent une volonté de
transfiguration anthropomorphique (personnification) de ce paysage :
-
Le
verbe "appelle", dans la seconde phrase du huitain (v.7), commandé
par le pronom sujet "Elle" (reprenant "L'eau claire",
groupe sujet de la première phrase), tend à transformer la rivière en
un personnage féminin.
-
Les mots "bras" et "lit",
déjà mentionnés, qui sont dans leur usage courant des métaphores
lexicalisées (catachrèses)
désignant différents aspects d'un cours d'eau, voient leur sens premier
réactivé dans le même but.
-
Les connotations érotiques des figures
d'analogie (comparaisons et métaphores) vont dans le même
sens.
Les quatre
comparaisons de la première phrase décrivent le miroitement des eaux
sous le soleil. L'analyse de ces comparaisons est rendue délicate pour
deux raisons :
-
Premièrement, l'écart extrême entre le comparé
("L'eau claire") et les comparants proposés par le poète : une
évocation des tristesses de l'enfance (v.1), une image érotique (v.2),
une scène historique (v.3-4), une image pieuse (v.5). Cet éloignement
entre comparant et comparé donne bien souvent l'impression qu'on a
affaire à des associations d'idées très libres, à la limite de
l'aléatoire, plus qu'à des notations descriptives.
-
Deuxièmement, l'étrange ponctuation des vers 1-2 (absence
de point-virgule à la fin du vers 1) qui peut faire douter qu'on ait là
quatre propositions comparatives de statut égal. Dans Famille
Maudite, Rimbaud encadrait par des tirets le groupe des
comparaisons, et répétait trois fois la conjonction "ou" pour
les coordonner entre elles, ce qui facilitait considérablement la
perception de la structure rhétorique. Rimbaud a-t-il voulu établir une
comparaison seconde entre le surgissement des larmes (v.1) et l'assaut
impétueux de la rivière (v.2)? C'est la seule explication que
j'envisage.
Malgré ces difficultés, on discerne une logique
d'ensemble fondée sur la récurrence de certains sèmes
: blancheur (lumière, pureté), et mouvement.
L'association
proposée par le vers 1 entre l'eau, élément naturel, et les
larmes est une banalité (verser des torrents de larmes, etc). Les larmes
sont indice de pureté, elles sont "limpides" (cf. Rimbaud lui
même dans Une saison en enfer : "Le sort du fils de famille, cercueil prématuré couvert de limpides
larmes"). Le "sel" des larmes ajoute à l'idée de pureté
une idée de blancheur qui permet de rejoindre l'une des isotopies
dominantes de la séquence. Enfin, la formule utilisée permet à Rimbaud
d'introduire le thème de la mémoire, elle suggère une méditation
mélancolique du narrateur sur sa propre enfance, dont la thématique se
précisera dans la cinquième section du poème. Pour le lecteur
d'aujourd'hui, qui a lu Enfance dans les Illuminations,
cette association d'idées s'enclenche de façon quasi automatique :
" Les nuées s’amassaient sur la haute mer faite d’une éternité de chaudes
larmes" (Enfance, II). Au total, cette première figure
analogique du poème ne paraît insolite à première lecture que par sa
faible valeur descriptive. Par contre, elle fourmille de pistes
symboliques. C'est là une
des caractéristiques fréquente de l'analogie
rimbaldienne.
Littéralement,
le vers 2 semble avoir le sens suivant : le poète voit des corps de femmes, à la chair blanche, se
lançant à l'assaut du soleil. Cependant, une autre lecture est possible
: l'assaut, sous le soleil, des blancheurs des corps de femmes,
c'est à dire de la rivière. Le substrat réaliste des
deux métaphores est le même : les reflets du soleil sur les ondulations de
l'eau ressemblent à des formes blanches et souples de corps féminins; le
mot "assaut" ajoute un sème
de mouvement (l'assaut impétueux du courant)
à l'idée de blancheur; la rivière est discrètement personnifiée et
érotisée. Mais la
première solution suscite une image plus inattendue :
une rivière agitée de désirs, lançant vers le soleil une sorte de
provocation érotique.
Sur le plan thématique, elle accentue l'effet de personnification et rend
plus complexe l'entité féminine. La rivière n'est pas seulement pucelle
défendant sa vertu (voir le vers suivant) : elle est aussi être de
désir. On pourrait voir une confirmation de cette idée dans la deuxième phrase du
huitain où la rivière "appelle" "le
Ciel bleu pour ciel-de-lit". Le choix entre ces deux interprétations
est difficile.
[Remarque — La
confrontation avec Famille
Maudite n'est pas d'un grand secours :
la rédaction est différente mais tout aussi ambiguë. Le sens du vers
n'est pas le même selon qu'on donne à la préposition "par"
une valeur de complément d'agent, son sens classique —
le soleil assailli par les blancheurs des
femmes—,
ou une valeur de lieu —
l'assaut du soleil parmi les blancheurs des femmes — sens qu'elle
a fréquemment chez Rimbaud].
Les vers 3 et 4 illustrent les mêmes
sèmes de blancheur-pureté et de mouvement ondulatoire. L'image évoque
des "oriflammes" blancs (couleur de "lys"), "en
foule" (idée de mouvement, d'agitation à perte de vue), flottant
dans le vent "sous les murs" (cf. le mot "remparts" au vers
29  ). C'est un bel échantillon d'image rimbaldienne,
qui utilise simultanément :
). C'est un bel échantillon d'image rimbaldienne,
qui utilise simultanément :
- le symbole
(le personnage historique de Jeanne d'Arc, suggéré par l'expression
indéfinie "quelque pucelle", y devient le symbole de la jeune
fille quelconque défendant sa virginité),
- la métaphore
descriptive (la soie, tissu chatoyant, évoque sur le plan visuel le
miroitement de l'eau, sur le plan tactile légèreté et douceur),
- l'allitération (les /f/ de
"foule" et d'"oriflammes", les /s/ de "soie"
et de "lys", les /l/ de "foule", "lys",
"oriflammes", le rythme énumératif du vers 3, imitent la
fluidité du courant),
- enfin, le jeu
de mots : "oriflammes" contient à la fois les mots
"or" et "flammes", attributs du soleil, dont les
reflets sur l'eau sont précisément l'objet de la description.
La métaphore
par laquelle commence le vers 5 puise dans un autre registre, celui
de l'image pieuse ou de la peinture à sujet religieux, représentant des
ribambelles d'angelots voletant dans l'espace. Mais le lecteur reconnaît
les mêmes éléments descriptifs : blancheur des reflets aquatiques,
mouvement désordonné des vagues, et le même symbole de pureté. Dans le
contexte, le mot "ébats" se charge de connotations érotiques
(on parle couramment des "ébats amoureux").
L'adverbe négatif ("Non") que nous
rencontrons au terme de cette séquence de quatre comparaisons est là pour
souligner le contraste entre la part d'ombre et la part lumineuse de la
rivière (il "résilie l'épiphanie de la blancheur" dit Alain
Badiou dans "La méthode Rimbaud - L'interruption", Conditions,
Seuil, 1992, p.132). Simultanément, l'expression "courant d'or" résume de façon hyperbolique ce qui précède, et fournit une utile reprise du sujet devant le groupe
verbal introduit par le vers 6. La structure logique de cette première
phrase pourrait donc se paraphraser de la façon suivante :
"L'eau (1er sujet)
semble claire [comme...]
mais en réalité
(— Non...)
le courant d'or en
marche (2e sujet, reprise du premier), /
meut (verbe, 3e pers. sg. de "mouvoir" = remuer)
ses bras, noirs, et lourds, et frais surtout,
d'herbe (COD).
Le
groupe sujet (les cinq premiers vers avec leur double sujet grammatical),
développait principalement l'idée de la lumière. On voit maintenant que
le groupe
verbal (vers 6) est chargé d'introduire abruptement l'antithèse : ce "courant d'or"
possède des "bras, noirs et lourds, et frais surtout,
d'herbe." En réactivant l'image lexicalisée (catachrèse)
du mot "bras" appliqué à un cours d'eau, Rimbaud fait de la
rivière un personnage humain, une entité féminine naturellement sombre
et froide qui ne s'anime que sous l'influence fécondante du soleil,
principe masculin de la nature.
La seconde phrase — vers
7 et 8 —
approfondit la personnification en
décrivant sous l'aspect d'une scène libertine les jeux de l'eau et du
soleil. Le pronom personnel féminin de troisième personne, placé en
position de contre-rejet à la fin du vers 6, sujet de cette deuxième
phrase, pointe une fois de plus vers le personnage central : la rivière. La lecture la plus logique du mot "sombre" qui suit le
pronom "Elle" consiste à y voir un adjectif apposé  .
Par cet adjectif, Rimbaud reprend l'opposition entre les deux aspects de
la rivière. .
Par cet adjectif, Rimbaud reprend l'opposition entre les deux aspects de
la rivière.
L'interprétation syntaxique et sémantique du groupe
"avant le ciel bleu pour ciel de lit" n'est pas facile : on peut
le lire de deux manières différentes. Si l'on comprend : "avant
d'avoir le ciel bleu pour ciel-de-lit", on est amené à penser que
le rivière (féminisée) tente de se protéger du soleil par un
"rideau" d'ombre jusqu'au moment où, vaincue, elle se retrouve
couverte (au double sens courant et érotique du terme) par le "Ciel
bleu". On fait ainsi de la rivière le symbole de la virginité
violentée (en se fondant sur le sème de "pureté"
effectivement présent dans certaines des comparaisons des vers 1 à 5).
Si l'on comprend au contraire : "avant d'appeler le ciel bleu pour
ciel de lit, elle appelle pour rideaux l'ombre de la colline et de
l'arche", on donne un sens opposé à la scène. La rivière désire
avoir le "Ciel bleu" pour "ciel de lit", c'est à dire
partager son "lit" (catachrèse
réactivée) avec le soleil. Mais, par pudeur ou par malice
libertine, elle voudrait cacher ses ébats derrière le rideau d'ombre.
Cette seconde lecture confirmerait l'assaut de la rivière au soleil,
sens que nous avons donné à l'image du vers 2. Elle paraît plus en
accord que la précédente avec l'évolution que Rimbaud imprime à
son texte entre Famille maudite et Mémoire
: suppression de l'image nocturne du vers 7 ("avant la nuit pour
ciel-de-lit"), insistance plus grande sur les sèmes
de blancheur, de mouvement, de sensualité, que sur celui de la pureté
(remplacement de "l'eau pure" par "l'eau claire" au
vers 1; inversion du sens de l'allusion libertine au vers 2).
En tout état de cause, la signification principale de
la personnification proposée par cette première section du texte se
comprend sans trop de difficulté : il s'agit de faire de la rivière l'incarnation de la jeune
fille, au moment où elle ouvre son lit pour la première fois à l'homme,
symbolisé ici par l'astre solaire. Une femme, au matin de sa
vie.
***
Section 2
C'est
le même paysage probablement. Il est "midi" (v.15). Le
ciel est "gris de chaleur" (v.16). La rivière, que le soleil
"meuble d'or pâle" (v.10), roule des "bouillons
limpides" (v.9). Le soleil apparaît comme une "Sphère
rose" (v.16). Son reflet dans le "terne miroir" (v.15) de
la rivière pourrait être confondu avec la fleur jaune et ronde du
"souci d'eau" (v.14). Les "saules" (v.12) qui bordent
la rivière projettent à la surface de l'eau leurs formes "vertes et
déteintes" (v.11). Mais pour arriver à un tel résumé, il faut se
livrer à un exercice douteux de déconstruction-reconstruction
(prosaïque) des métaphores rimbaldiennes. Car, dans le texte tel qu'il est écrit, une
métamorphose merveilleuse transforme la rivière en une maison de verre
où s'active, fidèle et jalouse, une "Épouse" du Soleil.
Le vers
9 débute par une interjection marquant l'étonnement :
"Eh!". C'est sans doute pour noter la nouveauté du tableau qui
s'offre maintenant aux yeux du poète. Le mot
"carreau" a ici le sens de "vitre" et désigne la
surface à la fois transparente et réfléchissante de l'eau ("carreau humide"). Par
synecdoque de la partie pour le tout, c'est la rivière. Il est possible
d'affecter un double sens au verbe "tendre". Ce verbe signifie
d'abord ici "étendre, étaler" (sens banal : la rivière étale
ses eaux bouillonnantes et limpides). Mais il peut signifier aussi
"présenter quelque chose à quelqu'un". Or c'est sans aucun
doute ce qui est nouveau à cette heure de midi : la rivière tend ses flots vers la lumière, elle s'offre au soleil. Les notations
érotiques des vers suivants valideront rétrospectivement cette lecture.
Au vers
10, au lieu du mot "soleil" attendu comme sujet du groupe
verbal "meuble d'or pâle", c'est "l'eau" que le
poète représente en train de "meubler d'or" (c'est à dire de remplir
d'or solaire) "les couches prêtes" (c'est à dire le lit
qu'elle a préparé pour accueillir l'Époux). Cette inversion de l'ordre logique des choses
s'inscrit dans la démarche anthropomorphique que la première section du
texte annonçait déjà. L'image des "couches" prolonge celle du
"ciel-de-lit" (v.7) cependant que le verbe "meubler",
par le souvenir de son sens premier (équiper une maison en meubles),
transforme le lit de la rivière en une sorte de chambre aquatique. L'or
reçu du soleil devient "pâle et sans fond" en pénétrant la
rivière parce que sa lumière s'affaiblit en se diffusant dans une masse
d'eau sombre dont on ne voit pas le fond. Cela signifie sans doute que la
rivière-épouse contrarie par sa nature froide et sombre le succès de
l'union maintenant consommée avec le soleil. Ici encore, Rimbaud développe
avec méthode, tant sur le plan symbolique que sur le plan référentiel, la donnée de départ de son
système métaphorique : le
double aspect physique, ombre et lumière, de la rivière; les natures
sexuelles et morales opposées de
la rivière et du soleil.
Pour la même raison, vers 11-12, les
feuillages verts des saules se reflétant dans l'eau prennent des teintes
"délavées". Rimbaud accentue la logique anthropomorphique en
identifiant la silhouette des arbres à des "robes" de
"fillettes", habitantes de cette maison de l'eau. Comme dans le
vers précédent mais de façon plus radicale encore, il subvertit l'ordre
normal des choses en faisant du comparant le comparé et vice versa
: ce sont les robes qui "font les saules". En procédant comme
si les saules naissaient de leur propre reflet, le poète confère toute
la réalité au monde né de son imagination. Il se donne pouvoir absolu
sur la nature car c'est lui, bien sûr, qui fait des robes de
fillettes avec des saules. Ou plutôt des saules avec
des robes de fillettes, comme dit le texte, car c'est bien parce qu'il
faut des fillettes que le poète place des saules le long de la rivière.
En employant ce verbe "faire", Rimbaud inscrit dans le poème l'acte même
de sa fabrication. Il avoue l'écriture comme activité de représentation
soumise à l'arbitraire du scripteur.
Introduit dans cet univers du symbole
généralisé, le lecteur n'a désormais aucun mal à reconnaître dans
les oiseaux qui sautent de branche en branche, "sans brides",
l'image rimbaldienne traditionnelle de l'enfant en fuite (voir par exemple Après le Déluge).
Ainsi s'assombrit peu à peu le destin de cette épouse et mère que
symbolise la rivière.
Désormais, son âme est rongée par l'inquiétude, et cette inquiétude
se concentre dans son regard. À partir du vers 13, Rimbaud
inaugure et invente un système symbolique
autour de l'idée de l'œil et de la fleur qui va tisser ses
correspondances jusqu'au dernier vers du poème. Le filage
commence par une forme et une couleur, celles du "louis" d'or.
Puis, cette pièce de monnaie jaune et ronde, qui aurait pu n'être qu'une
miniature du soleil, se transforme en une "jaune et chaude
paupière". Paupière fermée sur un "œil d'eau" (v.40),
abaissée pour se protéger de l'éclat du soleil, ou au contraire pour
s'offrir à lui?
Cet œil
d'en bas conserve quelque chose de la forme et de la chaleur du soleil
mais il est surtout le regard inquiet de la rivière comme l'atteste la métaphore suivante, au vers
14, celle de la fleur, dont le nom n'a pas été choisi par hasard.
C'est le "souci d'eau". Le souci est une fleur des marécages,
ronde, jaune, et au nom prédestiné pour tenir lieu de symbole à la
"foi conjugale" ébranlée de l'Épouse. La "foi
conjugale" est la promesse de fidélité qui accompagne le mariage,
c'est la confiance qui doit régner dans le couple. On perçoit un ton de
commisération dans l'incidente,
entre deux tirets, où le poète s'adresse directement à l'Épouse, en
employant un possessif de deuxième personne et une interjection
habituellement synonyme de respect et même de vénération ("ta foi
conjugale, ô l'épouse"). Rimbaud, qui est coutumier du sarcasme
lorsqu'il évoque le destin des femmes dans le mariage, adopte ici une
tonalité plutôt pathétique.
Les
vers 15-16 amènent le noyau verbal de la phrase unique qui compose
la quatrième strophe du texte. Le verbe "jalouser" résume bien l'idée dominante que nous venons
d'analyser. Après avoir, dans les compléments antéposés des vers 13 et
14, essentiellement développé la dimension métaphorique du passage, Rimbaud
consolide maintenant le substrat réaliste de la description. La donnée temporelle :
il est "midi". L'explication du "louis" et du
"souci", ce sont les reflets du soleil, maintenant à la
verticale du paysage, sur le "terne miroir" de l'eau. Le terme
de "Sphère", avec une majuscule, employé pour décrire le
soleil, indique une forme et explique la jalousie de l'Épouse par la
supériorité manifeste de l'Époux. Les adjectifs "gris" et
"rose" décrivent avec réalisme le voile blanc que la chaleur
d'été dépose sur le paysage et —
sur le plan symbolique — annoncent
peut-être déjà la crise crépusculaire qui constitue le sujet de la
troisième section.
***
Section 3
Ce
troisième tableau est un tableau de famille.
Une femme, dont le titre (Madame) et
l'attitude (trop debout) disent assez la qualité d'épouse et la
respectabilité bourgeoise, se tient "dans la prairie" qui borde
la rivière ("prochaine"). Le narrateur (qui se manifeste de
plus en plus ouvertement par des interjections, des apostrophes, des
modalisations, des commentaires) la juge "trop fière" de ses
enfants studieusement plongés dans leurs livres reliés en "maroquin
rouge". Mais le soir tombe : le soleil disparaît "derrière la
montagne". Et c'est le moment que choisit le poète pour nous
rappeler qu'"Elle" est aussi et d'abord la rivière, que le
soleil est "l'homme", et que ce crépuscule symbolise pour lui
la séparation d'un couple, la faillite de l'union célébrée au tableau
précédent.
Ce
passage est un bel exemple de la hardiesse rimbaldienne dans le maniement
de l'analogie. La rivière a donné naissance à un personnage (l'Épouse)
qui n'était au départ qu'un comparant dans le cadre d'une figure de
rhétorique mais qui maintenant existe par lui-même, gagne une sorte
d'autonomie. Il n'est plus possible de voir dans cette femme, debout dans
la prairie, une métaphore descriptive de la rivière (sauf à imaginer un
phénomène d'optique quelque peu artificiel, comme tente de le faire
Albert Henry  ). Une image parfaitement réaliste, tirant son origine de l'expérience
vécue, matériel psychologique sorti tout droit de la mémoire sans que
le "travail du rêve" ou de la création poétique ait eu le
loisir de le déformer, se superpose au discours métaphorique et lui
confère une signification nouvelle. C'est, à n'en pas douter, Madame
Rimbaud, en promenade avec ses enfants au bord de la Meuse.
). Une image parfaitement réaliste, tirant son origine de l'expérience
vécue, matériel psychologique sorti tout droit de la mémoire sans que
le "travail du rêve" ou de la création poétique ait eu le
loisir de le déformer, se superpose au discours métaphorique et lui
confère une signification nouvelle. C'est, à n'en pas douter, Madame
Rimbaud, en promenade avec ses enfants au bord de la Meuse.
L'évocation de ce souvenir emprunte essentiellement au discours satirique
: "Madame se tient trop debout dans la prairie" (vers 17)
sans doute d'abord tout simplement parce que cette citadine endimanchée
ne songerait pas à s'asseoir dans l'herbe. Peut-être aussi parce que, du
haut de sa silhouette droite et sombre de "veuve", elle surveille "les
fils du travail" (ses enfants, les enfants issus de son union, de ses
"couches" (v.10) avec "Lui" (v.21) le Soleil?).
Peut-être enfin parce qu'elle est "trop fière" (v.19). La
formule "où neigent les fils du travail" (vers 18)
évoque une pluie d'enfants (ou une neige) s'abattant coup sur coup sur la
mère étonnée, naissances d'autant plus merveilleuses que le père est
presque toujours absent, d'où la comparaison malicieuse avec les
"fils de la Vierge" et par là avec l'immaculée conception :  .
L'"ombrelle", avec les redondances phonétiques qui accompagnent
ce mot (ombrelle / ombelle / elle) évoque les recherches en élégance
d'une dame de la bonne société et suscite dans l'imagination du lecteur
le souvenir des innombrables parties de campagne de la littérature et de
la peinture de la fin du XIX°siècle. Il
est plus que probable que l'adjectif "fière" (v.19) ne
se rapporte pas à "ombelle" comme l'entendent certains
commentateurs .
L'"ombrelle", avec les redondances phonétiques qui accompagnent
ce mot (ombrelle / ombelle / elle) évoque les recherches en élégance
d'une dame de la bonne société et suscite dans l'imagination du lecteur
le souvenir des innombrables parties de campagne de la littérature et de
la peinture de la fin du XIX°siècle. Il
est plus que probable que l'adjectif "fière" (v.19) ne
se rapporte pas à "ombelle" comme l'entendent certains
commentateurs  ,
mais à "elle", et doit recevoir comme complément le groupe des
vers 20-21 décrivant les enfants en train de lire. La mère se
sent flattée d'avoir des enfants qui lisent, et qui lisent dans des
ouvrages luxueusement reliés en "maroquin rouge". ,
mais à "elle", et doit recevoir comme complément le groupe des
vers 20-21 décrivant les enfants en train de lire. La mère se
sent flattée d'avoir des enfants qui lisent, et qui lisent dans des
ouvrages luxueusement reliés en "maroquin rouge".
Avec le vers 21, le ton de l'élégie ("hélas") et
du lyrisme personnel remplace celui de la satire sociale. Le discours
métaphorique reprend ses droits et nous retrouvons le langage codé que
nous avons appris à déchiffrer depuis le début du texte.
L'opposition "Lui" (v.21) / "Elle" (v.23) renvoie
maintenant d'abord au soleil et à la rivière, en second lieu seulement
à leurs comparants humains. Le décor naturel fait sa réapparition.
Rimbaud utilise à nouveau le motif de la "montagne" pour
matérialiser un paysage crépusculaire : le soleil disparaît "par
delà la montagne" (vers 23). Comme dans Aube, les
variations de la lumière solaire sont rendues par le déplacement de
créatures mythologiques : les mêmes "anges blancs" qui
incarnaient la lumière solaire dans la première section du poème (vers
22). Mais ce n'est plus l'heure de l'"ébat des anges",
c'est celle de la séparation : "mille anges blancs qui se séparent
sur la route". La métaphore filée qui, depuis le début du poème,
établit un constant parallélisme entre la femme et la rivière reparaît
à la fin du vers 23, enrichie d'une référence désormais
évidente à la mère de l'auteur. Littéralement, le vers 24 décrit
la course de la rivière, que la disparition du soleil laisse "toute
/ froide, et noire". Mais, par un dévoilement audacieux de son
symbolisme, qui rappelle l'étonnant "Madame" du vers 17,
Rimbaud se charge de rappeler au lecteur (ou de lui faire comprendre, au
cas où il ne l'aurait pas encore compris) que le soleil incarne ici
l'époux, l'élément masculin du couple et que cet "homme"
vient de quitter le foyer conjugal : "après le départ de
l'homme". Dès lors, la course nocturne de la rivière, rendue
haletante par la ponctuation proliférante de la phrase et par
l'enjambement scabreux du vers 23 au vers 24, prend un tout autre sens.
Jouant probablement sur la polysémie de la préposition
"après", Rimbaud suggère une épouse affolée courant pour le
retenir derrière l'homme qui l'abandonne.
***
Section 4
La
quatrième section du texte évoque, entre élégie et dérision, le
spectacle de la veuve éplorée. C'est le soir (soirs d'août). La
métaphore déroule ses correspondances entre un paysage crépusculaire
(teinte grise de l'eau, immobilité de la "nappe" et de la
barque, chantiers désertés par leurs ouvriers) et des sentiments
mélancoliques (nostalgie, solitude, frustration sexuelle, tristesse morbide). Le passage se
termine par une focalisation sur un travailleur solitaire, draguant le
fond de la rivière, détail inattendu dans lequel le lecteur peut sentir
confusément un symbole.
L'attaque du vers 25 se fait sur un terme caractéristique du
lyrisme élégiaque : "Regret". Il annonce un enchaînement
métaphorique centré sur des sentiments mélancoliques : en premier
lieu la frustration érotique. Nous retrouvons le mot "bras",
qui appartient au champ lexical de l'eau (bras de mer, bras de rivière)
mais qui reçoit ici de ses épithètes ("épais et jeunes") une
signification humaine et sexuelle : il s'agit des bras puissants d'un
jeune amant.
On peut suivre Yoshikazu Nakaji quand il estime
(op.cit. p.52) que le vers 26 "est une reprise du vers 10 : L'eau
meuble d'or pâle et sans fond les couches prêtes".
L'"or", qui figurait depuis le début du texte la lumière du
soleil, représente maintenant celle de la lune. Cela peut surprendre.
Mais il n'y a rien là d'illogique pour le lecteur qui se rappelle cette
vieille croyance paysanne selon laquelle la lune d'avril garantit la
fertilité de l'acte sexuel. Par
ailleurs, on sera peut être étonné de rencontrer, pour la première
fois dans le texte, une référence à des moments différents de l'année
("avril" au vers 26, "août" au vers 28), alors que la
chronologie qui semblait prévaloir jusqu'ici était celle des heures
d'une même journée. Mais Rimbaud n'a pas été gêné par cette
contradiction dans la mesure où ces notions temporelles n'ont pour lui
qu'une valeur symbolique : "avril" figure un printemps synonyme
de jeunesse, d'éveil amoureux, de fécondité, tandis qu'au vers
28 le mois d'août représente la fin de l'été, l'épuisement de la
nature. Le contexte donne donc à ce vers 26 un sens assez évident : la
Rivière-Épouse regrette ces nuits ("lunes") de printemps
("d'Avril") où l'Époux (l'"or") partageait encore
son lit (le "saint lit", le lit conjugal, consacré par le
mariage; la formulation recèle une intention ironique).
Les
vers 27-28 ne sont pas d'une interprétation facile. On peut les
lire de deux façons différentes. Soit la rivière-Épouse regrette la
joie qui régnait dans les chantiers riverains à l'abandon, lieu
de ses amours, aux soirs d'août, moments de joie où cependant
germaient déjà ces pourritures qui allaient l'envahir quand le
soleil-Époux la quitterait. Soit au contraire la rivière-Épouse
regrette la joie qui régnait (du temps de ses amours, de son printemps,
des "lunes d'avril")
dans les chantiers voisins aujourd'hui à l'abandon. Aujourd'hui, c'est à
dire : en ces soirs d'août où nous nous trouvons présentement. Cette
seconde interprétation est plus satisfaisante sur un plan symbolique : le
sentiment de solitude de l'Épouse abandonnée trouve sa
correspondance dans le spectacle des chantiers déserts (probablement les carrières de sable dont parle
Delahaye  )
vidés de leurs ouvriers pour une raison quelconque : heure (il est tard),
jour (c'est peut-être un dimanche, jour de promenade familiale), mois
(août),
voire abandon de la production pour raison économique. Mais si l'on glose
le texte de cette façon, il n'est pas facile de comprendre le sens de la
proposition relative qui termine la strophe, notamment la valeur de cet
imparfait, seul imparfait du texte ("qui faisaient germer les pourritures")
inattendu dans un récit où les événements successifs étaient
évoqués jusqu'ici au présent de narration. On est obligé, pour
justifier l'emploi de ce temps du passé, de supposer l'apparition
incidente d'un autre système temporel, indexé sur le moment de
l'énonciation (c'est à dire de l'écriture du texte) : c'est Rimbaud qui
se souvient, et non plus la rivière-Épouse. Il se souvient de ces
"soirs d'août" (c'est
à dire de cette période qui a suivi le "veuvage" de sa mère),
où la nature (la végétation environnante ? le marais formé par la
rivière à l'endroit de la "nappe" ?) entrait en putréfaction et en germination (c'est
à dire où le caractère de sa mère s'aigrissait, où germaient en elle
les conséquences malsaines de la séparation).
)
vidés de leurs ouvriers pour une raison quelconque : heure (il est tard),
jour (c'est peut-être un dimanche, jour de promenade familiale), mois
(août),
voire abandon de la production pour raison économique. Mais si l'on glose
le texte de cette façon, il n'est pas facile de comprendre le sens de la
proposition relative qui termine la strophe, notamment la valeur de cet
imparfait, seul imparfait du texte ("qui faisaient germer les pourritures")
inattendu dans un récit où les événements successifs étaient
évoqués jusqu'ici au présent de narration. On est obligé, pour
justifier l'emploi de ce temps du passé, de supposer l'apparition
incidente d'un autre système temporel, indexé sur le moment de
l'énonciation (c'est à dire de l'écriture du texte) : c'est Rimbaud qui
se souvient, et non plus la rivière-Épouse. Il se souvient de ces
"soirs d'août" (c'est
à dire de cette période qui a suivi le "veuvage" de sa mère),
où la nature (la végétation environnante ? le marais formé par la
rivière à l'endroit de la "nappe" ?) entrait en putréfaction et en germination (c'est
à dire où le caractère de sa mère s'aigrissait, où germaient en elle
les conséquences malsaines de la séparation).
La
tournure "Qu'elle pleure", au vers 29, pose elle aussi un
problème d'interprétation. Faut-il voir dans cette phrase un souhait
cruel (subjonctif à valeur impérative : elle n'a qu'à pleurer
maintenant!) ou au contraire un constat apitoyé (indicatif introduit par
un intensif : comme elle pleure!)? Le remplacement un moment envisagé
par "Quel murmure" plaiderait en
faveur de la deuxième interprétation. Mais l'argument n'est pas
décisif, puisque Rimbaud est revenu à sa version antérieure de Famille
Maudite  .
Or, dans cette première rédaction, Rimbaud avait certainement
souhaité exploiter la polysémie indicatif/subjonctif, sans quoi il
aurait pu se contenter d'un "Quels pleurs". On peut considérer
cette formulation ambiguë comme une preuve de la position ambivalente du fils vis à vis de la mère : il la plaint mais,
simultanément, il ne peut s'empêcher de la tenir pour responsable de son
destin, à cause de sa froideur, de son caractère sombre, de son
orgueilleuse rigidité. Si l'on en croit le scénario proposé par le
poème, cette rigidité maternelle est antérieure à la séparation du
couple et ne peut s'expliquer entièrement comme une conséquence de son
abandon par le Capitaine Rimbaud. C'est précisément tout l'enjeu de la thématique de l'eau dans
le poème que d'établir une froideur par nature de la rivière.
Faut-il y voir une perspective strictement autobiographique, la rivière
étant la mère du poète, ou l'expression plus large d'une image
négative de la Femme, dans l'imaginaire rimbaldien? .
Or, dans cette première rédaction, Rimbaud avait certainement
souhaité exploiter la polysémie indicatif/subjonctif, sans quoi il
aurait pu se contenter d'un "Quels pleurs". On peut considérer
cette formulation ambiguë comme une preuve de la position ambivalente du fils vis à vis de la mère : il la plaint mais,
simultanément, il ne peut s'empêcher de la tenir pour responsable de son
destin, à cause de sa froideur, de son caractère sombre, de son
orgueilleuse rigidité. Si l'on en croit le scénario proposé par le
poème, cette rigidité maternelle est antérieure à la séparation du
couple et ne peut s'expliquer entièrement comme une conséquence de son
abandon par le Capitaine Rimbaud. C'est précisément tout l'enjeu de la thématique de l'eau dans
le poème que d'établir une froideur par nature de la rivière.
Faut-il y voir une perspective strictement autobiographique, la rivière
étant la mère du poète, ou l'expression plus large d'une image
négative de la Femme, dans l'imaginaire rimbaldien?
La
suite de la strophe se comprend plus aisément. L'expression
"l'haleine des peupliers" (vers 29-30) peut
s'interpréter comme un simple effet de personnification destiné à
suggérer la sensualité refoulée de la rivière-Épouse : désormais,
elle ne respire plus l'haleine de l'homme; le parfum des peupliers, qui ne
se reflètent plus dans la rivière comme à la section 2, est emporté
par la brise, vers le "haut". Au vers 31 la rivière est
décrite privée de lumière ("sans reflets", "grise") et de mouvement
("c'est la nappe"; "sans source"). Ces notations
tendent à confirmer la liberté de Rimbaud par rapport aux référents
réalistes qu'il utilise. Nous avons déjà remarqué qu'il superpose, au
mépris d'un strict réalisme, le symbolisme des heures et celui des
saisons (ce que Steve Murphy appelle l' "intrication paradoxale des
axes allégoriques de la journée et des mois ou saisons" op. cit.
2004, p.311). De la même façon, s'il donne le plus souvent l'impression
de décrire un coin de paysage déterminé ("remparts", au vers
29, reprend "murs" du vers 4; "montagne" v.23 reprend
"colline" v.8; les "chantiers", l'"arche" et autres détails
évoquent selon Berrichon et Delahaye un endroit précis des bords de Meuse entre
Charleville et Mézières), il peut à d'autres moments, comme dans ce
vers 31, donner l'impression de jouer sur les étapes successives du
développement d'un cours d'eau : de sa "source" à son
élargissement sous forme de "nappe". Si, toutefois, on veut
conserver la référence réaliste à un bord de rivière précis proche
de Charleville, on pourra noter qu'une rivière change souvent en l'espace
de quelques mètres, selon la configuration de son lit, alternant des
épisodes rapides où le courant ressemble à celui d'un torrent près de
sa source et des ralentissements où la masse d'eau s'étale jusqu'à
sembler s'immobiliser. Le symbolisme, en tout cas, est clair : c'est
l'entrée de la rivière-Épouse dans une sorte de
léthargie dépressive, de mort affective. Enfin, dans cette section de rivière au lit
probablement peu profond, ce qui explique le ralentissement de l'eau et
l'établissement d'une "gravière", le vers 32 fait
apparaître un ouvrier-dragueur peinant sur sa pelle. Le détail est
parfaitement réaliste. Mais l'introduction, pour la première fois dans
le texte, d'un personnage humain étranger à la "sainte
famille" est suffisamment surprenant pour que le lecteur maintenant aguerri
soupçonne la
fonction symbolique de l'image. La
dernière partie du poème est consacrée au décryptage de ce symbole.
***
Section 5
Cette cinquième section ne représente pas à proprement parler un
nouveau développement de l'allégorie. Elle n'est pas, en tout cas, un
cinquième moment de la journée symbolique parcourue jusqu'ici par le
poème. Elle sert plutôt à inscrire dans le poème, sous une forme
imagée, l'acte même qui le constitue. À
la silhouette de l'ouvrier fouillant le limon du fleuve se superpose l'image
pareille du narrateur, fouillant l'eau morne de sa mémoire dans
une barque immobile. Cet habile glissement analogique permet à Rimbaud
de placer en abyme, à l'intérieur du poème, le rêveur livré à la
rêverie d'où sortira le poème, et de peindre sous les couleurs d'un paysage
familier, qui l'accompagne depuis l'enfance, l'état présent de sa
mélancolie. Cette fin, placée sous le signe de l'immobilité (la barque
attachée à son ancre) n'ajoute presque aucun élément nouveau qui n'ait
déjà été exploité dans le poème. Elle revient vers certaines
métaphores pour leur donner une signification nouvelle par rapport au
"je" qui maintenant occupe le devant de la scène, elle retourne
obstinément en arrière pour signifier l'obstination du sujet à
interroger son passé, dans l'espoir incertain d'en
tirer quelque sens. Et à l'intérieur même de cette dernière section,
certaines de ces images sont répétées comme celle du canot immobile (34
et 39) ou de l'œil d'eau (33 et 40)
Ainsi, le
vers 33 reprend le symbole de "l'œil d'eau". À la
quatrième strophe du texte la "chaude paupière", "plus
pure qu'un louis", donnait une forme au face à face entre la
rivière et le soleil, à la fascination jalouse de la seconde pour le
premier. Maintenant, elle résume le face à face du poète et de la
rivière, la fascination morbide que celle-ci exerce sur celui-là. La
"chaude paupière" est devenue "oeil d'eau morne" : le
symbole se répète en s'inversant. L'emploi du mot "jouet"
s'accompagne d'une idée de soumission (on est le "jouet" d'une
force supérieure, d'une machination, d'une malédiction). Cet "oeil d'eau morne"
braqué sur lui exprime donc clairement, de la
part de Rimbaud, la conviction d'un destin plombé par le contexte
familial de ses premières années.
Le vers
34 reprend le thème de la "barque immobile" introduit au
vers 32. C'est une autre figuration de la même idée. L'auteur juge son
existence entière liée (au sens le plus fort du terme) au passé
évoqué par le poème. Liée comme une barque par son ancre au fond de la
rivière (l'image sera précisée aux vers 39-40). Nous retrouvons
aussi au vers 34 le mot "bras". Mais ici, la reprise se limite au mot, on ne peut pas y voir une image
équivalente à celle des vers 6 et 25. Cette répétition est toutefois symptomatique d'un
parti-pris de style visant à "boucler" le poème sur un retour
obsédant des mêmes mots et des mêmes thèmes, indice d'un enlisement de
l'auteur dans son passé. Par parenthèse, il n'est pas sans intérêt de
noter la différence des deux interjections du vers 34 :
"ô/oh", l'une exprimant la fascination, l'autre le dépit
("ô canot immobile ! oh! bras trop courts !"). On pourrait y
déceler une ambivalence du poète à l'égard de son obsession : une
souffrance non dépourvue d'une certaine complaisance au malheur.
C'est encore l'idée d'impuissance qui ressort des vers 34-36 : les
bras du poète sont trop courts pour atteindre les deux fleurs qu'il
voudrait saisir : "oh! bras trop courts!". Il s'agit de nouveau
d'une reprise, la fleur jaune n'étant probablement rien d'autre que le
"souci d'eau" du vers 14, qui était lui-même, selon notre
analyse, une miniature du soleil. L'"eau couleur de cendre" du
vers 36, de son côté, n'est qu'une variante plus tragique du "terne
miroir" du vers 15. Quelle signification donner à la réapparition,
dans cette fin de texte, de l'image du soleil ? Et quelle signification
accorder à cet élément nouveau, lui : la fleur "bleue, amie à
l'eau"? Une solution de paresse serait d'y voir une de ces multiples
figurations rimbaldiennes du sens caché, du secret enfoui, de l'absolu
hors d'atteinte, comme on en trouve dans tant de ses textes. Mais dans Mémoire,
la précision de la problématique autobiographique encourage le
commentateur à conférer un sens plus précis à ces deux symboles
majeurs du poème. Reste qu'il n'est pas facile d'éviter l'extrapolation
arbitraire, la psychologie à la petite semaine. Tentons malgré tout de
résumer ce qui ressort des gloses les plus sages proposées par la
critique rimbaldienne. La
fleur jaune serait un principe masculin, l'image du père; la fleur bleue,
un principe féminin, l'amour (dont la "fleur bleue" est en
effet souvent le symbole, dans la "grande" littérature comme
dans la romance populaire et dans la langue courante). L'impossibilité de
saisir ces deux fleurs exprimerait une frustration affective, ayant son
corollaire dans l'impossibilité d'aimer. Tout lecteur de Rimbaud se
rappelle le "bleu regard qui ment" de la mère du Poète, dans Les
Poètes de sept ans. Il est tentant d'interpréter à cette
lumière l'impossible accès à la "fleur bleue amie à l'eau"
comme une image de la méfiance du poète à l'égard d'un amour maternel
dont il a, dès longtemps, reconnu la fausseté. Quant à la "jaune
qui m'importune", on peut y déceler un reflet aveuglant du soleil,
c'est à dire l'obstacle représenté par le père dans les rapports entre
mère et fils. Tout cela bien sûr dans la conscience déformante que peut
en avoir le "sujet névrosé".
Le vers
37 ramène le thème des "saules" et des "oiseaux sans
brides" introduit par le vers 12. C'est à dire la tentation de
l'évasion hors du carcan familial : en s'envolant, "une aile"
(synecdoque pour oiseau) secoue la poussière ("poudre")
des saules. L'image est belle, comme chaque fois que Rimbaud évoque le
départ, le vent du large. L'interjection "Ah!" indique le sens
à donner à ce vers : un rêve fou, une aspiration illusoire. Au vers 12,
l'idée était appliquée à de mythiques "fillettes", au vers
37 le poète la revendique pour lui-même.
Le vers
38 est un alexandrin coupé 3/3//2/4, à césure bien marquée.
Rimbaud, qui a tout au long du poème pratiqué des rythmes irréguliers a
manifestement choisi de terminer son texte sur des alexandrins réguliers
ou quasi-réguliers (le vers 37 présente un e non élidé en 7°
position). Le but est d'exploiter la monotonie naturelle de l'alexandrin
pour exprimer l'enlisement, ce qui n'enlève rien à sa beauté. Rimbaud cherche à rappeler par
d'insistantes répétitions — répétition du mot "rose"
(rose / roseaux), du groupe /dé/ (dans "dès longtemps / dévorées"),
allitérations en /r/ , assonances en /o/ —
et par le sémantisme
de l'image (fleurs fanées), l'atmosphère somnolente de la quatrième
section : les soirs d'août, les chantiers à l'abandon, les végétaux en
putréfaction. Un symbole du bonheur perdu, d'une jeunesse gâchée
peut-être.
Enfin, les deux derniers vers ramènent l'image-clé de cette
dernière partie (que nous avons déjà commentée) : le canot immobile.
Le rythme bien marqué (virgule, point-virgule) et régulier (3/3//3/3) du
premier alexandrin participe à l'idée d'immobilité portée par le
texte. L'allongement obtenu par l'enjambement à la fin du vers 39 et par
l'affaiblissement de la césure dans le vers 40 (qui est malgré tout un
alexandrin coupé 6/6) contribuent à mettre
fortement en relief la clausule : "
— à quelle boue ?".
"L'œil d'eau sans bords" est évidemment la rivière personnifiée, qui n'a
pas de bords parce que la nuit estompe maintenant les contours, et surtout
parce que cet œil est un gouffre où s'engloutit l'âme malade du poète.
"La boue" inverse l'image de "l'eau claire"
au vers 1. Encore un souci évident de "bouclage" du poème. Il
est à peine nécessaire d'expliciter le sens de cette ultime métaphore,
tant le propos du poète, en cette fin de texte, a été martelé. Le
terme désigne cette part obscure, malsaine de son passé que Rimbaud
n'est pas sûr de cerner tout à fait (d'où la tournure interrogative)
mais dont il sait par contre qu'elle est son ver rongeur, sa blessure, la
source de son mal de vivre. Là aussi, bien sûr, certains vont plus loin
dans l'analyse, développent des thèmes psychanalytiques. Dans
l'insistance avec laquelle Rimbaud représente ou imagine (à travers le
discours codé des métaphores) l'union sexuelle de ses parents (la
"scène primitive" comme disait Freud) certains diagnostiquent
le secret enfoui, vécu comme une honte, qui s'avoue à demi-mot dans le
texte. Mais ici encore, me semble-t-il, on prend le risque de franchir la
limite qui sépare l'analyse littéraire d'un autre type de démarche,
tout aussi légitime, mais qui demanderait une autre compétence
... 
|
|
|