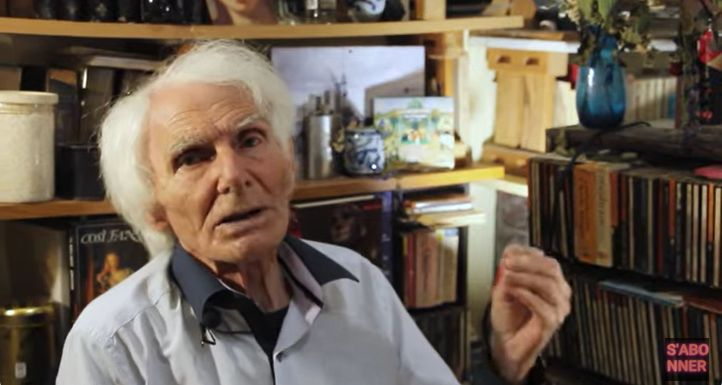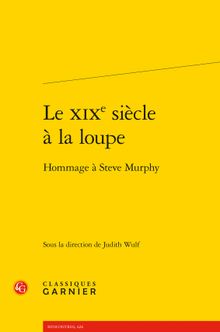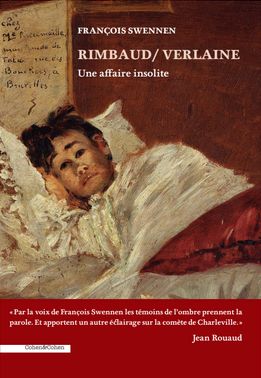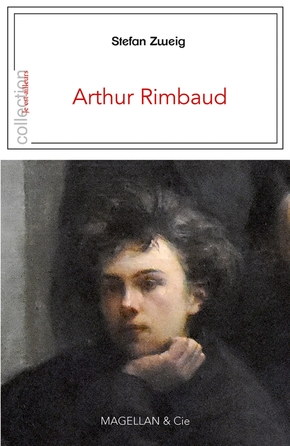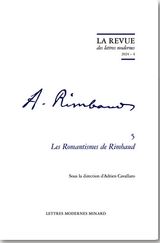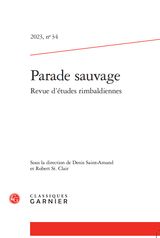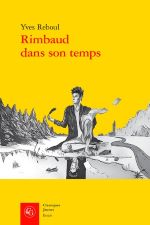|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
EN LIBRAIRIE 11/09/2024 - Le xIxe siècle à la loupe. Hommage à Steve Murphy, sous la direction de Judith Wulf, Classiques Garnier, 2024.
09/10/2024 - Vincent Vivès, Arthur Rimbaud. Éthique du temps de l'immaturité, Septentrion, 2024.
11/09/2024 - Stefan Zweig, Arthur Rimbaud, Magellan et Cie, avril 2024.
23/05/2024 - Revue des Lettres modernes, "Les Romantismes de Rimbaud", dir. Adrien Cavallaro, mai 2024.
|
26/04/2025 - Sur les traits de séparation dans le manuscrit des Illuminations (Sur Les Illuminations).
On trouvera dans cette page un tableau
récapitulatif des nombreux traits horizontaux, pouvant
aller de quelques centimètres à toute la largeur du
texte, employés à la séparation des poèmes dans
le manuscrit des
Illuminations. Leur fonction n'est pas toujours
claire et beaucoup d'entre eux apparaissent biffés. Ce
sont là autant d'indices et de traces du travail effectué par
Rimbaud pour organiser son recueil, et autant d'énigmes que nous serions coupables de
ne pas interroger [...]
Suite. 18/04/2025 - Un film "maudit" ? Notes sur le Rimbaud de Richard Dindo (Rimbaud sur la toile) « Ce film, mystérieusement, est "maudit" en France, où, à commencer par les enseignants, puis par les critiques de cinéma, etc., peu de gens l’ont aimé ou même accepté [...] Je me demande parfois pourquoi ce déni, cet aveuglement. » [...] Suite.
Les
poèmes de la série "Jeunesse" sont parmi les rares, dans Les
Illuminations, qui renvoient à des péripéties précises de la vie
de l'auteur. Nous commencerons par lister les jalons
chronologiques utiles à leur interprétation. Après quoi nous
tenterons de dater, sinon le jour ou le mois, du moins la
période de leur composition
[...]
Suite. 14/01/2025 - Pourquoi la pagination du manuscrit des Illuminations s'arrête-t-elle à « Barbare ? » (Sur Les Illuminations). Ceux qui attribuent aux premiers éditeurs la pagination des folios 1 à 24 des Illuminations ont une réponse toute trouvée : les pratiques variables des préparateurs de La Vogue et des éditions Vanier. Mais quand on est convaincu de la paternité rimbaldienne, cette foliotation inachevée reste une question. La réception des Illuminations au cours du dernier quart de siècle le montre : au cœur de tout jugement sur l'œuvre en tant que recueil, se niche, informulée ou formulée à demi, en tout cas forcément subjective, une réponse à cette question [...] Suite.
Quand vous saisissez « BnF 14123 » dans la zone de recherche de votre navigateur, en quête des vingt-quatre feuillets paginés des Illuminations, une présentation s'affiche, où vous pouvez lire : « manuscrit des 29 premiers poèmes publiés en 1886 dans la revue La Vogue par Félix Fénéon ; c'est lui qui a rangé et numéroté les feuillets. » L’agencement des deux premiers tiers des Illuminations par ce jeune animateur de revues d’avant-garde, vingt-cinq ans à peine, est donc présenté comme un fait établi. Or, il n’est pas du tout scientifiquement prouvé que Félix Fénéon ait dirigé l’édition des folios 1 à 24 des Illuminations. Voici, par exemple, ce qu’en dit Michel Murat dans le Dictionnaire Rimbaud des éditions Classiques Garnier :
08/03/2024 - « L'Éternité ». Panorama critique (Anthologie commentée).
Le poème existe en trois versions. Voir les trois textes
dans ma page :
Commentaire.
Je les nommerai respectivement :
Il y a cent cinquante ans, en septembre ou octobre 1873, Une
saison en enfer, le seul livre qu'ait pu faire imprimer
Rimbaud, est sorti des presses d’une coopérative ouvrière
bruxelloise. Il n’en existait pas jusqu'ici de fac-similé
convenable.
C’est chose faite.
Nous avons fait imprimer à 500 exemplaires une édition semblable
à l'originale.
Paru chez Gallimard en septembre 2023, 176 grandes pages 25
x 32, exactement, le volume offre le texte intégral d’Une
saison en enfer, vingt poèmes, neuf lettres de Rimbaud à
sa famille, le tout accompagné d’une soixantaine de pages
d’illustrations, et six textes spécialement rédigés par
Patti Smith pour cette édition. Titre : Une saison en
enfer 1873 et autres poèmes. Ce qui, par parenthèse, a
l’air de présenter Une saison en enfer comme un poème
ou un recueil de poèmes, alors que Rimbaud, dans une lettre
de mai 1873, parle d’« histoires » (au pluriel) : de
« petites histoires en prose ». Mais Patti Smith n’est pas
la seule, hélas, à parler à tort de poème(s) à propos de
« la Saison » comme on l’appelle en raccourci.
Pour Gilles Lapointe, « Trouvez Hortense » doit s'entendre
comme « Cherchez Hugo ».
Un
lieu désaffecté. Juste des tissus suspendus, une mélodie métallique,
et des images projetées. Et aussi le souffle de quelqu’un qui est
enchaîné au milieu de ça – le monde qu’il s’est construit entre
réalité et projections. Cet homme, il ne sait pas pourquoi ni
comment il est arrivé là. Mais par la parole, il va remonter le fil.
Et par le cri, il va revendiquer une liberté à conquérir. 01/04/2023 - Philologie et idéologie. « Sur “Les Mains de Jeanne-Marie" », par Marc Dominicy, Parade sauvage n°33, 2022, (Bibliographie / Notes de lecture). On voit d’habitude dans « Les Mains de Jeanne-Marie » un tombeau de la Commune et, dans « Jeanne-Marie la sorcière » comme l’a baptisée Yves Reboul, le portrait-type de la femme révoltée. Marc Dominicy n'entend pas en rester à ces conventions. Rimbaud, dit-il, a forgé à travers son personnage de communarde « un type susceptible de remplacer les figures de l’histoire sainte, dans une nouvelle ontologie sociale et politique ». Autrement dit, on assisterait dans « Les Mains de Jeanne-Marie » à la transmutation des convictions politiques et sociales du poète en une forme personnelle de religiosité, doctrine violente aussi, comme on le verra. Le texte serait dans ce sens très différent « des autres pièces traitant de la répression versaillaise ou du retour à l’ordre qui lui a succédé (“Chant de guerre Parisien”, “L’orgie parisienne ou Paris se repeuple”, “L’homme juste”) ». Il préfigurerait « plus que beaucoup d’autres, les poèmes de 1872-1873 et […] la prose d’Une saison en enfer » où, si je comprends bien la pensée du critique, Rimbaud manifesterait une certaine propension à la métaphysique. Par quel chemin Marc Dominicy arrive-t-il à cette conclusion inattendue ? Cela mérite examen, d'autant que l'étude est minutieuse. La démonstration se veut fondée philologiquement [...] Suite.
On vient d’apprendre le décès de Bruno Claisse, survenu le
29 octobre 2022. On lui doit, entre autres contributions
rimbaldiennes, notamment dans la revue Parade sauvage,
deux livres importants sur Les Illuminations :
Rimbaud ou « le dégagement rêvé » (Charleville-Mézières,
Musée-Bibliothèque Arthur Rimbaud, coll. « Bibliothèque
sauvage », 1990) et Les Illuminations et l’accession
au réel (Classiques Garnier, coll. « Études rimbaldiennes »,
2012).
L’article d’Yves Reboul « Corbeaux et mémoire du sang », récemment paru dans Parade sauvage n° 32, est remarquable par au moins deux aspects. D’une part, il présente une série d’intertextes très convaincants à l’appui d’une lecture politique des poèmes Les Corbeaux et La Rivière de Cassis. D’autre part, il expose au fil d’une argumentation érudite et serrée, une interprétation nouvelle du dernier sizain des Corbeaux, fort séduisante [...] Suite.
Après l'avoir un moment contestée, je me rends à la glose proposée par André Guyaux dans son édition de La Pléiade, concernant ce poème : Ce qui est “trop beau” (v. 5) ne devrait pas disparaître : la “Pêcheuse” et le “Corsaire” (v. 6), qui chante, incarnent cette nécessité de l'aurore. [1].
Mais
il manque un élément essentiel dans cette note trop
elliptique. On admet sans peine que la survenue de l'aurore
réponde à une « nécessité », quelle que soit la beauté de ce qui l'a
précédée, et qu'elle détruit. Mais en quoi Pêcheuse et Corsaire
sont-ils l'incarnation de cette nécessité ? Le glossateur,
visiblement, nous a laissé la responsabilité de compléter son
raisonnement. Eh bien ! essayons ! [...]
Suite. 15/11/2021 - Quelques signets dans Rimbaud de Clinchamps (Bibliographie / Notes de lecture).
Dans
Rimbaud de Clinchamps, Jean-Luc Steinmetz relève le défi
quelque peu oulipien de relire sa propre vie à travers les mots, les
formules, les situations, les confessions de Rimbaud dans Une
saison en enfer. Il se propose de vivre, dit-il, en compagnie de
ce livre intimement connu et vénéré, « une saison d'écriture
menée jusqu'au bout de moi-même » [...]
Suite
10/11/2021 - Sur l'entrée « Bonheur » du Dictionnaire Rimbaud / Alain Vaillant, 2021, p. 98-100 (Bibliographie / Notes de lecture).
. Au
centre de sa réflexion, Alain Vaillant place les deux
formulations légèrement distinctes de la maxime d'Alchimie du verbe : « [...] tous les
êtres ont une fatalité de bonheur ».
Il livre sur ce sujet controversé une synthèse claire, débouchant sur une
interprétation courageusement engagée de la clausule du
chapitre : « Cela s'est passé. Je sais aujourd'hui saluer la
beauté ». J'aurai une petite réserve concernant
l'argumentation d'Alain Vaillant mais, quant à sa
conclusion, je l'adopte tout entière et sans restriction
[...]
Suite
01/11/2021 - Le Père Goriot / Nuit de l'enfer (Florilège des sources).
Lorsqu'il signale l’épisode balzacien de l’agonie du Père
Goriot comme un modèle rhétorique susceptible d'avoir
intéressé Rimbaud, notamment dans Nuit de l'enfer,
C.-A. Hackett confesse « une certaine tristesse ». Il a
longtemps hésité, explique-t-il, à dévoiler au lecteur cette
source car « ce rapprochement soulève de nouveaux doutes à
l’égard de la sincérité de plusieurs passages d’Une
Saison en enfer […] peut-être un peu moins personnelle
et un peu plus littéraire que nous n’avions cru »
[...]
Suite 31/10/2021 - Sur l'interprétation d'Alchimie du verbe par Yann Frémy dans l'entrée Une saison en enfer du Dictionnaire Rimbaud, Classiques Garnier, 2021, p. 732-759 (Bibliographie / Notes de lecture). Est-ce le fait d'écrire pour un dictionnaire ou l'exercice d'un doute méthodique, Yann Frémy, dans son entrée Une saison en enfer du Dictionnaire Rimbaud, n'expose jamais une thèse sans indiquer la possibilité d'une solution différente, avec mention circonstanciée de ceux ou celles qui les défendent. D'où la richesse de l'article, sur le plan de l'information. On perçoit malgré tout assez bien le type d'approche obtenant sa préférence : celle qui décrit Rimbaud tournant sans fin dans son labyrinthe intérieur, sans en trouver l'issue [...] Suite
Yann Frémy a sous-titré l’un des recueils d’articles qu’il a dirigés : « Résistances d’Une saison en enfer ». De cette « résistance » herméneutique et de l’attrait qu’elle exerce sur les chercheurs, le volume récemment édité sous la direction d’Olivier Bivort, André Guyaux, Michel Murat et Yoshikazu Nakaji (Hermann, 2021), apporte une nouvelle preuve. Un bon tiers des dix-neuf articles rassemblés sont consacrés en tout ou en partie au livre de 1873 (contre un seul, par exemple, aux Illuminations). Je rends compte ici de trois de ces contributions : celles d’Éric Marty (« Mythe ou allégorie dans Une saison en enfer », p. 259-266), Yoshikazu Nakaji (« “Mon sort dépend de ce livre” : vie et art dans Une saison en enfer », p. 231-245) et Jean-Luc Steinmetz (« Rimbaud “mage ou ange” », p. 184-194) [...] Suite
Dans son entrée « Illuminations » (« Manuscrits ») du Dictionnaire
Rimbaud, comme je l'ai fait
remarquer dans mon compte rendu (05/03/2021), Michel
Murat ne discute pas l'argument n°1 en faveur d'une
pagination auctoriale des Illuminations, celui qui, personnellement,
entraîne mon
adhésion à cette thèse : l'argument fondé sur le processus
de constitution de la série Veillées. La question du
feuillet 18 ! J'y reviens ici, plus longuement.
[...] Suite
Tout est dans l’indéfini. Rimbaud dirige son éloge vers « une Raison » pour la distinguer de toutes celles que la tradition philosophique a appelées « la Raison ». En premier lieu, la Raison de Descartes et de la philosophie classique, raison confondue avec la Vérité du christianisme. Celle qui émerveille, dans sa naïveté, le « nègre » de Mauvais sang :
J'ai reçu au cœur le coup de la
grâce. Ah ! je ne l'avais pas prévu ! [...] 31/03/2021 - Sur une formule de Génie : « le brisement de la grâce croisée de violence nouvelle » (Anthologie commentée) Les Illuminations, selon Tzvetan Todorov, tournent le dos à toute représentation. Le recours massif à l'abstraction, notamment, bloquerait chez le lecteur toute possibilité d'identifier les êtres et les actions du texte. Les termes abstraits sont effectivement omniprésents dans le recueil et Todorov n’a aucun mal à en dresser une liste impressionnante. Que cet usage génère des ambiguïtés, c’est une évidence. Mais le critique objectif ne se contente pas de noter l’obscurité — en l’exagérant beaucoup si possible — pour la déplorer, il essaie d’en comprendre les raisons et d’en évaluer la productivité sémantique et esthétique. [...] Suite
|
24/03/2024 - Adrien Cavallaro, Margot Favard, "Le Cahier de Douai" d'Arthur Rimbaud, Book Club de France Culture, (audio, 51'.48).
04/12/2024 - Arnaud Buchs, Prologue à une herméneutique impossible : Une saison en enfer et la traversée du sens, site Fabula.
06/10/2024 - Denis Lavant partage avec nous 05/04/2024 - Hugues Fontaine, Serge Plantureux, Débat autour de la photographie de Vienne, site internet rimbaudphotographe.eu27/03/2024 - Conférence de Serge Plantureux, "Un Portrait viennois d'A.R.". 02/04/2024 - Lumni / Enseignement, Toutes nos ressources sur Rimbaud. 01/04/2024 - Philippe Bourget, Sur les pas de Rimbaud et Verlaine dans les Ardennes.09/02/2024 - Les manuscrits de Rimbaud offerts au Musée de Charleville-Mézières présentés au public les 17 et 18 février, Fr-Info.05/01/2024 - Une saison en enfer ou Rimbaud l'Introuvable, Fabula.02/02/2024 - Dick Annegarn & Jérôme Boloch, deux routes de Rimbaud, Le Bijou, Toulouse, jeudi 22 février 2024, 21h30.08//01/2024 - Des manuscrits très rares de Rimbaud offerts à la ville de Charleville-Mézières par un généreux donateur, France-info. 20/12/2023 - Jacques Bienvenu : Un nouveau président des « Amis de Rimbaud », Rimbaud ivre. 18/12/2023 - Thierry Roger, "Appliquer Rimbaud. Note sur les études de réception" (compte rendu de Rimbaud et le Rimbaldisme, par Adrien Cavallaro, Hermann, 2019), Acta fabula. 15/12/2023 - Journée Rimbaud, Académie de Versailles. Conférence Adrien Cavallaro.
15/11/2023 -Manuscrit
de "L'Éternité". 08/11/2023 -Arnaud Viviant, Foutez la paix à Arthur Rimbaud, Fr.-inter. 06/11/2023 - Les Illuminés - Interview de Jean Dytar et Laurent-Frédéric Bollée, Delcourt. 20/05/2023 - Louis-Henri de La Rochefoucauld, Patti Smith, une pseudo-poétesse devenue icône lucrative, L'Express, 01/11/2023. 07/06/2023 - Exposition - « Rimbaud explorateur. Photographies du poète vagabond ». Conférence Hugues Fontaine. Institut français de Vienne. Colloque « Le rimbaldisme “aux confins du monde” : approches de la réception mondiale de Rimbaud ». Université Grenoble Alpes, 24 - 26 mai 2023.18/04/2023 - François-Henri Désérable, « Mon maître et mon vainqueur », Conférence Les Amis de Rimbaud (vidéo, 56:58). 15/04/2023 - Jacques Bienvenu, Un nouveau commentaire sur l'article de Gilles Lapointe, blog "Rimbaud ivre". 17/09/2022 - Laure Egoroff, Arthur Rimbaud. Rumeurs et visions, émission "Samedi fiction", France-Culture (59 min.). 07/09/2022 - Les inventions d'inconnu, conférence de Yoshikazu NAKAJI au Collège de France le 6 avril 2016. 16/06/2022 - Mendel Péladeau-Houle, « Les Illuminations “dans l'affection et le bruit neufs” » (compte rendu de la RHLF de mars 2022), Fabula. 14/05/2022 - Mélanges Nakaji (en ligne sur le site de l'université de Tokyo)
29 janvier 2021 - Revue italienne d'études françaises n°11 : « Les traductions de Rimbaud », Fabula (les articles sont en ligne). Novembre 2021 - Nieves Arribas et Olivier Bivort, Les traductions espagnoles d'Une saison en enfer à l'épreuve de l'oralté, Revue italienne d'études françaises. 31/10/2021 - Exposition : « Rimbaud - Ménélik », hôtel littéraire Arthur Rimbaud, Paris, du 25/11/2021 au 25/01/2022. 27/10/2021 - Charleville s'offre un portrait de Rimbaud du peintre Fernand Léger, L'Ardennais. 24/10/2021 - Exposition : Germain Nouveau, « le mendiant étincelant », par Alain Paire, La Marseillaise. 19/10/2021 - « Haji Jabir parle avec l'Abyssinienne de Rimbaud », par Nadia Haddaoui, Médiapart. 17/08/2021 - « Le poète illuminé, Germain Nouveau », film-annonce, ActuaLitté. 25/06/2021 - David Ducoffre, Sur les manuscrits des « Illuminations », un sort définitif fait ici à la pagination !!!, blog Enluminures (painted plates). 28/05/2021 - Sylvain Tesson parle de Rimbaud chez Radio-Classique (12:41). 15/05/2021 - Pouvoir : Dans les coulisses de la guerre sans merci autour de la panthonéisation de Rimbaud et Verlaine, Rédaction de Vanity Fair. 10/05/2021 - Frédéric Thomas, Un programme poétique pour la Commune de Paris, lundimatin#287. 12/04/2021 - Frédéric Thomas, Rimbaud à l'heure de la Commune, Libération. 07/04/2021 - Et à l'aurore..., captation et montage Christelle Pinet (vidéo, 6:43) 22/03/2021 - Jacques Bienvenu, Précisions sur la présence de Rimbaud et Germain Nouveau à Charleville en janvier 1875, blog Rimbaud ivre. 27/02/2021
- David Ducoffre,
"N'oublie pas de chier sur le Dictionnaire Rimbaud si
tu le rencontres..." (partie 1 : contextualisation),
blog Enluminures (painted plates).
|
|||||||||||||||||
|
ÉCOUTER RIMBAUD EN LIGNE, dit ou chanté par ... |
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||